Aux éditions Flammarion, Didier Eribon publie Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple. Un ouvrage essentiel et poignant, où le philosophe et sociologue nous entraîne dans les tourments du grand âge. En dressant le portrait de sa propre mère, en évoquant son destin laborieux et douloureux.
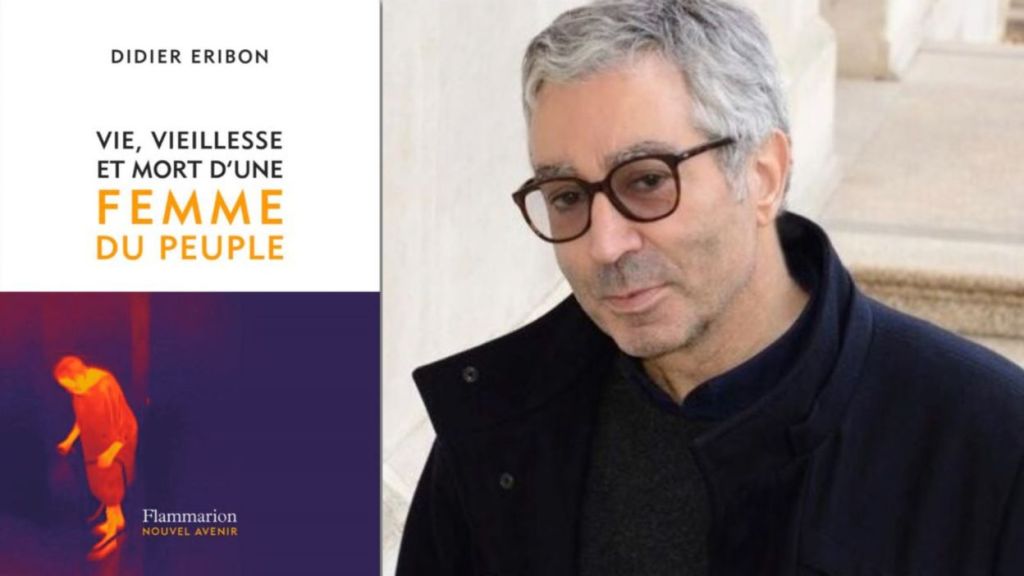
S’il est bien une réalité incontournable à laquelle nul ne peut échapper, c’est bien celle de notre finitude et, peut-être plus angoissante encore, celle de la mort de nos proches. On commence par constater des signes de faiblesse physique, annonciateurs d’un début de dépendance, et un désintérêt vis à vis de l’extérieur. Didier Eribon a retrouvé sa mère après de longues années d’éloignement. « Le fossé qui s’était creusé entre nous n’avait pas été le fruit d’une rutpure, mais d’un éloignement progressif qui avait commencé très tôt, pour devenir, assez rapidement, quasi total et sans retour possible ». Dans Retour à Reims, il exposait les raisons qui l’avaient poussé à quitter le foyer familial et son environnement, ne supportant plus le climat étouffant et les allusions racistes et homophobes qui émaillaient les conversations. Il y retraçait également son difficile parcours de transfuge de classe, évoquant les écueils douloureux de ce passage d’un monde prolétaire à celui d’une élite cultivée. Expérience très proche de celle décrite par Annie Ernaux qui a si subtilement raconté la honte…, puis la honte d’avoir eu honte de son milieu d’origine !

Au fil des décennies, l’heure est venue pour la fratrie Eribon de s’occuper de leur mère, vieillissante et affaiblie. Pour l’auteur, le dialogue est toujours aussi difficile, accablé par ses propos : « ma mère était une vieille femme raciste et je devais l’accepter telle qu’elle était ». Les quatre frères doivent bientôt prendre l’une des décisions les plus difficiles d’une vie résumée dans ce mot affreux, le placement, qui ne rapporte que douleur et culpabilité. Encore faut-il convaincre l’intéressée qui précisément ne l’est pas et s’accroche à son logement. Pour y parvenir, sont prononcées ces paroles aussi mensongères qu’apaisantes. « Ne t’inquiète pas. Ici ils vont bien s’occuper de toi. Tu verras, tu seras bien ». Sa mère espérant alors envers et contre tout une amélioration de son état, il culpabilise de l’avoir rassurée… « Mais comment dire à sa mère: non, tu ne vas pas guérir, non tu ne vas pas aller mieux ? ». Au contraire, elle ne cessera de s’affaiblir dès son entrée dans l’établissement, tant physiquement par une immobilité contrainte que psychiquement par une perte progressive de tous ses repères sociaux et amicaux.

L’état de sa mère s’aggrave, elle est atteinte par ce « syndrome de glissement » constaté par de nombreux soignants : comme tant d’autres, elle lâche progressivement les bords du tobbogan… À sa mort, Didier Eribon fait siennes la douloureuse phrase d’Albert Cohen « jamais plus je ne serai un fils » et la plainte d’Annie Ernaux « je n’entendrai plus sa voix » (Une femme). Comme pour cette dernière, transfuge de classe comme lui, la mort de sa mère, dernier parent survivant, ne signifie pas seulement la perte du rôle filial mais la disparition du dernier lien qui rattache au milieu ouvrier d’origine. Il replonge dans ses souvenirs pour ressusciter la vie de cette femme du peuple : « Elle avait été une enfant abandonnée, placée à 14 ans comme bonne à tout faire, une femme de ménage, une ouvrière d’usine… elle s’était mariée à 20 ans et avait vécu pendant 55 ans avec un homme qu’elle n’aimait pas ». Elle a travaillé dur, élevé quatre enfants, fut malheureuse toute sa vie. Veuve et octogénaire, elle savoure alors sa découverte de la liberté et l’absence de contraintes, elle s’offre même le vertige d’un amour tardif !

En sociologue averti, Didier Eribon est accablé de constater la déshumanisation progressive des pensionnaires en ehpad ou maison médicalisée, coupés de toute activité stimulante et de leurs chères habitudes, sommés de suivre les règles d’une vie en commun qui leur est imposée avec des gens qu’ils ne connaissaient pas auparavant. « Seule sur son lit de la maison de retraite, ma mère protestait, clamait son indignation. Mais son cri ne s’adressait qu’à une seule personne, moi ». Il se souvient que Simone de Beauvoir, parlant de son livre La vieillesse, disait « avoir voulu écrire un essai qui serait, touchant les personnes âgées, le symétrique du Deuxième Sexe ». L’ouvrage n’eut pas, loin s’en faut, le même retentissement… Pourtant, si la condition des femmes concerne la moitié de l’humanité, les conditions de notre vieillesse nous concerne toutes et tous. C’est sans compter sur le déni farouche qui persiste encore dans notre société lorsqu’il s’agit d’aborder sérieusement les problèmes de la fin de vie.
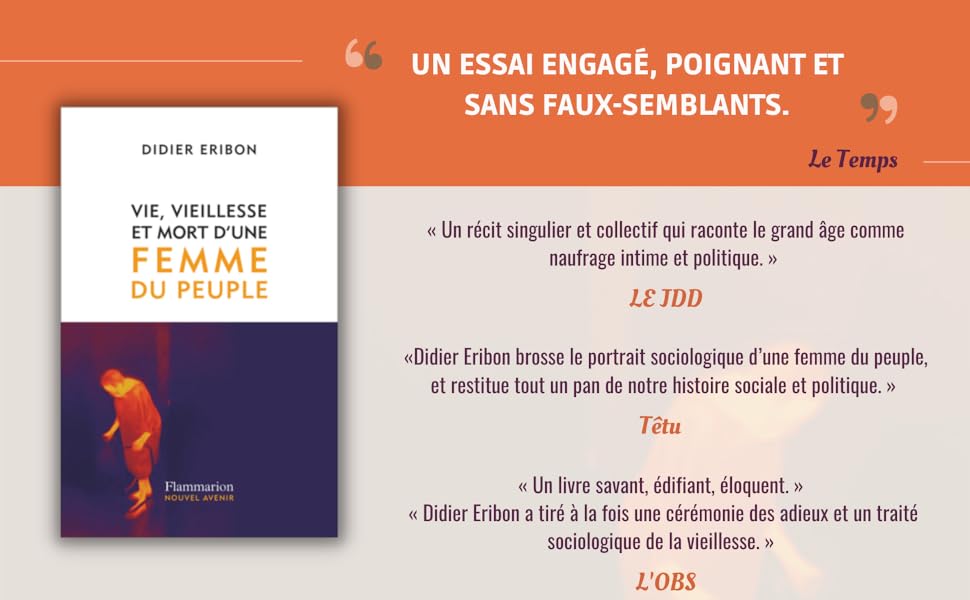
En conclusion, le philosophe propose une réflexion stimulante sur nos rapports aux personnes âgées et à la mort, sur l’expérience du vieillissement. Qui s’apparente à « une expérience-limite dans la philosophie occidentale, l’ensemble des concepts semblant se fonder sur une exclusion de la vieillesse » : comment mobiliser des personnes qui n’ont plus de mobilité ni de capacité à prendre la parole et donc à dire « nous » ? Pour Didier Eribon, ce « retour (à)mère » est tout à la fois un cri de colère et un cri d’amour. Chantal Langeard
Vie, vieillesse et mort d’une femme du peuple, par Didier Eribon (Flammarion, 336 p., 21€).






