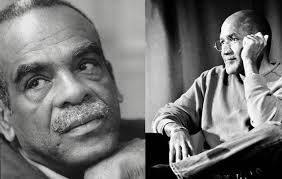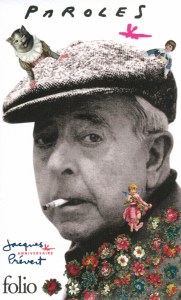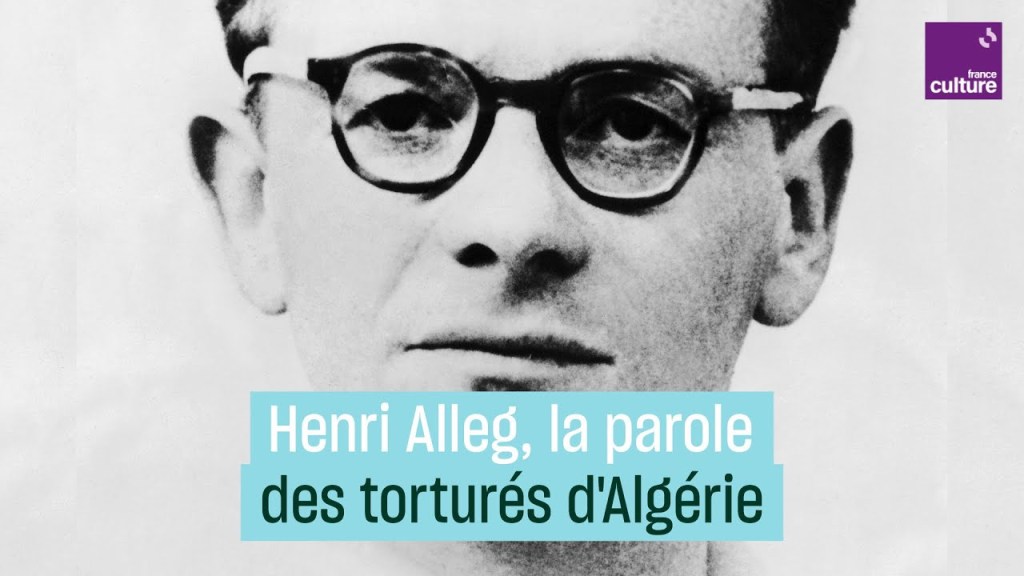Le 3/02/2011, disparaît Édouard Glissant. Le romancier, poète et philosophe antillais nous accordait en 2009 un entretien exclusif lors du festival d’Avignon. En ce 14ème anniversaire de la mort de cette grande figure des Lettres, Chantiers de culture le propose de nouveau à ses lecteurs . En hommage à une pensée vivifiante, toujours vivante.
 Il pleut sur la mangrove, rue Cases-Nègres pleure la Martinique. De l’océan rougi sang des traites négrières, roulent en larmes argentées les noirs sanglots de l’identité créole autant que la flamboyance poétique d’une langue archipélisée. Rugis de nouveau, toi la Pelée dont les flancs marrons ont accouché de ce fils d’esclave en 1928 et gémis enfin, toi France mal aimante qui assignas le rebelle à résidence dans les années 60 : entre Caraïbe et « Tout-Monde », un homme de haute stature nous a quittés ! Un géant de la littérature dont l’aura dépassait largement les frontières de la francophonie, un écrivain et philosophe dont la plume mêla sans jamais faillir poétique et politique.
Il pleut sur la mangrove, rue Cases-Nègres pleure la Martinique. De l’océan rougi sang des traites négrières, roulent en larmes argentées les noirs sanglots de l’identité créole autant que la flamboyance poétique d’une langue archipélisée. Rugis de nouveau, toi la Pelée dont les flancs marrons ont accouché de ce fils d’esclave en 1928 et gémis enfin, toi France mal aimante qui assignas le rebelle à résidence dans les années 60 : entre Caraïbe et « Tout-Monde », un homme de haute stature nous a quittés ! Un géant de la littérature dont l’aura dépassait largement les frontières de la francophonie, un écrivain et philosophe dont la plume mêla sans jamais faillir poétique et politique.
Dans Philosophie de la relation, son dernier ouvrage paru chez Gallimard, Édouard Glissant invitait chacun à s’immerger toujours plus dans le « local » pour toujours mieux s’enraciner dans le « Tout-Monde ». Une pensée qui élève le particulier à l’universel, l’archipel en continent pour s’ouvrir au grand large de « l’emmêlement des cultures et des humanités ». Rencontre avec un sage qui promeut le singulier de notre identité au cœur de la diversité.
En édition de poche ou format classique, les ouvrages d’Édouard Glissant sont disponibles aux éditions Gallimard.
Yonnel Liégeois – Selon vous, la figure mythique de l’Africain représente-t-elle le symbole même de cette relation nouvelle de l’homme au monde que vous définissez comme le « Tout-Monde » ?
 Édouard Glissant – Pour ma part, il n’y a pas de figure centrale dans ce que j’entends par « philosophie de la relation », elle implique le relais entre toutes les différences au monde, sans en exclure aucune, aussi minime soit-elle. Historiquement cependant, il est certain que l’Afrique subsaharienne, l’Afrique noire, remplit un rôle de moteur de diaspora dans le monde. Depuis les origines de l’humanité jusqu’à l’immigration d’aujourd’hui, à cause de la pauvreté : cette terre d’Afrique est incontestablement une terre originelle. Comme il est certain que les Africains déportés en esclavage ont contribué fortement à ce que j’appelle une nouvelle « America » : l’Amérique de la colonisation et du mélange, celle de la Caraïbe et du Brésil, qui devient aujourd’hui l’Amérique des États-Unis avec Obama. En conséquence, l’Africain est une figure fondamentale de la relation, non « la » figure typique de la relation. Méfions-nous de ne pas retomber dans les erreurs que les anciens dominants ont commises et tenté d’imposer !
Édouard Glissant – Pour ma part, il n’y a pas de figure centrale dans ce que j’entends par « philosophie de la relation », elle implique le relais entre toutes les différences au monde, sans en exclure aucune, aussi minime soit-elle. Historiquement cependant, il est certain que l’Afrique subsaharienne, l’Afrique noire, remplit un rôle de moteur de diaspora dans le monde. Depuis les origines de l’humanité jusqu’à l’immigration d’aujourd’hui, à cause de la pauvreté : cette terre d’Afrique est incontestablement une terre originelle. Comme il est certain que les Africains déportés en esclavage ont contribué fortement à ce que j’appelle une nouvelle « America » : l’Amérique de la colonisation et du mélange, celle de la Caraïbe et du Brésil, qui devient aujourd’hui l’Amérique des États-Unis avec Obama. En conséquence, l’Africain est une figure fondamentale de la relation, non « la » figure typique de la relation. Méfions-nous de ne pas retomber dans les erreurs que les anciens dominants ont commises et tenté d’imposer !
Y.L. – Vous affirmez que cette nouvelle relation de l’homme au monde demeure un « impossible » si la politique ne s’inscrit pas dans une poétique. Qu’entendez-vous par là ?
 E.G. – J’appelle « poétique » une intuition, une divination du monde qui nous aide à définir nos tracés politiques. Selon moi, tous les systèmes organisés de pensée, qu’ils soient politiques ou religieux, ont failli à établir ces tracés. Non seulement il nous faut inventer désormais un autre langage, mais il nous faut avant tout constater que l’être humain se retrouve seul en face des problèmes. Que lui reste-t-il alors, sinon d’avoir une intuition de ce qu’est le monde pour prendre une position qui s’accorde au mouvement du monde ? Si, dans un pays on en reste à ses propres impératifs, le risque est grand de commettre d’irréparables erreurs, il nous faut désormais dans un même mouvement agir en notre lieu et penser avec le monde. De la Première à la Troisième Internationale, certes, on a essayé d’agir ainsi, mais le système idéologique a étouffé le mouvement. Il nous faut aller au monde avec des intuitions, non avec une idéologie : c’est ce que j’appelle une poétique. La poétique déclenche les réflexes politiques, une poétique n’est pas une façon de cacher les problèmes, bien plutôt une manière de les révéler et de les réveiller. L’élection d’Obama, par exemple, fut d’abord un acte poétique avant d’être un acte politique, j’en suis convaincu : il se passait là un bouleversement, un retournement de l’histoire des États-Unis qui relevait d’une poétique du monde.
E.G. – J’appelle « poétique » une intuition, une divination du monde qui nous aide à définir nos tracés politiques. Selon moi, tous les systèmes organisés de pensée, qu’ils soient politiques ou religieux, ont failli à établir ces tracés. Non seulement il nous faut inventer désormais un autre langage, mais il nous faut avant tout constater que l’être humain se retrouve seul en face des problèmes. Que lui reste-t-il alors, sinon d’avoir une intuition de ce qu’est le monde pour prendre une position qui s’accorde au mouvement du monde ? Si, dans un pays on en reste à ses propres impératifs, le risque est grand de commettre d’irréparables erreurs, il nous faut désormais dans un même mouvement agir en notre lieu et penser avec le monde. De la Première à la Troisième Internationale, certes, on a essayé d’agir ainsi, mais le système idéologique a étouffé le mouvement. Il nous faut aller au monde avec des intuitions, non avec une idéologie : c’est ce que j’appelle une poétique. La poétique déclenche les réflexes politiques, une poétique n’est pas une façon de cacher les problèmes, bien plutôt une manière de les révéler et de les réveiller. L’élection d’Obama, par exemple, fut d’abord un acte poétique avant d’être un acte politique, j’en suis convaincu : il se passait là un bouleversement, un retournement de l’histoire des États-Unis qui relevait d’une poétique du monde.
Y.L. – « Les pays sans falaises n’appellent pas au large », écrivez-vous. Chacun d’entre nous a donc impérativement besoin de l’aspérité pour tenter l’ailleurs ?
E.G. – Assurément, sinon nous ne faisons que du tourisme sur cette terre ! La faiblesse de la plage de sable blanc ? Elle n’offre aucune résistance… J’ai toujours été frappé, lors de mes voyages dans le Finistère, au bout du bout du monde, par le fait qu’il faut toujours faire effort pour imaginer qu’il y a aussi de la vie de l’autre côté. L’idée de la falaise nous renvoie ainsi à l’idée de frontière. Non pas comme une muraille, mais comme un passage, le passage d’une saveur à une autre saveur. La frontière est une limite entre deux saveurs à découvrir, un possible à franchir pour aller plus loin. Elle ne peut être conçue comme un enfermement, elle établit des solidarités entre des réalités différentes, et cette idée nouvelle des frontières nous permet de combattre celle des murs. Il y a quelque chose d’étonnant dans la réalité de la falaise : le risque de tomber, comme il est risqué dans le monde actuel de tenter d’aller vers l’autre !
Y.L. – C’est pourtant le risque que vous nous proposez, en franchissant une drôle de frontière : passer d’un univers continental à ce que vous nommez un univers « archipélisé » ?
 E.G. – Effectivement, et cela oblige chacun à revoir sa carte du monde ! Penser le monde en cinq continents et quatre races est une représentation désuète, qu’il importe de combattre. En remettant d’abord en cause les concepts d’identité et de territoire… La vérité du territoire, et en conséquence sa conquête et sa légitimité, sont essentiellement des pensées occidentales qui ont fondé l’idée de colonisation et conduit à l’oppression de l’autre. Un moment de l’histoire à dépasser, grâce à ce que j’appelle une pensée du tremblement et de l’errance… La pensée de l’errance n’efface pas le territoire, elle le relativise, c’est ce que je nomme une « pensée archipélique ». Loin d’être une pensée du renfermement, la pensée insulaire ou archipélique induit que toute île suppose l’existence d’une île voisine et d’autres îles dans l’archipel. Elle implique donc le refus de tout absolu ou certitude, alors que nous vivons dans l’habitude du résultat et du rationnel. Elle s’interdit surtout toute oppression de l’autre, puisqu’elle est avant tout relation à l’autre. La pensée de l’errance, loin de se perdre ou d’errer, est certes une pensée fragile et intuitive, peut-être plus chaotique et incertaine mais elle permet mieux, selon moi, de rendre compte de l’état actuel du monde, absolument imprévisible et imprédictible.
E.G. – Effectivement, et cela oblige chacun à revoir sa carte du monde ! Penser le monde en cinq continents et quatre races est une représentation désuète, qu’il importe de combattre. En remettant d’abord en cause les concepts d’identité et de territoire… La vérité du territoire, et en conséquence sa conquête et sa légitimité, sont essentiellement des pensées occidentales qui ont fondé l’idée de colonisation et conduit à l’oppression de l’autre. Un moment de l’histoire à dépasser, grâce à ce que j’appelle une pensée du tremblement et de l’errance… La pensée de l’errance n’efface pas le territoire, elle le relativise, c’est ce que je nomme une « pensée archipélique ». Loin d’être une pensée du renfermement, la pensée insulaire ou archipélique induit que toute île suppose l’existence d’une île voisine et d’autres îles dans l’archipel. Elle implique donc le refus de tout absolu ou certitude, alors que nous vivons dans l’habitude du résultat et du rationnel. Elle s’interdit surtout toute oppression de l’autre, puisqu’elle est avant tout relation à l’autre. La pensée de l’errance, loin de se perdre ou d’errer, est certes une pensée fragile et intuitive, peut-être plus chaotique et incertaine mais elle permet mieux, selon moi, de rendre compte de l’état actuel du monde, absolument imprévisible et imprédictible.
Y.L. – Plus et mieux qu’un modèle, votre expérience de la Caraïbe se révèle pour vous une référence fondamentale dans votre réflexion ?
 E.G. – C’est elle qui fonde ce que je nomme « pensée archipélique ». La Caraïbe, francophone – anglophone – hispanophone, n’est pas une sphère monolithique, elle est un lieu de créolisation intense qui invite l’écrivain et le poète, le citoyen par voie de conséquence, à changer sa vision du monde. Parce qu’en ce lieu, les cultures venues de l’extérieur se sont mélangées d’une manière fondamentale, au point de provoquer un changement de regard sur le monde où les principes de relation et de relativisation ont supplanté ceux de l’absolu et de l’universel… Un changement qui, selon moi, est devenu le changement même de notre monde actuel. En dépit de multiples résistances dont les fondamentalismes de tout genre (rationaliste, scientifique, religieux…) sont l’expression, le monde se créolise : les cultures s’échangent en se changeant ou se changent en s’échangeant ! Parce qu’il en est temps, je suggère donc à quiconque de changer sa vision du monde, qui n’est pas idéologie mais imaginaire, pour l’harmoniser avec le mouvement actuel de notre planète Une vision qui n’enferme pas dans l’identitaire mais ouvre à d’autres cultures et à d’autres communautés. De l’identité- territoire, création des cultures occidentales, il nous faut passer à l’identité-relation qui n’est pas pour autant renoncement à nos racines, il suffit seulement d’affirmer qu’elle ne doit pas conduire à l’enfermement mais à l’ouverture. Quand les pays se créolisent, ils ne deviennent pas créoles à la manière des habitants des Antilles, ils entrent, ainsi que j’ai tenté de le formuler, « dans l’imprévu consenti de leurs diversités ».
E.G. – C’est elle qui fonde ce que je nomme « pensée archipélique ». La Caraïbe, francophone – anglophone – hispanophone, n’est pas une sphère monolithique, elle est un lieu de créolisation intense qui invite l’écrivain et le poète, le citoyen par voie de conséquence, à changer sa vision du monde. Parce qu’en ce lieu, les cultures venues de l’extérieur se sont mélangées d’une manière fondamentale, au point de provoquer un changement de regard sur le monde où les principes de relation et de relativisation ont supplanté ceux de l’absolu et de l’universel… Un changement qui, selon moi, est devenu le changement même de notre monde actuel. En dépit de multiples résistances dont les fondamentalismes de tout genre (rationaliste, scientifique, religieux…) sont l’expression, le monde se créolise : les cultures s’échangent en se changeant ou se changent en s’échangeant ! Parce qu’il en est temps, je suggère donc à quiconque de changer sa vision du monde, qui n’est pas idéologie mais imaginaire, pour l’harmoniser avec le mouvement actuel de notre planète Une vision qui n’enferme pas dans l’identitaire mais ouvre à d’autres cultures et à d’autres communautés. De l’identité- territoire, création des cultures occidentales, il nous faut passer à l’identité-relation qui n’est pas pour autant renoncement à nos racines, il suffit seulement d’affirmer qu’elle ne doit pas conduire à l’enfermement mais à l’ouverture. Quand les pays se créolisent, ils ne deviennent pas créoles à la manière des habitants des Antilles, ils entrent, ainsi que j’ai tenté de le formuler, « dans l’imprévu consenti de leurs diversités ».
Y.L. – Créolité et mondialité : deux maîtres-mots dans votre réflexion qui ne sont pas à confondre avec sédentarisation et mondialisation ?
E.G. – Sédentarisation et mondialisation renvoient à une pensée de système, créolité et mondialité renvoient à ce que j’appelle communément la pensée du tremblement. La pensée du tremblement, ce n’est pas la pensée du doute ni celle de la faiblesse ou de l’hésitation. C’est la pensée du contact avec le monde, et le monde tremble dans tous les sens du terme, c’est surtout la pensée de la non-systématisation et de l’imprévisible. Il faut nous habituer à cette forme de pensée, parce qu’il y a urgence, parce que la pensée de système ne peut plus recevoir et concevoir la réalité du monde actuel.  Il nous faut désormais dialectiser nos pensées, non comme le marxisme à coups d’idéologie et c’est là son drame, mais à coups de poétique : là réside la grande différence. Le tremblement ne peut être idéologie, c’est difficile à concevoir et à accepter. Un exemple ? Ce que nous répondions à notre façon, lors de la crise aux Antilles à quelqu’un qui me reprochait d’être contre les entreprises parce que j’étais contre le capitalisme ! Non, bien sûr, je ne suis pas contre l’entreprise mais je suis contre l’entreprise telle que la considérait mon interlocuteur : la finalité de l’entreprise n’est pas d’accumuler de l’argent ou les bénéfices, je crois au contraire que la réalité de l’entreprise est de produire du bien-être. C’est ce que j’appelle passer de l’idéologique au poétique. Quelle fut la grande erreur des systèmes socialistes ? De penser qu’il fallait seulement partager les richesses au lieu de partager le bonheur, le bien-être… Se battre contre le capitalisme et le libéralisme, c’est se battre en faveur d’une société qui produit du bonheur ! Une pensée de plus en plus présente au monde, particulièrement dans les petits pays… Contre les méfaits de la mondialisation, il nous faut penser en termes de mondialité : une poétique du partage et de la diversité en réponse à l’égalisation par le bas et à l’uniformisation. Au risque de me répéter, je l’affirme et persiste à penser qu’il n’y a rien de plus exaltant en ce Tout-Monde : les hommes et les peuples peuvent changer en échangeant, sans se perdre pourtant ni se dénaturer. Propos recueillis par Yonnel Liégeois
Il nous faut désormais dialectiser nos pensées, non comme le marxisme à coups d’idéologie et c’est là son drame, mais à coups de poétique : là réside la grande différence. Le tremblement ne peut être idéologie, c’est difficile à concevoir et à accepter. Un exemple ? Ce que nous répondions à notre façon, lors de la crise aux Antilles à quelqu’un qui me reprochait d’être contre les entreprises parce que j’étais contre le capitalisme ! Non, bien sûr, je ne suis pas contre l’entreprise mais je suis contre l’entreprise telle que la considérait mon interlocuteur : la finalité de l’entreprise n’est pas d’accumuler de l’argent ou les bénéfices, je crois au contraire que la réalité de l’entreprise est de produire du bien-être. C’est ce que j’appelle passer de l’idéologique au poétique. Quelle fut la grande erreur des systèmes socialistes ? De penser qu’il fallait seulement partager les richesses au lieu de partager le bonheur, le bien-être… Se battre contre le capitalisme et le libéralisme, c’est se battre en faveur d’une société qui produit du bonheur ! Une pensée de plus en plus présente au monde, particulièrement dans les petits pays… Contre les méfaits de la mondialisation, il nous faut penser en termes de mondialité : une poétique du partage et de la diversité en réponse à l’égalisation par le bas et à l’uniformisation. Au risque de me répéter, je l’affirme et persiste à penser qu’il n’y a rien de plus exaltant en ce Tout-Monde : les hommes et les peuples peuvent changer en échangeant, sans se perdre pourtant ni se dénaturer. Propos recueillis par Yonnel Liégeois
À lire : les ouvrages d’Aliocha Wald Lasowski. L’enseignant-chercheur en philosophie politique à Sciences-Po Lille fut lauréat de la Bourse Édouard Glissant. Une plongée foisonnante dans les idées et concepts de l’auteur d’une Philosophie de la relation.
Fils rebelle de Césaire, portrait
Natif de Sainte-Marie en Martinique en 1928, Édouard Glissant est élève au lycée Schoelcher de Fort-de-France à l’époque où Aimé Césaire enseigne dans les classes terminales. Elève brillant, il fait un premier séjour à Paris à l’âge de 18 ans, où il étudie la philosophie à la Sorbonne et l’ethnologie au Musée de l’Homme. Lecteur assidu des poèmes de Saint-John Perse autant que des « Peau noire et masques blancs » de Franz Fanon avec qui il se lie d’amitié, Glissant s’éveille très tôt à cette conscience aigüe de l’homme colonisé. Désormais, écriture et lutte se conjugueront à égalité dans la relation que l’écrivain affine avec le monde qui l’entoure. Alors qu’il fonde en 1959 le Front antillo-guyanais pour l’autonomie avec Paul Niger, il est expulsé de Martinique et assigné à résidence en métropole jusqu’en 1965. Il n’empêche, il poursuit à Paris la lutte anticoloniale, milite en faveur de l’indépendance de l’Algérie et signe en 1960 le Manifeste des 121 en compagnie de Jean-Paul Sartre.
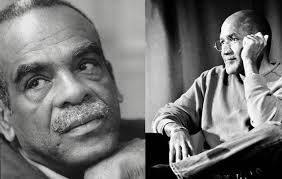 Fils spirituel d’Aimé Césaire, Édouard Glissant s’éloigne progressivement du concept de « négritude » pour s’affirmer comme le théoricien du « Tout-monde », de la « créolité » et de la « mondialité ». Devenant à son tour l’éveilleur d’une nouvelle génération d’écrivains antillais : Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Daniel Maximin… Directeur du Courrier de l’Unesco de 1982 à 1988, il se tourne alors vers une carrière universitaire : d’abord à l’université d’État de Louisiane puis, en 1995, à l’université de New York en tant que professeur « distingué » en littérature française. En 1998, il rate de peu le Nobel de littérature. En 2007, il s’oppose avec virulence à la création d’un ministère de l’Identité nationale. Une aberration pour celui qui dénonce dans toute son œuvre les « identités-racines » au détriment des « identités-relations ». Une seule certitude et conviction pour le poète, « le monde entier se créolise, il entre dans une période de complexité et d’entrelacement tel qu’il nous est difficile de le prévoir ». Faut-il craindre ce nouvel état du monde, cette « créolisation » ? Bien au contraire, « elle est un métissage d’arts et de langages qui produit de l’inattendu, elle est une façon de changer en échangeant avec l’autre, de se transformer sans se perdre ».
Fils spirituel d’Aimé Césaire, Édouard Glissant s’éloigne progressivement du concept de « négritude » pour s’affirmer comme le théoricien du « Tout-monde », de la « créolité » et de la « mondialité ». Devenant à son tour l’éveilleur d’une nouvelle génération d’écrivains antillais : Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Daniel Maximin… Directeur du Courrier de l’Unesco de 1982 à 1988, il se tourne alors vers une carrière universitaire : d’abord à l’université d’État de Louisiane puis, en 1995, à l’université de New York en tant que professeur « distingué » en littérature française. En 1998, il rate de peu le Nobel de littérature. En 2007, il s’oppose avec virulence à la création d’un ministère de l’Identité nationale. Une aberration pour celui qui dénonce dans toute son œuvre les « identités-racines » au détriment des « identités-relations ». Une seule certitude et conviction pour le poète, « le monde entier se créolise, il entre dans une période de complexité et d’entrelacement tel qu’il nous est difficile de le prévoir ». Faut-il craindre ce nouvel état du monde, cette « créolisation » ? Bien au contraire, « elle est un métissage d’arts et de langages qui produit de l’inattendu, elle est une façon de changer en échangeant avec l’autre, de se transformer sans se perdre ».
Nourri de St John Perse et de Faulkner, il est l’auteur d’une œuvre foisonnante entre essai et fiction, poésie et théâtre. Édouard Glissant ? Un homme de haute stature, tant par la taille que dans l’écriture, un verbe qui se joue des mots et des concepts pour caracoler sur des sentiers de traverse. De la mangrove aux flancs de la Pelée, tel l’esclave « marron » à la conquête de sa liberté. Y.L.
À lire : L’imaginaire des langues. Une série d’entretiens avec Édouard Glissant conduits par Lise Gauvin entre 1996 et 2009. Où le penseur antillais du « Tout-Monde » affine sa réflexion au fil du temps, constatant que « la pensée unique frappe partout où elle soupçonne de la diversité ».
De Glissant à Chamoiseau, un livre à déclamer
 D’une lecture exigeante, Philosophie de la relation relève autant de la méditation poétique que du traité philosophique. Un livre à déclamer à haute voix, où les mots s’entrechoquent dans un phrasé luxuriant, où le verbe poétique se moque de la raison systémique. Une pensée qui bouscule les mots sur la page, renverse notre manière d’être au monde pour nous embarquer, nouveau Christophe Colomb ni dominant ni dominé, à la découverte de ce « Tout-Monde » où les cultures et les identités s’entremêlent au gré de l’inattendu et de l’imprévisible. Une lecture à poursuivre avec L’intraitable beauté du monde, un sublime texte coécrit avec Patrick Chamoiseau qui signe de son côté Les neuf consciences du Malfini. Une merveilleuse fable à savourer, telle la mise en œuvre romanesque de la pensée de son compère Glissant lorsque rapace et colibri apprennent à se connaître et à se reconnaître. Y.L.
D’une lecture exigeante, Philosophie de la relation relève autant de la méditation poétique que du traité philosophique. Un livre à déclamer à haute voix, où les mots s’entrechoquent dans un phrasé luxuriant, où le verbe poétique se moque de la raison systémique. Une pensée qui bouscule les mots sur la page, renverse notre manière d’être au monde pour nous embarquer, nouveau Christophe Colomb ni dominant ni dominé, à la découverte de ce « Tout-Monde » où les cultures et les identités s’entremêlent au gré de l’inattendu et de l’imprévisible. Une lecture à poursuivre avec L’intraitable beauté du monde, un sublime texte coécrit avec Patrick Chamoiseau qui signe de son côté Les neuf consciences du Malfini. Une merveilleuse fable à savourer, telle la mise en œuvre romanesque de la pensée de son compère Glissant lorsque rapace et colibri apprennent à se connaître et à se reconnaître. Y.L.