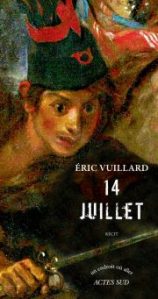Lors de sa création en 1954 à Broadway, la comédie musicale The pyjama game surprit alors par sa thématique : la révolte d’ouvrières contre l’ordre établi ! Aujourd’hui sur les scènes françaises, dans une adaptation de Jean Lacornerie. Sans oublier la 7ème édition du Festival de cinéma italien de Tours.
États-Unis, le 5 janvier 1957. Écarté des milieux politiques et ayant sombré dans l’alcoolisme, le sénateur McCarty, initiateur de la chasse aux sorcières contre les homosexuels et tous ceux soupçonnés de sympathies marxistes, n’a plus que quelques semaines à vivre. Ce jour-là, il entend le président Eisenhower demander les pouvoirs spéciaux au Congrès afin de lutter contre la menace communiste au Proche-Orient. Nous sommes en pleine guerre froide. Par le biais des comédies musicales, Hollywood exporte le modèle de  l’American way of life (le mode de vie américain, en français).
l’American way of life (le mode de vie américain, en français).
Créée trois ans plus tôt à Broadway, la comédie musicale The pajama game connaît un tel succès sur les planches que Stanley Donen et George Abbott décident de l’adapter au cinéma. Un succès d’autant plus étonnant que le livret tourne en dérision le patronat, la hiérarchie sociale, la domination masculine. Tirée d’une nouvelle de Richard Bissell, elle raconte la révolte d’ouvrières d’une usine de confection de pyjamas, confrontées au refus de leur patron de leur accorder une augmentation de salaire de sept centimes et demi. Avec à leur tête Babe, la porte-parole du syndicat, elles cessent le travail, dénoncent la double comptabilité du patron, les méthodes d’encadrement, les cadences infernales sur l’air de Racing with the clock (Course contre la montre), devenu un standard.  Les affaires se compliquent lorsque Babe et Sid, le nouveau directeur de l’atelier, tombent amoureux !
Les affaires se compliquent lorsque Babe et Sid, le nouveau directeur de l’atelier, tombent amoureux !
« Le livret m’a intéressé parce qu’il casse les clichés du genre », commente Jean Lacornerie qui signe la mise en scène de la nouvelle adaptation présentée en décembre au Théâtre de la Renaissance d’Oullins. « Il ne s’agit pas d’une simple histoire à l’eau de rose. The pajama game a une portée sociale forte, tout en jouant la carte de la bonne humeur et en s’appuyant sur l’énergie de la danse et du chant ». Pour contourner l’écueil de références très datées années 1950, Jean Lacornerie a choisi de situer l’action dans le futur. Sur scène, treize interprètes, tour à tour jouant la comédie, chantant… avant de s’installer à l’orchestre. Un pari voulu par le directeur musical, Gérard Lecointe, pour renforcer l’impression de tourbillon. Et ça fonctionne ! Jean-Philippe Joseph
Maison de la Culture de Bourges, les 03 et 04/03. Centre Lyrique Clermont Auvergne – Clermont Ferrand, les 19 et 20/03. Théâtre de Saint-Nazaire, les 01 et 02/04. Opéra de Saint-Etienne, le 08/04.
L’Italie à Tours
Durant cinq jours, du 4 au 8 mars, Tours change de drapeau et se pare du vert-blanc-rouge en l’honneur de nos voisins transalpins et plus particulièrement de leur cinéma toujours plein de vitalité, d’émotion et d’humour. Créé par quelques cinéphiles d’origine italienne, dont Louis d’Orazio qui en est le directeur artistique avec l’appui de Jean A.Gili éminent critique et spécialiste du cinéma transalpin, ce festival a bénéficié des soutiens conjugués de la Cinémathèque, de l’association Henri Langlois, du département italien de l’université et de la Dante Alighieri. Outre les chefs- d’œuvre du répertoire, la programmation veut mettre en valeur le cinéma italien contemporain.
d’œuvre du répertoire, la programmation veut mettre en valeur le cinéma italien contemporain.
Le programme ? 5 films en compétition, 4 films inédits et 3 documentaires qui alterneront avec de nombreux films en hommage à deux grands réalisateurs, Gianni Amélio et Gabriele Salvatores. Ils sont incontournables depuis les années 1990 par l’originalité des thématiques abordées et la maîtrise de leur art. La majorité des films à l’affiche cette année traite de problématiques sociales ou environnementales. « La plupart des cinéastes italiens actuels sont originaires du sud de l’Italie, où les difficultés sont les plus criantes », constate Louis d’Orazio. Nombre d’entre eux participeront à un débat après projection de leur film, un exercice dont le public est très friand. Chantal Langeard