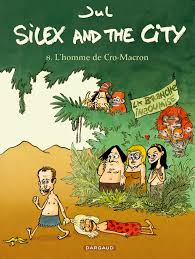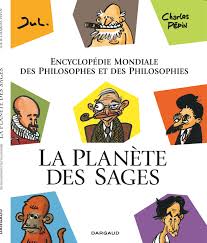J’ai peur du froid !
Aussi, les premières gelées venues, je fais ma valise et me voilà en Afrique !
 Abidjan est une ville merveilleuse : 25° la nuit, 35° le jour… Le kilo de tomates ? 50 cts, avec en plus le sourire de la marchande ! Des corossols à s’en lécher les doigts et cet étourdissant passage de la clim à la torpeur, puis de la torpeur à l’écrasement jusqu’à la prochaine clim… Faut-il avouer que la perversité du post-colonialisme touristique a tout de même du bon ? En fait, ce serait le paradis si, outre la mer qui est parfois agitée, les expatriés ne l’étaient tout autant avec leur soif inextinguible de comprendre ce qui se passe en France :
Abidjan est une ville merveilleuse : 25° la nuit, 35° le jour… Le kilo de tomates ? 50 cts, avec en plus le sourire de la marchande ! Des corossols à s’en lécher les doigts et cet étourdissant passage de la clim à la torpeur, puis de la torpeur à l’écrasement jusqu’à la prochaine clim… Faut-il avouer que la perversité du post-colonialisme touristique a tout de même du bon ? En fait, ce serait le paradis si, outre la mer qui est parfois agitée, les expatriés ne l’étaient tout autant avec leur soif inextinguible de comprendre ce qui se passe en France :
– « Et les gilets jaunes vous en pensez quoi » ?
– « Heu ! En fait, il y a aussi eu une manif des retraités où nous étions… »
– « Oui, mais les gilets jaunes ? »
– « Et puis, une autre manif sur les violences sex… »
– « Oui, mais les gilets jaunes ? »
Impossible d’y échapper ! C’est curieux, cet engouement pour des colifichets ! Avant 68, c’étaient les chaussettes noires, hier les bonnets rouges et aujourd’hui les gilets jaunes… Des sans-culottes aux petits gilets, quel progrès ! Là où nous brandissions des drapeaux, ceux-là préfèrent prendre une veste. Mais, bon, ce n’est pas parce qu’on y comprend rien qu’il faut s’interdire de donner des explications.
« Et bien, voyez-vous en tant que syndicaliste, homme de gauche, humaniste le soir venu, écologiste versatile, certes bedonnant mais cultivé, et retraité nanti qui a foutu le camp pour ne pas avoir à faire tourner sa chaudière au fioul, je dirai, comme le disent également tous les politiciens de Gauche à l’unisson, tant l’unité les étouffe, qu’il faut comprendre la juste colère du peuple : c’est notre boussole, notre Graal ! Le peuple a toujours raison, si tant est qu’on puisse encore définir le peuple comme une catégorie cohérente et sans pour autant perdre de vue l’objectif final, dont on reparlera plus tard, ni céder au populisme et à la récupération. En effet, ne nous y trompons pas : Poujade n’est pas Lénine et on ne peut mettre sur le même plan barrage routier et piquet de grève, ni taxes et profits, ni d’ailleurs comme le font les médias, hit parade et société du spectacle. Vous me suivez toujours ? Sans compter qu’un mouvement ni droite ni gauche, ça ressemble à du Macron comme le gros rouge à la piquette. Cela dit, s’il devait s’avérer que l’homme providentiel soit une femme, là, ça changerait tout ».
En général, l’expatrié s’endort avant la fin du discours, la torpeur vous dis-je !
Mais, vu de l’étranger, on s’aperçoit très vite que la France n’est pas le seul pays où les voitures passent à la pompe ! Ici aussi des gilets jaunes il y en a, mais ils ne les mettent pas, parce qu’il fait trop chaud ! Et puis l’essence est à 0,90 cts le litre, une misère ! En août dernier, le gouvernement a voulu le passer à 1,20 : ce fut l’émeute, barrage, manif, tournoiement de machettes aussi… C’est fissa que le Président a fait marche arrière. En voilà un que la France risque de ne pas aider pour les prochaines élections, s’il s’entête à confondre profit et démocratie.
Ha, j’oubliai : le salaire moyen de l’ivoirien, quand il travaille, est à 200 euros. Alors, faut pas rêver, il n’y a que les riches qui roulent. Et comme les transports en commun laissent à désirer, les pauvres, ils marchent, ils marchent, ils marchent … et ils ne risquent pas de traverser la rue, c’est trop dangereux !
 Mais enfin, la Révolution ne se fera pas sans moi !
Mais enfin, la Révolution ne se fera pas sans moi !
Certes le sable est blanc, les cocotiers penchés, la mer est bleue, le ciel itou et le soleil au zénith mais il y a dix minutes encore, je me morfondais. En France, la Révolution vient de commencer, les macronades n’y pourront rien changer et moi je suis là, inutile, allongé sur ma serviette rouge, à quelques cinq milles kilomètres de l’événement historique dont j’ai toujours rêvé…
Tel Giovanni Drogo attendant les Tartares dans le désert de Buzzati, je guette la Révolution depuis mon enfance : en 62 j’étais à Charonne, sur le boulevard Saint-Germain en 68 et même à la Bastille en 81 (quoi ? tout le monde peut se tromper…) et au moment où toutes et tous s’agitent, manifestent, occupent et se préparent à la grève, moi, je me bats avec les vagues. La honte… Les fesses enduites de crème solaire et la tête dans ma serviette, je pleure. C’est alors que mon fils m’appelle. Je lui dis mon chagrin, mon souhait de revenir au plus vite.
« Mais enfin Papa, tu n’y penses pas ! Pourquoi est-ce qu’on se mobilise ici, si ce n’est dans l’espoir de conserver les acquis de la Libération et qu’un jour on puisse, comme toi, avoir une retraite heureuse ? Papa, par ton exemple, tu es l’incarnation d’un bonheur possible, la preuve vivante que Croizat avait raison. Papa, ne lâche rien, bronze, nage, mange de la langouste ! Tu es notre boussole, tes coups de soleil éclairent le chemin, les lendemains qui chantent c’est toi. Papa, la lutte a besoin de ton bonheur ».
Que mon hâle puisse être une boussole, même en étalant la biafine, je n’osais l’imaginer, moi qui voulais rentrer au risque de saboter le mouvement.
Revigoré, j’ai vite repris mes esprits. Ma conscience de classe est revenue dare-dare, illico j’ai appelé le serveur : « Garçon, remettez-nous ça » ! Décidément, elle commence bien cette révolution.
 Ce matin, je suis rentré d’Afrique, au revoir Abidjan et la Côte d’Ivoire. Histoire de manger quelques huîtres en famille en ce premier jour de l’an… « Moins 2° », annonce le pilote. OK, ça ne fait jamais que 35° de différence !
Ce matin, je suis rentré d’Afrique, au revoir Abidjan et la Côte d’Ivoire. Histoire de manger quelques huîtres en famille en ce premier jour de l’an… « Moins 2° », annonce le pilote. OK, ça ne fait jamais que 35° de différence !
Je hèle un taxi, pas de taxi ! « Ben, faut comprendre, avec les gilets jaunes ils ont peur d’être bloqués ». OK, je prends le RER. Je récupère ma voiture qui, après deux mois sans bouger, met une demi-heure à démarrer. Elle s’y résout dans un nuage de vapeurs toxiques. J’arrive chez moi : 8° dans la maison ! J’enclenche la chaudière, rien… J’appelle le chauffagiste. « Ben, c’est à cause de votre crépinette. Vu que vous n’avez plus assez de fioul dans la cuve, elle n’aspire plus ». OK, je commande du fioul en urgence. « Ben, c’est-à-dire qu’à cause des gilets jaunes le camion a peur d’être bloqué, alors il ne passera pas avant la semaine prochaine ». OK, je vais chercher du bois et avec le bulletin Le Pen que j’avais gardé, vu que j’avais voté Macron pour dénoncer le fascisme et qu’aujourd’hui au lieu de l’extrême droite, j’ai la droite extrême, j’allume le feu. C’est beau, un feu de cheminée ! Je me mets une couverture sur les genoux et j’ouvre la télé. Pas de télé… Un message d’alarme m’informe que les diodes de la résistance du circuit de connexion alimentant la prise antenne sont HS et que ça ne se répare pas ! OK, j’appelle le magasin BUT. Je m’explique, sans tourner autour du pot ni passer par quatre chemins, droit au… Le vendeur m’interrompt, « Bien sûr, on vend des télés mais ne venez pas aujourd’hui, avec les gilets jaunes le centre commercial est bloqué ». « Mais alors, pour les huîtres ? « Ben, c’est bloqué aussi ».
Dans la maison, il fait 12°. Martine a épluché l’un des ananas qu’on a ramené, j’ai rajouté une bûche dans la cheminée, pris une couverture supplémentaire et un livre. J’ai enfilé un gilet jaune, histoire de me tenir chaud. Nous sommes en 2019, bonne année à toutes et tous ! Jacques Aubert