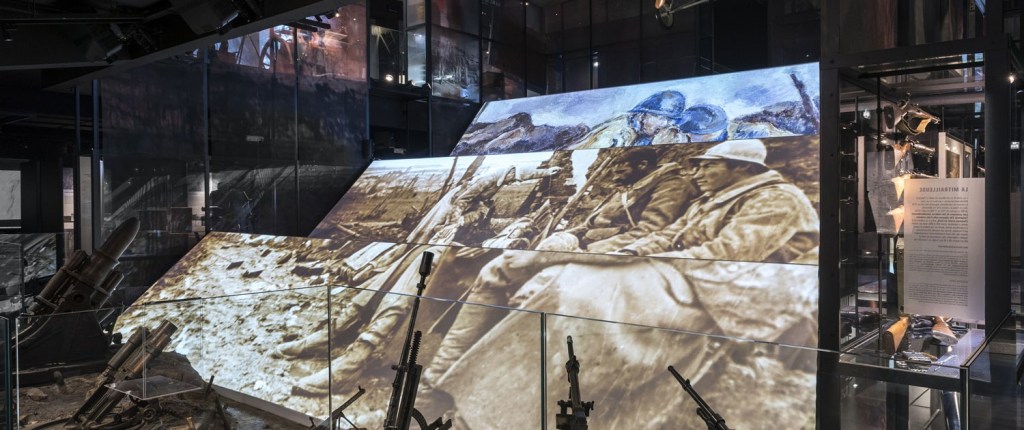Comédienne et cinéaste, Sandrine Dumas a tourné Marilú Marini, Rencontre avec une femme remarquable. Elle l’est, en effet, cette actrice rayonnante filmée à bout touchant, sous le sceau manifeste d’une affection réciproque. Un magnifique portrait, où le modèle évoque son métier comme art de vivre.

Née en Argentine – d’une mère allemande et d’un père italien – Marilú Marini, d’abord danseuse, créait en 1973, à Buenos Aires, le groupe TSE avec Alfredo Arias et quelques autres. Fuyant la dictature militaire, les voici à Paris. Je me rappelle l’enchantement que ce fut, en 1977, que de découvrir Marilú Marini dans les Peines de cœur d’une chatte anglaise, d’après un conte de Balzac, au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis dont René Gonzalez venait de prendre les rênes. Dans le chatoiement des costumes, sous son masque animalier, nous entendîmes pour la première fois sa voix exquise, délicatement caressée par un léger accent d’ailleurs. Avec Arias, il y eut bien d’autres aventures mémorables, mais Marilú Marini fut aussi élue avec ferveur par d’autres metteurs en scène, tant au théâtre qu’au cinéma, en France et dans son pays natal, après qu’elle y est parfois revenue.

Sandrine Dumas filme Marilú Marini à bout touchant, sous le sceau manifeste d’une affection réciproque. Cela donne un portrait extrêmement vivant, où le modèle se révèle spontanément en toute confiance, évoque son métier comme art de vivre. On la voit revenir au pied de la scène au Théâtre Gérard-Philipe à Saint-Denis, où pour elle tout commençait si brillamment en France. On la voit également dans le sous-sol du décor de la pièce Oh les beaux jours, de Beckett, mise en scène d’Arthur Nauzyciel, à l’Odéon, ou encore dans la Femme assise, de Copi, où elle incarnait, en quelques traits en relief, un dessin mobile inénarrable. Du grand rire païen à la tension tragique en passant par l’humour délicieux, le visage de Marilú Marini, au-dessus d’un corps souple, n’affirme-t-il pas l’essence entière du théâtre ?

Il y a surtout qu’elle possède la grâce, cette entité si malaisée à définir, que Peter Brook décelait en elle, lui confiant le rôle d’Ariel, génie des airs, dans la Tempête de Shakespeare. Et ne pas oublier non plus qu’en 2011, sous la direction d’Yves Beaunesne, elle fut éblouissante dans le Récit de la servante Zerline, le texte, si riche d’ambiguïté affective, de l’écrivain autrichien Hermann Broch. Il apparaît nettement que l’année 2024 est l’année Marilú Marini, puisque, en même temps que le film de Sandrine Dumas, sort un livre d’Odile Quirot, Marilú Marini, chroniques franco-argentines. Jean-Pierre Léonardini
– Marilú Marini, rencontre avec une femme remarquable : le film est projeté à Paris dans les salles MK2 Beaubourg, Arlequin, Saint-André-des-Arts, Épée de bois, ainsi qu’à Cavaillon (la Cigale), Hérouville-Saint-Clair (Café des images) et Valence (le Lux).
– Marilú Marini, chroniques franco-argentines, par Odile Quirot (Les Solitaires intempestifs, 160 p., 14,50€).