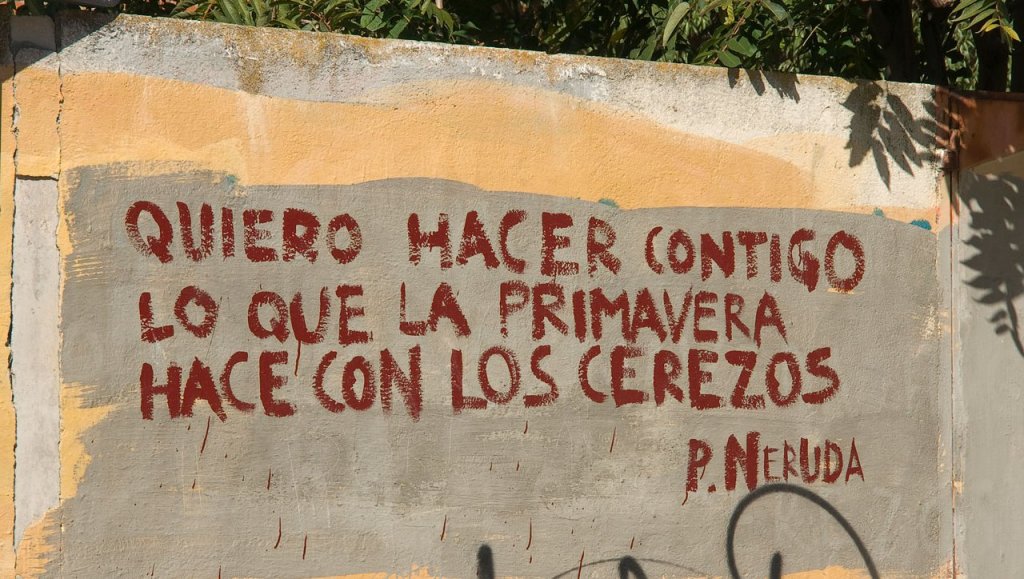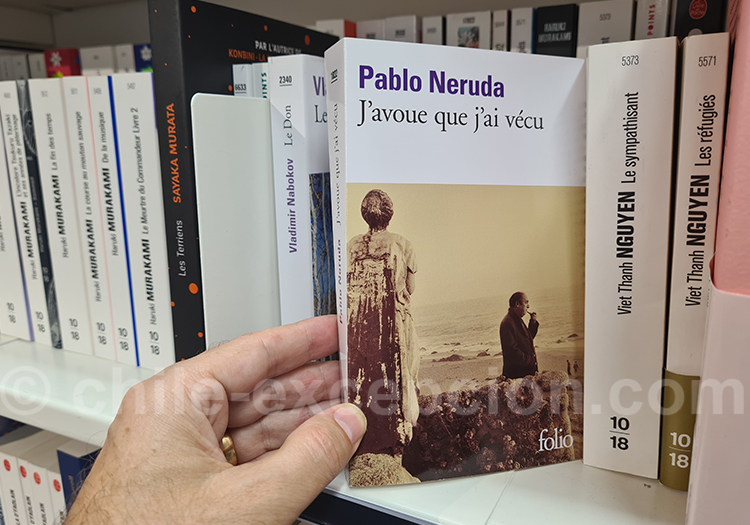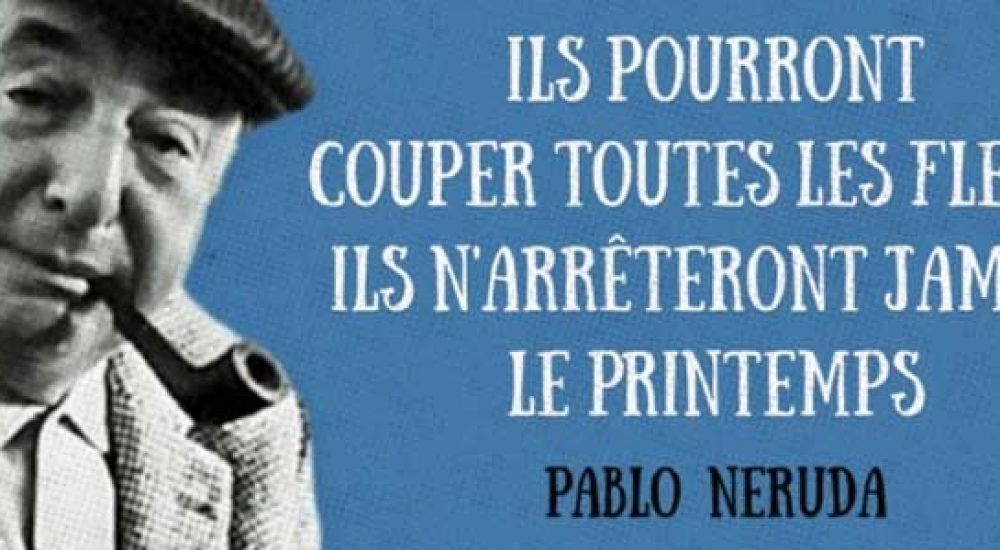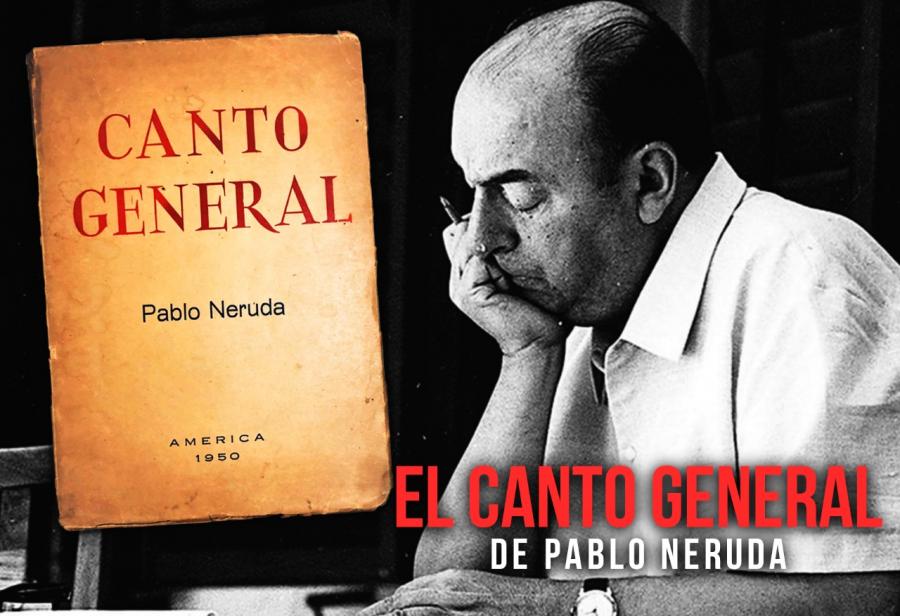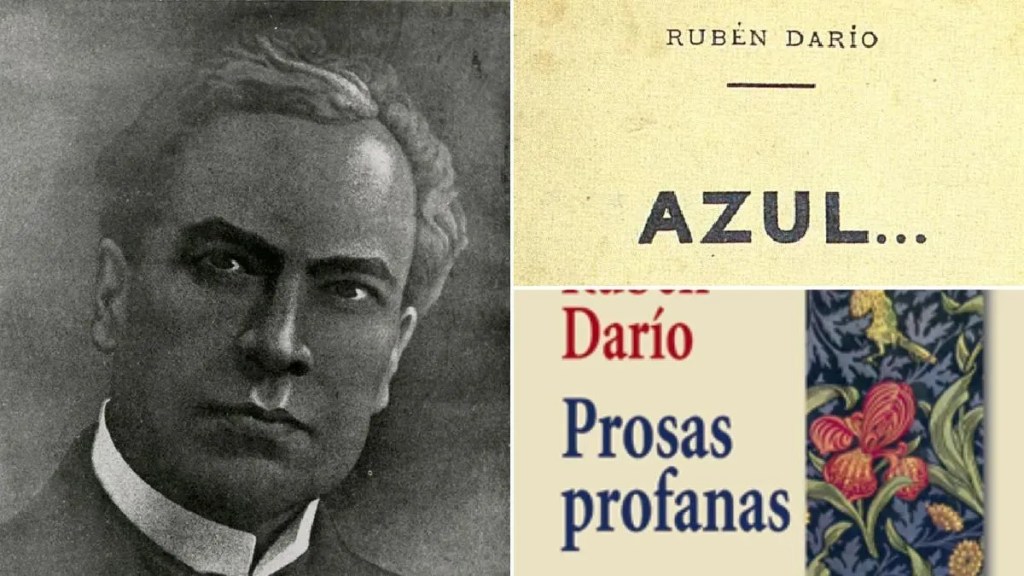Du 14 au 28 octobre à Lyon (69), s’est tenue la 9ème édition du festival international Sens Interdits. Avec un focus Palestine, consacré aux guerres et aux exils, qui a bien eu lieu. En dépit des difficultés des artistes pour circuler, jouer et s’exprimer.

Après le très politique « report », le 11 octobre, de Here I am (Et me voilà), à Choisy-le-Roi (94) « au regard de la situation, et de l’émotion qui étreint toutes les communautés touchées par les événements en Israël et dans la bande de Gaza », le comédien palestinien Ahmed Tobasi a pu jouer la pièce qu’il a créée en 2017 à Bordeaux et ouvrir le focus Palestine du festival Sens interdits à Lyon. Créé en 2009 et dirigé par l’infatigable Patrick Penot, ce festival international s’est construit « autour des notions de mémoire, d’identité et de résistance » et, cette année plus que jamais après la suppression des visas aux artistes sahéliens en septembre – également programmés à Lyon –, il a fallu se battre sur tous les fronts.

On y a vu Losing it, de la chorégraphe et performeuse Samaa Wakim, membre du Yaa Samar ! Dance Theatre (YSDT) fondé par Samar Haddad King à New York, puis en Palestine, qui en signe et interprète la musique. Les deux artistes explorent la peur et transposent la réaction des corps au bruit des balles et des bombardements. Samaa Wakim fait partie du Khashabi Théâtre d’Haïfa, elle était l’une des danseuses du magnifique Milk, de Bashar Murkus, donné au Festival d’Avignon en 2022, à la suite du Musée, l’année précédente, faisant enfin connaître ce théâtre de création qui œuvre à « promouvoir la culture indépendante comme renouvellement de l’identité palestinienne ». Les 27 et 28/10, les Monologues de Gaza auraient dû mettre en jeu et en interaction de jeunes acteurs français avec, en duplex, des auteurs gazaouis devenus adultes, des paroles recueillies par le Ashtar Theatre après l’opération « Plomb durci » de 2008-2009 qui fit plus de 1 400 morts palestiniens, dont de nombreux enfants. Une forme qui tourne depuis quinze ans et se révèle aujourd’hui d’autant plus effroyable qu’il a fallu se confronter à l’absence béante des visages et des voix des Palestiniens de Gaza.

And here I am, mis en mots par l’auteur irakien Hassan Abdulrazzak et en scène par Zoe Lafferty, est le récit autobiographique et kafkaïen d’Ahmed Tobasi, dont la famille a été chassée des territoires de 1948 lors de la Nakba, atterrissant au camp de Jénine. Né en 1984, détenu à tout juste 17 ans durant quatre ans en Israël lors de la deuxième Intifada, Ahmed Tobasi raconte avec détermination et non sans humour les persécutions auxquelles il est confronté. Exilé à Oslo après sa sortie de prison, il y a fait sa formation théâtrale avant de revenir à Jénine, où il vit avec sa famille. Son spectacle est programmé en France jusqu’à fin novembre. Ahmed Tobasi est aussi, depuis 2013, et après l’assassinat de son fondateur, Juliano Mer-Khamis, en 2011, le directeur artistique du Freedom Theatre.

Créé en 2006, le Freedom Theatre, dont l’ADN est l’éducation populaire sous toutes ses formes, à destination des adultes et surtout des enfants, est l’une des plus importantes expériences théâtrales des territoires occupés, « un projet de résistance culturelle utilisant les arts comme outil de libération populaire dans la lutte pour la justice, l’égalité et la liberté », nous dit-il. Sa gestion collective se nourrit de collaborations avec de nombreux artistes étrangers. « Jénine, 14 000 habitants, est le camp le plus attaqué par l’armée israélienne. » En septembre 2023, durant un Festival féministe international, les balles et le bruit des explosions font effraction durant les représentations, en dépit des nombreux invités étrangers. « Les affrontements ont été très violents. L’armée israélienne cherchait vraiment à nous terroriser. Le gouvernement israélien ne veut pas que le monde extérieur témoigne de ce qui se déroule à Jénine ». Lui sait depuis toujours qu’être directeur du Freedom Theatre, « c’est la possibilité d’être tué à tout moment ».
Un tour d’horizon des théâtres palestiniens
Le débat « La scène palestinienne : obstacles, perspectives et luttes », qui s’est déroulé le 22/10, s’est révélé aussi rare que passionnant. Il a permis d’éclairer les conditions d’existence et de résistance de ces artistes qui se revendiquent du mouvement national palestinien. Leur présence en France est d’autant plus nécessaire que « l’on assiste à une répression et à une criminalisation de toute parole de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien », a souligné Olivier Neveux, professeur à l’ENS-Lyon en préambule. Une rencontre en présence d’artistes palestiniens et de Najla Nakhlé-Cerruti, chercheuse au CNRS, dont le travail considérable de documentation et de contextualisation montre « qu’il n’y a pas un théâtre palestinien, mais des théâtres, avec des multitudes de trajectoires et de réalités, qui s’inscrivent dans l’histoire du mouvement national palestinien ». Marina Da Silva
– Focus Palestine (And here I am, Milk, Losing It) : du 21 au 23/11 au Théâtre de la Joliette, à Marseille. And here I am, interprété par Ahmed Tobasi : le 24/11 au Théâtre Alibi de Bastia, le 28/11 au Safran d’Amiens.
– Jusqu’au 19/11, l’Institut du monde arabe présente l’exposition Ce que la Palestine apporte au monde. Un cycle de trois expositions qui met en avant les artistes palestiniens, dans un dialogue avec leurs homologues du monde arabe et la scène internationale. Une programmation culturelle variée, concerts – colloques – ateliers – cinéma – rencontres littéraires, qui donne à voir l’élan et l’irréductible vitalité de la création palestinienne, qu’elle s’élabore dans les territoires ou dans l’exil.