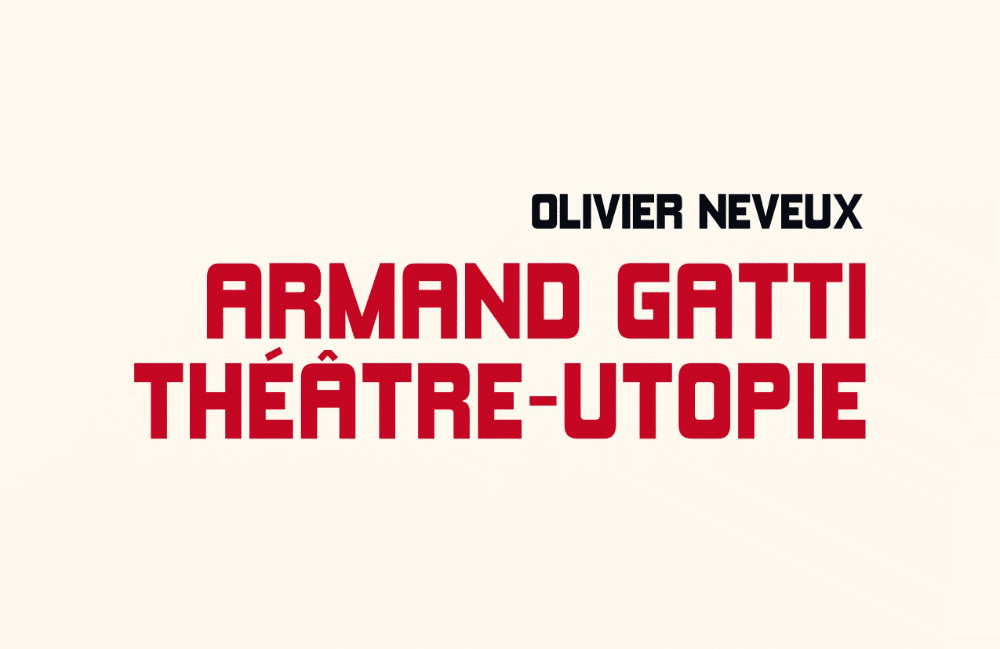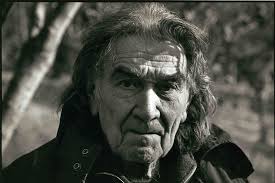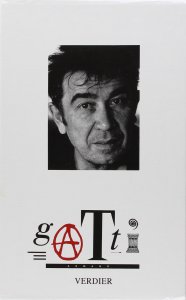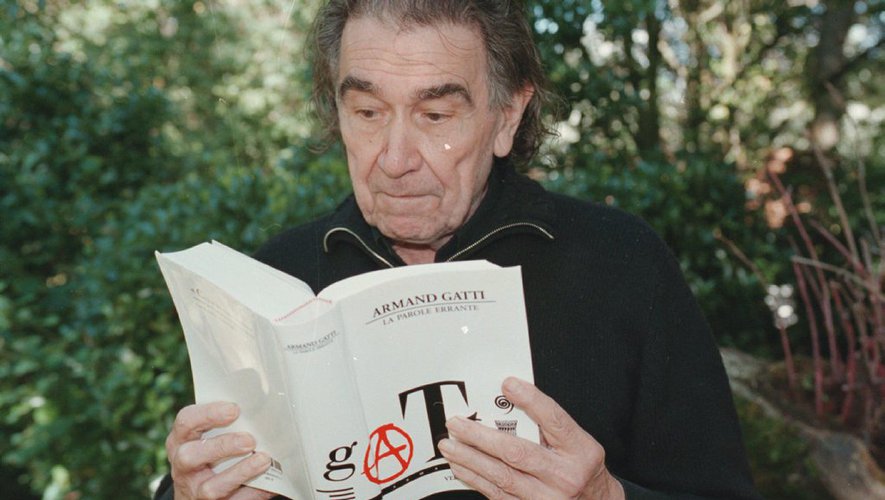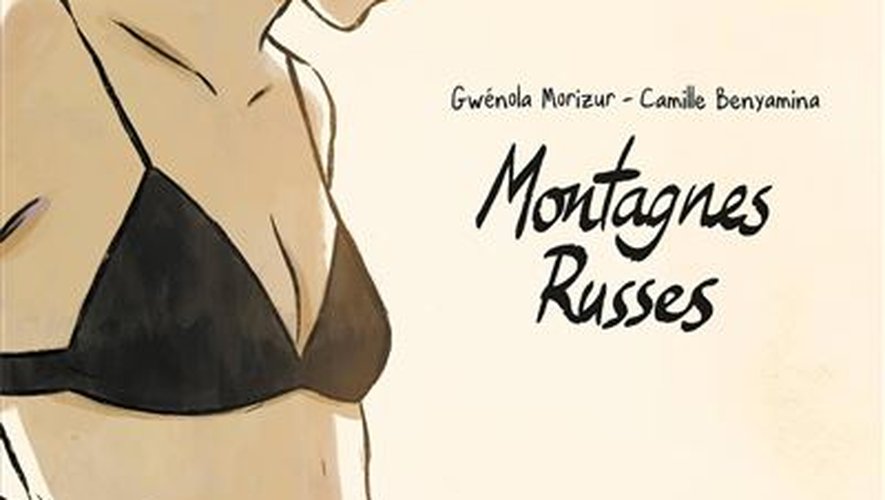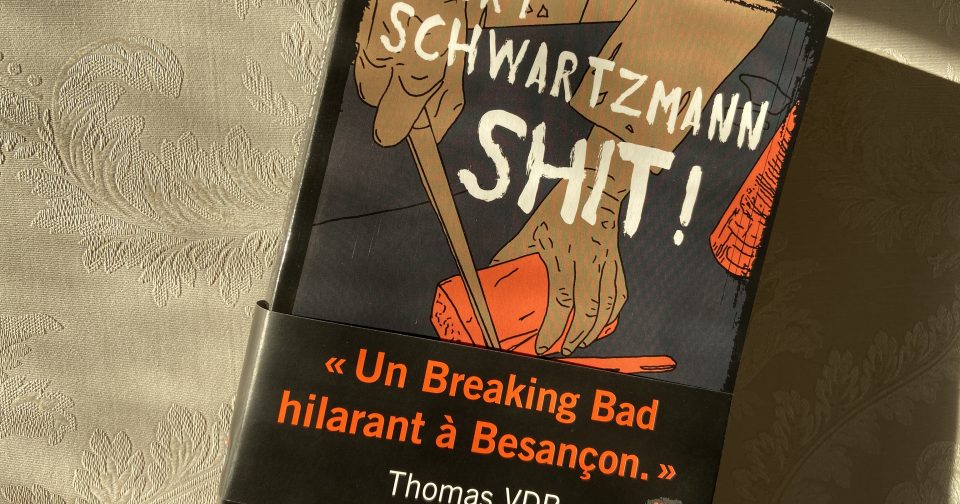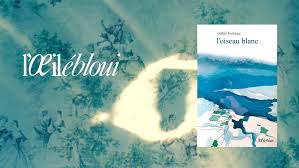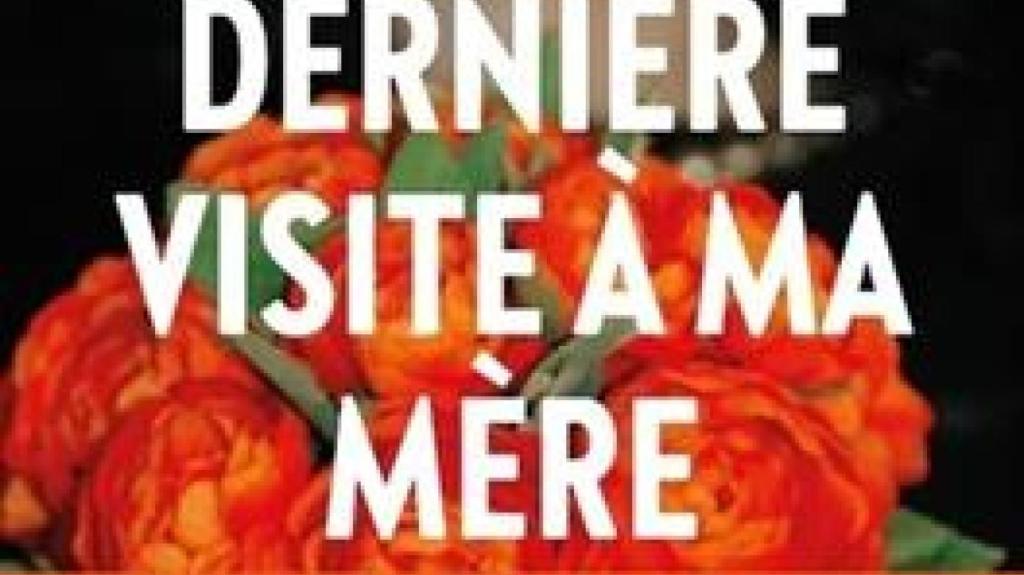En 2024, la France fête les 150 ans de l’impressionnisme. Orchestré notamment par le musée d’Orsay, l’événement met à l’honneur les grandes figures de ce courant pictural, à Paris comme un peu partout en France. Il nous en fait découvrir d’autres, telle la peintre belge Anna Boch au musée de Pont-Aven.

« Les bords du Loing vers Moret » (Sisley, 1883), un « Lavoir à Pontoise » (Pissarro, 1872), « Le déjeuner sur l’herbe » (Manet, 1863), « Les coquelicots » (Monet, 1873), la « Chasse aux papillons » (Morisot, 1874), « Les raboteurs de parquet » (Caillebotte, 1874) « Les repasseuses » (Degas, 1884)… Des images surgissent du passé qui ébranlent encore nos sens à l’évocation des peintres impressionnistes. Et c’était leur volonté. Dès la naissance du courant pictural, ils entendaient être libérés des principes académiques qui hiérarchisaient la peinture : la primauté du dessin sur la couleur, celle des sujets religieux ou mythologiques sur les scènes de la vie quotidienne ou des paysages. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, tout ça vole en éclat quand des artistes s’affranchissent de l’art officiel dicté par le Salon.
Scandale et renversement
L’année 2024 a été choisie pour les saluer parce qu’ils furent une trentaine à inaugurer à Paris, le 15 avril 1874, une exposition indépendante et impressionniste. Le terme, péjoratif, évoqué par un critique d’art à propos du tableau « Impression, soleil levant » de Monet qui y était exposé, désignera le mouvement artistique. Ce dernier était déjà plus ou moins dans les cartons dix ans plus tôt quand des peintres tels Manet créent en 1863 le Salon des refusés, en référence aux œuvres non admises par le Salon officiel. Cela fit grincer bien des dents et des plumes mais le courant était lancé. Aujourd’hui, il est reconnu comme majeur au point de ternir l’art pompier antérieur. « La représentation du monde qui est née de cette révolution est donc devenue évidente – si évidente que le scandale suscité par les œuvres de Manet est lui-même objet d’étonnement sinon de scandale. Autrement dit, on assiste à une sorte de renversement.» Les cours, ardus mais passionnants, du sociologue Pierre Bourdieu au Collège de France en 1998 éclairaient l’aventure (1).

Les célébrations des 150 ans de l’impressionnisme ne manquent ni de panache ni de public. À commencer par « Paris 1874. L’instant impressionniste » jusqu’au 14 juillet 2024 au musée d’Orsay (2). Élaborée avec la National Gallery of Art de Washington qui la présentera à l’automne 2024, l’exposition revient sur l’histoire du mouvement avec environ 130 œuvres dont moult pépites de l’impressionnisme ou de l’art pompier exposées en contrepoint. Technologie oblige, Orsay proposera jusqu’au 11 août une expo virtuelle avec casques à l’appui qui nous mènera dans l’atelier du photographe Nadar, le soir du 15 avril 1874 en compagnie des artistes exposés. Plus concrètement, le musée prête quelque 180 œuvres à 34 institutions un peu partout en France, y compris en Corse ou à la Réunion (3). D’Ajaccio à Amiens, en passant par Giverny, Rouen ou Tourcoing, les visiteurs pourront admirer les tableaux d’impressionnistes, célèbres ou non.
De Bruxelles à Pont Aven
En Bretagne, c’est Anna Boch (1848-1936) qui est à l’honneur au musée de Pont-Aven, jusqu’au 26 mai 2024 (4). Le musée breton s’associe au Mu.ZEE d’Ostende (Belgique) qui a présenté l’exposition l’an passé, pour nous faire découvrir une peintre belge du néo-impressionnisme. Artiste, mélomane, collectionneuse des œuvres de Van Gogh, de Gauguin ou de Signac, Anna peint des paysages notamment de la côte bretonne à couper le souffle, des femmes écrivant ou portant l’ombrelle, des hommes de « Retour de la pêche ». Comme ses homologues français, elle magnifie la couleur comme le quotidien des gens. Membre de La Ligue belge du droit des femmes, elle est la seule à adhérer aux cercles artistiques belges Les XX et La Libre Esthétique.

Elle regrette en 1927, le manque de « peinteresses » au Salon officiel d’art belge à Paris. En attendant, Anna est considérée comme majeure dans le mouvement artistique qui se poursuit. Sacrée voyageuse aussi, Anna Boch part en Grèce, en Sicile, en Algérie ou en Espagne. Avec son frère Eugène, peintre également, elle découvre dès 1901 la Bretagne, du nord au sud. Raison de plus pour que le musée de Pont-Aven fête l’artiste qui déclarait à 81 ans : « Il faut rester dans le train pour garder sa jeunesse ». Prenons-le pour aller la saluer ! Amélie Meffre
(1) Manet, une révolution symbolique, de Pierre Bourdieu (Le Seuil, 784 p., 32€).
(2) Paris 1874. L’instant impressionniste, jusqu’au 14/07/24 au musée d’Orsay.
(3) Voir le programme sur le site du ministère de la Culture.
(4) Anna Boch, un voyage impressionniste, au musée de Pont-Aven jusqu’au 26/05/24.