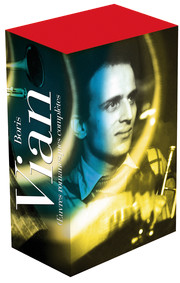Dans les colonnes de L’Obs en date du 22 mars, Erri De Luca, l’un de nos plus grands auteurs contemporains d’origine italienne, répond aux questions de notre confrère François Armanet. Disponible sur les réseaux sociaux, Chantiers de culture se réjouit de pouvoir partager cet article.
En ces temps de confinement, à (re)lire, acheter ou télécharger : écrivain, poète, dramaturge et traducteur, Erri De Luca, né à Naples en 1950, a publié une œuvre importante, dont Montedidio (prix Femina étranger, 2002). Tous ses livres sont disponibles chez Gallimard.
Son dernier texte est paru dans la collection Gallimard Tracts de crise, entièrement gratuite sur le web : Le samedi de la terre.
François Armanet – Comment vivez-vous cette épidémie ?
Erri De Luca – J’habite dans une maison de campagne au nord de Rome, entourée de champs. Je suis rentré chez moi de la montagne depuis dix jours et je suis largement autosuffisant. J’ai un bon entraînement à l’isolement. Je mène ma vie normale, je me lève très tôt, je lis et je traduis de l’hébreu ancien, pas plus de deux versets par jour, j’en suis aux chapitres sur la vie du prophète Elie. Je relis des livres d’un autre temps, notamment ceux de l’écrivain yiddish Sholem Aleichem qui me soulage avec son humour. J’ai du temps pour faire des exercices utiles à l’escalade, je passe la moitié de la journée au grand air. Le soir, j’allume un feu dans la cheminée et je me cuisine un plat. J’ai l’impression un peu inconsciente que rien ne me manque. Alors, quand j’ai ce sentiment, je me souviens des gens qui ont habité ici, de mes parents qui étaient venus vivre avec moi dans cette campagne et je les entends alors me reprocher mon égoïsme. Je revois tous ces visages disparus autour de la table et je réalise que je me trompe. Mais venons à la question de ce que j’appelle « état de siège » plutôt que « guerre ». Les restrictions m’ont aidé à prendre conscience de la gravité de l’épidémie pour mes concitoyens, même si je crois être dans une

Photo Daniel Maunaury/DR
forteresse inexpugnable par le virus.
F.A. – Que vous ont apporté les expériences de votre vie – engagements politiques, vie d’ouvrier et de manœuvre itinérant, ascèse, courses en haute montagne – pour affronter cette épreuve ?
E.D-L. – La vie ouvrière m’a appris la discipline, le respect des horaires, la gestion des énergies, en plus d’une habileté manuelle. J’ai une vocation à me taire, à passer des jours totalement muet, et si j’ai envie d’écouter une voix, je chante. Vous l’appelez « épreuve », c’est juste et évident pour la majorité des gens, mais pour moi il s’agit d’une réclusion volontaire, parmi celles que je me suis déjà imposées. Chaque jour est singulier, avec ses petites variations, ses fantaisies, les nouvelles formes de la lutte acharnée d’un peuple entier. Je reste à la marge dans ce temps d’exception où l’ordre du jour est le sauvetage. Je regrette seulement de ne pas être médecin.
F.A. – Comment jugez-vous la situation italienne et l’action du gouvernement ?
E.D-L. – J’assiste à un changement tel que l’on pourrait parler d’une conversion, au sens matériel et spirituel du terme. Sa majesté l’Économie a été détrônée, elle n’est plus l’obsession prioritaire. Au premier rang, il y a la défense de la vie humaine, pure et simple, qui met tous les citoyens sur le même plan, parce que nous sommes tous exposés au même danger. La santé publique, la sécurité des citoyens, un droit égal pour tous, est l’unique et impératif mot d’ordre. Les gouvernements ne sont plus polarisés sur le budget et la finance, mais s’occupent des hôpitaux. Les fonds soustraits à la santé publique reviennent en force. L’autorité majeure, c’est le médecin, plus le banquier. Je reconnais en ce brusque bouleversement les chrismes d’une conversion. J’apprécie les mesures adoptées par le gouvernement italien, tout d’abord peu entendues par les pays de l’Union, puis successivement imitées. Même ceux qui niaient l’évidence ont dû revenir sur leur légèreté face aux pertes considérables en vies humaines. Cela change le rapport entre l’État et des citoyens qui se sentent pour la première fois l’objet d’une attention privilégiée de l’action politique. Et les nationalistes, les souverainistes autoproclamés, qui, cette fois-ci, ne peuvent même pas accuser de tous les maux le Sud de l’Italie, car

Photo Daniel Maunaury/DR
l’épidémie s’est concentrée dans les régions du Nord, se retrouvent sans arguments.
F.A. – Voyez-vous dans les mesures sécuritaires des atteintes aux libertés ?
E.D-L. – Je vois des restrictions justifiées par les risques mortels. Pendant la guerre, il y avait le couvre-feu nocturne, il fallait mettre des toiles noires aux fenêtres pour rendre plus difficiles les bombardements aériens. On a maintenant un couvre-feu diurne mais avec la possibilité de faire les achats indispensables. Les magasins sont ouverts, les denrées bien présentes. C’est une suspension de la mobilité, pas encore une atteinte à la liberté qui reste celle de pouvoir exprimer les opinions, les convictions, les croyances.
F.A. – Y aura-t-il un avant et un après cette épidémie ?
E.D-L. – Je ne me risquerai pas à la prophétie, mon impression est que l’on recommencera comme avant, avec la même compulsion, l’idolâtrie de l’économie, et l’accumulation comme horizon suprême de la vie humaine. Il pourra rester le sentiment d’une période de trêve obtenue par la planète, une espèce d’année sabbatique, avec le ciel plus ouvert, les eaux plus propres et un silence qui donnait le vertige. Un temps d’arrêt qui produit des signes de réanimation du milieu ambiant, qui redonne des couleurs aux éléments. Les pneumonies qui suffoquent les malades sont un paradigme de la Terre suffoquée par l’expansion humaine. Il faut redonner à la planète de l’air et de l’aide. Cette période illustre terriblement notre indifférence aux changements climatiques. Le virus est un des effets collatéraux de notre  occupation, le virus, c’est nous. Apprendra-t-on à être le vaccin de nous-mêmes ? Je ne vivrai pas assez longtemps pour le voir.
occupation, le virus, c’est nous. Apprendra-t-on à être le vaccin de nous-mêmes ? Je ne vivrai pas assez longtemps pour le voir.
F.A. – Y a-t-il des raisons d’espérer en davantage de solidarité et de fraternité ?
E.D-L. – Dans les états d’urgence les personnes révèlent des énergies insoupçonnées, redécouvrent l’entraide, la disponibilité à se charger des plus faibles, comme dans les naufrages où la priorité du sauvetage va aux femmes et aux enfants. Dans les moments de détresse, l’humanité donne le meilleur et aussi le pire de soi-même. On est soulagé de constater les innombrables actes de générosité et d’exposition volontaire au danger pour de la solidarité. Ce n’est pas de la bonté, c’est l’ancienne méthode de survie du genre humain : faire chaîne commune, se serrer pour se défendre. Mais remiser les barricades du chacun pour soi.
F.A. – Vous avez la passion des livres depuis l’enfance. Quelles lectures conseilleriez-vous aujourd’hui pour affronter l’épidémie et la solitude ?
E.D-L. – Conseiller un livre, c’est imprudent, c’est comme conseiller une rencontre, une invitation à entrer dans l’intimité d’autrui. Les chefs-d’œuvre, comme Vie et Destin du russe Vassili Grossman, seraient de bons compagnons de retraite. Je préfère lire aujourd’hui des histoires qui me déplacent de mon époque. Je viens de lire un traité de Cicéron, De la nature des dieux, une  confrontation d’anthologie sur les divinités du monde préchrétien.
confrontation d’anthologie sur les divinités du monde préchrétien.
F.A. – Non-croyant, vous êtes un lecteur quotidien de la Bible et vous avez appris l’hébreu ancien pour mieux la comprendre (et la traduire). Que peut-elle nous enseigner en ce moment ?
E.D-L. – Les livres en général ne sont ni des maîtres ni des médecins. Un écrivain disait qu’un livre n’est pas le remède ni la thérapie, il est la douleur. Les livres tiennent compagnie et améliorent notre propre vocabulaire de lecteur. Dans le cas de l’Ancien Testament, je me suis intéressé à son format original en hébreu ancien pour remonter à la source du formidable exploit théologique qu’a été le monothéisme. Il est aujourd’hui le socle de notre tradition religieuse, mais sa conception était la suprême hérésie, la prétention d’un Dieu qui prétendait renverser tous les autres autels. Je voulais lire dans sa langue une histoire où la parole n’est pas simplement un outil de la communication, mais a la force et la responsabilité de créer le monde, de le produire du néant à travers les mots de la divinité. « Vaiòmer », dit-il : et ensuite le monde fut. Je reste sidéré par la puissance de ce langage et je lis l’Ancien Testament à tous mes réveils depuis la moitié de ma vie. Elle est devenue une  habitude physique, mon ouverture du temps qu’on appelle, par simplification, jour.
habitude physique, mon ouverture du temps qu’on appelle, par simplification, jour.
F.A. – Vous êtes un ardent défenseur des migrants. Cette crise ne les laisse-t-elle pas encore davantage sur le bas-côté, avec les plus démunis ?
E.D-L. – Ce repliement défensif laisse les migrants encore plus seuls. Dans le canal de Sicile, plus aucun bateau de sauvetage n’est présent, toutes les missions sont suspendues. Quelques embarcations réussissent pourtant à rejoindre Lampedusa. L’écrasante urgence de s’échapper de la Libye ne connaît pas de trêve. Les migrants, y compris mères et enfants, affrontent la mort par naufrage comme un mal mineur. Quand l’instinct maternel, le plus fort instinct de protection, est mis à l’écart, je sais que la force majeure à l’œuvre n’est pas l’espoir mais le désespoir. Dans L’Énéide, Virgile fait dire à Énée : « Le seul sauvetage pour des vaincus est de n’avoir aucun espoir de se sauver. » C’est le désespoir total qui libère des forces forcenées, qui rendent aveugles et indifférents à tout péril et risque. Même l’espoir minime d’une aide extérieure diminue l’énergie de survie. Aucun contemporain de ces odyssées ne

Photo Daniel Maunaury/DR
devrait rester insensible à tant de courage.
F.A. – On célèbre l’héroïsme des soignants. Mais n’oublie-t-on pas celui des travailleurs grâce à qui la vie ne s’arrête pas ?
E.D-L. – Ces travailleurs ajoutent à leur dure routine quotidienne un esprit de mission et de service à la communauté dans des conditions d’exposition au risque permanentes. Sur eux s’appuie le poids de la subsistance et du ravitaillement de l’essentiel pour soutenir l’état de siège. Tous ceux auxquels on ne peut serrer la main permettent à une société de survivre. Parce que dorénavant chacun de nous est tenu de se considérer comme un survivant qui exprime sa gratitude. Propos recueillis par François Armanet
 Sur Racine (1965) de Roland Barthes. De l’eau a passé sous les ponts.
Sur Racine (1965) de Roland Barthes. De l’eau a passé sous les ponts. et de Quintilien » (Jérôme Lecompte), « Racine devant les tragiques grecs » (Katsuya Nagamori), « Simplicité de Racine » (Jean -Yves Vialleton), « La querelle des Anciens et des Modernes » (Larry F. Norman), « Racine et la troupe de Molière » (entretien avec Georges Forestier), « Du côté de la comédie » (Charles Mazouer), « Sorties finales chez Racine » (Michael Hawcroft), « L’art de défaillir » (Jennifer Tamas), « Racine et ses livres » (Alain Riffaud), « Racine, Louis XIV et le revers des médailles » (Christian Biet), « Madame de Maintenon et Racine » (Anne Piéjus), « Racine à Saint-Cyr » (Rainer Zaiser), « Les feux de Pyrrhus » (Michel Delon) et « Un durable emportement » (entretien avec Olivier Barbarant). En prime, le cahier de création et les chroniques habituelles. Jean-Pierre Léonardini
et de Quintilien » (Jérôme Lecompte), « Racine devant les tragiques grecs » (Katsuya Nagamori), « Simplicité de Racine » (Jean -Yves Vialleton), « La querelle des Anciens et des Modernes » (Larry F. Norman), « Racine et la troupe de Molière » (entretien avec Georges Forestier), « Du côté de la comédie » (Charles Mazouer), « Sorties finales chez Racine » (Michael Hawcroft), « L’art de défaillir » (Jennifer Tamas), « Racine et ses livres » (Alain Riffaud), « Racine, Louis XIV et le revers des médailles » (Christian Biet), « Madame de Maintenon et Racine » (Anne Piéjus), « Racine à Saint-Cyr » (Rainer Zaiser), « Les feux de Pyrrhus » (Michel Delon) et « Un durable emportement » (entretien avec Olivier Barbarant). En prime, le cahier de création et les chroniques habituelles. Jean-Pierre Léonardini