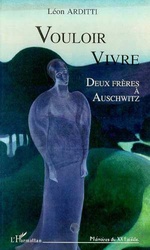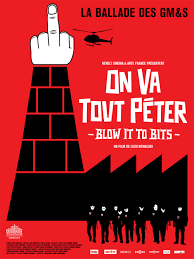En ces jours d’été, Chantiers de culture vous propose sa sélection de livres. De Pierre Lemaitre à Sigriour Hagalin Björnsdottir, de Léon Arditti à Véronique Mougin, de Barnabé Laye à Philippe Gitton. Pour, au final, plonger dans la saga de Roslund/Hellström ou déguster le dernier opus du regretté Andrea Camilleri… Bonne lecture !
Couronné du prix Goncourt en 2013 pour Au revoir là-haut, Pierre Lemaître poursuit sa saga de l’après-guerre avec la publication du deuxième volet de sa  trilogie. Couleurs de l’incendie s’ouvre en cette année 1927 par les funérailles de Marcel Péricourt, le puissant patron d’un immense empire financier. La bourgeoisie d’alors, comme à son habitude au lendemain de toute catastrophe nationale, a su tirer profit du conflit de 14-18, accumuler les intérêts de l’effort de guerre et faire fructifier la manne financière de la reconstruction… Édouard le fils s’étant suicidé dans le tome précédent, c’est donc sa sœur Madeleine qui hérite du magot. Une situation originale, déjà, dans le contexte d’alors : une femme à la tête d’une grosse banque ! Le second intérêt de ce roman fleuve ? Outre une intrigue à rebondissements menée de main de maître, la chute et la re-naissance de l’héritière (Lemaître n’a point abandonné son coup de plume affiné dans l’exercice du roman noir), avec la justesse historique qu’il sied en pareilles circonstances il nous place avec ravissement et talent aux premières loges de la crise financière de 1929 et dans les premières lueurs de l’incendie qui va bientôt embraser l’Europe. Boursicotage, évasion fiscale, magouilles politiciennes et presse aux ordres, l’histoire bégaye à défaut de se
trilogie. Couleurs de l’incendie s’ouvre en cette année 1927 par les funérailles de Marcel Péricourt, le puissant patron d’un immense empire financier. La bourgeoisie d’alors, comme à son habitude au lendemain de toute catastrophe nationale, a su tirer profit du conflit de 14-18, accumuler les intérêts de l’effort de guerre et faire fructifier la manne financière de la reconstruction… Édouard le fils s’étant suicidé dans le tome précédent, c’est donc sa sœur Madeleine qui hérite du magot. Une situation originale, déjà, dans le contexte d’alors : une femme à la tête d’une grosse banque ! Le second intérêt de ce roman fleuve ? Outre une intrigue à rebondissements menée de main de maître, la chute et la re-naissance de l’héritière (Lemaître n’a point abandonné son coup de plume affiné dans l’exercice du roman noir), avec la justesse historique qu’il sied en pareilles circonstances il nous place avec ravissement et talent aux premières loges de la crise financière de 1929 et dans les premières lueurs de l’incendie qui va bientôt embraser l’Europe. Boursicotage, évasion fiscale, magouilles politiciennes et presse aux ordres, l’histoire bégaye à défaut de se  répéter. Plus qu’un gros roman de plus de 600 pages, un grand roman à l’écriture flamboyante.
répéter. Plus qu’un gros roman de plus de 600 pages, un grand roman à l’écriture flamboyante.
Et il est encore question de crise et d’incendie humanitaire dans L’île, le premier roman de la journaliste islandaise Sigriour Hagalin Björnsdottir ! Une catastrophe inattendue à l’heure où l’Islande se retrouve coupée et isolée de toute communication extérieure, internet-radio-téléphone-télévision… Comment vivre, et surtout survivre, dans un pays dépendant désormais de ses seules ressources et capacités ? Comment assurer le quotidien d’une population livrée à elle-même ? Un climat angoissant auquel tente de répondre un gouvernement de crise qui glisse progressivement vers une politique d’exclusion et d’apartheid : préférence nationale, chasse à l’étranger, milices privées et sélection dans l’approvisionnement… Un roman de politique-fiction où fraternité et solidarité sont mises à mal, où la haine l’emporte sur l’amour de l’autre, où les instincts les plus bas sèment la terreur et la mort. Une parabole angoissante sur l’avenir de l’humanité, d’un petit fjord à notre grande planète.
Des cinq membres d’une même famille embarqués eux-aussi dans une 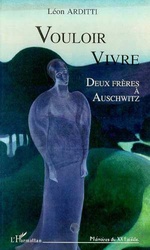 innommable catastrophe humanitaire, la plus terrifiante du siècle dernier, seuls deux survivront. Deux frères, Oscar et Léon, déportés au camp de la mort d’Auschwitz… Hôtel Excelsior, Nice, en ce 13 décembre 1943 il ne fait pas bon d’être juif ! De cette date jusqu’à ce 11 avril 1945 où un soldat américain lui offre la cigarette de la liberté, non sans détails sur les horreurs quotidiennes, Léon Arditti conte avec pudeur l’impérieuse nécessité qui l’anime de rester homme au cœur de l’inhumanité absolue. Vouloir vivre s’impose comme un incontournable témoignage sur la capacité de chacune et chacun à résister à une barbarie sans nom lorsque les fumées des chambre à gaz noircissent le ciel et que pendent aux cordes sur la place du camp les corps des condamnés du jour… Le retour d’un voyage en enfer qui, paradoxalement, ravive une lueur d’espoir pour
innommable catastrophe humanitaire, la plus terrifiante du siècle dernier, seuls deux survivront. Deux frères, Oscar et Léon, déportés au camp de la mort d’Auschwitz… Hôtel Excelsior, Nice, en ce 13 décembre 1943 il ne fait pas bon d’être juif ! De cette date jusqu’à ce 11 avril 1945 où un soldat américain lui offre la cigarette de la liberté, non sans détails sur les horreurs quotidiennes, Léon Arditti conte avec pudeur l’impérieuse nécessité qui l’anime de rester homme au cœur de l’inhumanité absolue. Vouloir vivre s’impose comme un incontournable témoignage sur la capacité de chacune et chacun à résister à une barbarie sans nom lorsque les fumées des chambre à gaz noircissent le ciel et que pendent aux cordes sur la place du camp les corps des condamnés du jour… Le retour d’un voyage en enfer qui, paradoxalement, ravive une lueur d’espoir pour  les générations futures qui refusent de céder aux sirènes de l’obscurantisme et du populisme.
les générations futures qui refusent de céder aux sirènes de l’obscurantisme et du populisme.
Une histoire vraie à rapprocher de celle de Tomi qui, dans l’enfance, se refuse obstinément à exercer le métier de tailleur, celui de son père ! Dans sa Hongrie natale, gamin, il préfère grimper aux arbres et mater les filles… Jusqu’à ce jour de 1944 où il connaîtra la déportation et l’enfer des camps (Auschwitz, Birkenau, Buchenwald, Dora, Bergen Belsen…) à l’âge de 14 ans. Comment survivre au plus sombre de l’apocalypse ? En se déclarant tailleur à la face des SS, lui qui n’y connaît rien à l’étoffe des héros, et en raccommodant les pyjamas de ses compères déportés… Une vie qui ne tient qu’à un fil, pour devenir à la Libération le grand nom d’une haute maison de couture ! Un parcours presque incroyable que celui de ce jeune cousin d’alors dont Véronique Mougin, une auteure familière aux lecteurs de Chantiers de culture, nous conte l’épopée avec tendresse et humour à l’heure la plus sombre des atrocités ! Où passe l’aiguille ne cultive pas l’esprit de ressentiment, l’auteure nous gratifie d’un roman où l’insouciance et l’espoir s’affichent à chaque page, comme la joie d’être encore vivant longtemps après.
Comme l’horreur est la mieux partagée au monde, nous poursuivons notre périple littéraire. Sur un autre continent, l’Afrique, et à une autre époque, au  temps de l’esclavage… Nous sommes à la Cour d’Abomey, capitale du Dahomey, sous le règne du jeune roi Guézo. Qui confie au jeune Timothée une mission de la plus haute importance : ramener au pays la reine-mère, vendue comme esclave au Brésil suite à de sombres guerres intestines ! Le chant des cannes à sucre, plus qu’un roman d’aventures, est un hymne à la terre patrie, ses pistes couleur ocre et sa culture ancestrale. Une prise de conscience, en cette année 1822, de l’inanité de l’esclavage qui enrichit les colons européens coulant des jours heureux à Ouidah, ultime étape pour les populations indigènes embarquées en des contrées hostiles, une révélation pour le jeune matelot qui rejette cette économie de l’asservissement au nom de l’amour de sa belle. Au pays natal du vaudou, Barnabé Laye, béninois d’origine, cultive une plume qui caracole de vague en vague avec chatoyance, plongeant son lecteur dans les chaleurs et la torpeur de
temps de l’esclavage… Nous sommes à la Cour d’Abomey, capitale du Dahomey, sous le règne du jeune roi Guézo. Qui confie au jeune Timothée une mission de la plus haute importance : ramener au pays la reine-mère, vendue comme esclave au Brésil suite à de sombres guerres intestines ! Le chant des cannes à sucre, plus qu’un roman d’aventures, est un hymne à la terre patrie, ses pistes couleur ocre et sa culture ancestrale. Une prise de conscience, en cette année 1822, de l’inanité de l’esclavage qui enrichit les colons européens coulant des jours heureux à Ouidah, ultime étape pour les populations indigènes embarquées en des contrées hostiles, une révélation pour le jeune matelot qui rejette cette économie de l’asservissement au nom de l’amour de sa belle. Au pays natal du vaudou, Barnabé Laye, béninois d’origine, cultive une plume qui caracole de vague en vague avec chatoyance, plongeant son lecteur dans les chaleurs et la torpeur de  l’Afrique profonde, une plume aux mille couleurs et senteurs loin de la traditionnelle carte postale.
l’Afrique profonde, une plume aux mille couleurs et senteurs loin de la traditionnelle carte postale.
Des couleurs, senteurs et saveurs dont Philippe Gitton se fait aussi conteur et passeur… Au pas de notre porte, au cœur de ce 18ème arrondissement de Paris dont il a arpenté rues et places durant de longues années ! Du haut de sa tour HLM, il a scruté, noté avec patience et tendresse la vie de ces gens de peu pour qui les mots fraternité et solidarité trouvent toujours sens. Pour publier enfin son premier recueil de nouvelles, À chacun sa croix*, dont les lecteurs de Chantiers de culture avaient reçu quelques primeurs… Un volume de vingt histoires courtes pour donner à voir et entendre le quotidien de cet atypique quartier de Paris, multicolore et multiforme, petit coin de paradis ou d’enfer selon les heures du jour. Un don d’observation de premier ordre, la justesse du trait pour affiner un portrait, la finesse de la plume hors tout effet littéraire, autant de qualités à confirmer lors d’une prochaine publication.
Et de quitter le Paris populaire pour plonger à en perdre haleine dans une saga en trois gros volumes dont on ne ressort pas indemne… Au cœur des services  secrets suédois, dans les pas de l’agent Piet Hoffmann, l’homme le plus recherché de la planète ! Trois secondes, Trois minutes, Trois heures : trois romans, dont les deux premiers surgis de la plume du duo Roslund/Hellstrom, qui nous content les tribulations d’un homme infiltré dans la mafia polonaise puis colombienne avant qu’au retour du Niger, où il a passé contrat avec un réseau de trafiquants, il découvre soixante-trois réfugiés morts dans un container sur les quais du port de Stockholm. Outre les magouilles, intrigues et chausse-trappes entre services secrets concurrents, cette saga originale a le mérite de nous transporter dans toutes ces contrées maudites, hauts lieux du blanchiment d’argent et de la traite humaine, dont l’actualité rend si peu souvent compte. Une opacité que les auteurs percent au grand jour, des complicités institutionnelles aux pots de vin coutumiers, sous une forme romanesque de belle envolée. Le roman noir de l’été, la saga dont le lecteur, vacancier ou non, ne peut se
secrets suédois, dans les pas de l’agent Piet Hoffmann, l’homme le plus recherché de la planète ! Trois secondes, Trois minutes, Trois heures : trois romans, dont les deux premiers surgis de la plume du duo Roslund/Hellstrom, qui nous content les tribulations d’un homme infiltré dans la mafia polonaise puis colombienne avant qu’au retour du Niger, où il a passé contrat avec un réseau de trafiquants, il découvre soixante-trois réfugiés morts dans un container sur les quais du port de Stockholm. Outre les magouilles, intrigues et chausse-trappes entre services secrets concurrents, cette saga originale a le mérite de nous transporter dans toutes ces contrées maudites, hauts lieux du blanchiment d’argent et de la traite humaine, dont l’actualité rend si peu souvent compte. Une opacité que les auteurs percent au grand jour, des complicités institutionnelles aux pots de vin coutumiers, sous une forme romanesque de belle envolée. Le roman noir de l’été, la saga dont le lecteur, vacancier ou non, ne peut se  détacher, sinon de mort violente à cause d’une balle perdue !
détacher, sinon de mort violente à cause d’une balle perdue !
Maître du roman noir, père du célèbre commissaire Montalbano dont il a narré les enquêtes en moult ouvrages, mais aussi homme de théâtre et scénariste, l’auteur d’origine sicilienne Andrea Camilleri nous a quittés en ce mois de juillet. Un auteur prolifique dans tous les domaines littéraires, orfèvre en la ciselure d’une intrigue policière ou romanesque, créateur émérite d’une langue qui mêlait avec intelligence et poésie l’italien classique et le parler sicilien de ses origines. Camilleri nous offre à titre posthume Noli me tangere (Ne me touche pas, ndlr), son ultime roman paru en France. Un ouvrage de facture originale, dont nous tairons le secret de composition, qui nous dresse le portrait, aussi émouvant qu’attachant, d’une femme éprise de liberté et fascinée par la fresque de Fra Angelico au titre éponyme. Sous les pas de Laura, mystérieusement disparue mais semant quelques adresses tout au long de son périple, s’égrène une étrange musique entre révolte et nostalgie, douceur d’être et pulsion de mort. Un court roman pour une fulgurante illumination. Yonnel Liégeois
*À commander : Librairie Coeur de Brenne, 4 rue du pont Malientras, 36290 Mézières-en-Brenne. Courriel : karen.mahoudeau@gmail.com
 poétique du Verbe se conjugue avec élégance et harmonie avec la plainte langoureuse de l’accordéon. Yonnel Liégeois
poétique du Verbe se conjugue avec élégance et harmonie avec la plainte langoureuse de l’accordéon. Yonnel Liégeois