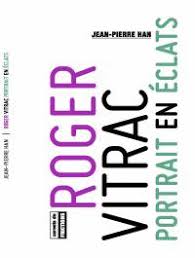Aux États-Unis en 1929, paraît Moisson rouge, le premier roman de Dashiell Hammett. En 1949, Marcel Duhamel édite La clé de verre à la célèbre Série Noire. En ce début juin 2019, sort une nouvelle édition du Faucon de Malte (« Le faucon maltais » au cinéma, de John Huston avec Humphrey Bogart), dans la traduction de Natalie Beunat. L’auteur de romans noirs, et créateur du genre, fut aussi l’une des victimes du maccarthysme.
Département d’État, 24 et 26 mars 1953, double comparution devant la commission sénatoriale des opérations gouvernementales présidée par le sénateur Joseph McCarthy. « J’invoque mes droits garantis par le Cinquième amendement de la Constitution américaine, je refuse de répondre car la réponse pourrait me porter préjudice », plaide Dashiell Hammett au fil des interrogatoires auquel il est soumis. Face à ses juges, un homme élégant et digne qui se refuse à toute compromission, victime de « la chasse aux sorcières » ouverte depuis 1946 par le président Truman. Ses livres sont retirés des bibliothèques et, comme le rappelle fort justement Natalie Beunat, l’auteur de la nouvelle traduction des romans de Hammet chez Gallimard, « il faudra l’intervention personnelle du Président Eisenhower, déclarant que les romans de  Dashiell Hammett ne lui semblaient pas constituer une menace subversive, pour qu’ils soient réintégrés dans les rayonnages ».
Dashiell Hammett ne lui semblaient pas constituer une menace subversive, pour qu’ils soient réintégrés dans les rayonnages ».
Déjà, le 9 juillet 1951, le romancier américain est convoqué une première fois devant la Cour d’Appel du Second District de New York. L’accusation lui reproche d’avoir présidé aux destinées du Civil Rights Congress (CRC) en 1946, une organisation d’inspiration communiste très active dans la défense des droits des citoyens. Le CRC avait constitué un fonds de cautionnement destiné à faire libérer les militants arrêtés pour raisons politiques. C’est depuis la fin des années 30 qu’Hammett est devenu un activiste politique de premier plan au côté de Dos Passos et de Dorothy Parker : participation à des meetings anti-nazis, prises de position en faveur de l’Union Soviétique. Joignant le geste à la parole, à 48 ans, il s’engage comme simple soldat pour soutenir l’effort de guerre contre le fascisme ! Démobilisé en 1945, c’est l’année suivante qu’il est donc élu président du CRC. Devant les questions du juge Sylvester Ryan, Hammett demeure imperturbable, refuse de coopérer et de lâcher des noms : il est condamné à six mois de  prison, une peine qu’il effectuera sans sourciller en dépit de graves soucis de santé…
prison, une peine qu’il effectuera sans sourciller en dépit de graves soucis de santé…
Cette sombre page de l’histoire américaine, communément appelée « Peur rouge » ou maccarthysme, s’étend officiellement sur quatre ans, selon l’historienne et spécialiste Marie-France Toinet : de l’apparition du sénateur Joseph McCarthy en 1950 sur le devant de la scène politique jusqu’au vote de censure contre lui en 1954. L’expression recouvre cependant une période beaucoup plus longue, si l’on englobe l’ensemble des années où la répression contre le communisme battit son plein. Depuis 1946 en fait, voire 1938 lorsque la Chambre des représentants créa la HUAC (House Un-American Activities Committee), la commission sur les activités anti-américaines… Depuis cette date, le FBI enquête et constitue des dossiers sur les organisations et les hommes politiques suspectés de sympathie communiste. Avec cette volonté acharnée et hystérique, selon l’historienne, « de casser intellectuellement la dissidence, de transformer les communistes voire les simples progressistes en exilés de l’intérieur, sans existence sociale et sans droits parce que différents ». Au lendemain de la seconde guerre mondiale, en pleine « guerre froide », l’acharnement redouble. En 1947, la HUAC étend ses investigations au coeur d’Hollywood, supposé repère de réalisateurs et scénaristes «communistes » ! Au nombre d’entre eux, un certain Bertolt Brecht qui  est entendu par la HUAC le 30 octobre 1947 et quitte pour toujours les États-Unis le jour même…
est entendu par la HUAC le 30 octobre 1947 et quitte pour toujours les États-Unis le jour même…
Des dix-neuf scénaristes et producteurs initialement fichés, onze d’entre eux sont convoqués devant la HUAC. Si Brecht a déclaré devant la Cour ne pas être communiste avant de fuir l’Amérique, les dix autres invoquent le 1er Amendement de la Constitution américaine et refusent de répondre aux questions. Inculpés d’outrage par le Congrès, ils sont condamnés à la prison : six mois fermes pour Biberman et Dmytryk, un an pour les autres… De cette liste rouge des « Dix de Hollywood », suit un mois plus tard une « liste noire ». Celle des artistes, communistes ou non, interdits désormais de travail : Charlie Chaplin, Orson Welles, Jules Dassin et Joseph Losey qui se réfugient plus tard en Europe ! Certains cèdent sous la pression, tel Elia Kazan qui tourne « Sur les quais » en guise d’excuse, d’autres non, tel Arthur Miller qui réalisera « Les  sorcières de Salem » en 1953 et « Vu du pont » en 1955 pour saluer les résistants à l’inquisition.
sorcières de Salem » en 1953 et « Vu du pont » en 1955 pour saluer les résistants à l’inquisition.
Les campagnes de dénigrement sont redoutables de violence mais elles atteignent leur paroxysme en février 1950 lorsque le très conservateur sénateur McCarthy prononce son fameux discours de Wheeling. Plus que tout autre, outre de se révéler un alcoolique invétéré, il voit « rouge » partout et dénonce à la tribune l’infiltration communiste dans tous les rouages de l’administration, jusqu’au Département d’État ! Avec la complicité du FBI et de son patron Hoover, il prétend détenir des listes de noms suspects et propose au président Truman de lui communiquer. Des allégations mensongères bien sûr, mais qui suffiront à répandre soupçon et délation, d’autant que les époux Rosenberg sont arrêtés en juillet 1950, accusés d’espionnage en faveur de l’Union Soviétique, condamnés à mort et exécutés sur la chaise électrique le 19 juin 1953… Durant quatre ans, McCarthy et les juges à sa solde n’en finiront donc pas d’alimenter la suspicion et de convoquer personnalités et simples citoyens devant leur fameuse commission, véritable tribunal d’exception. Au total, selon certaines sources, ils seront pas moins de 26 000 employés de  l’administration fédérale à faire l’objet d’enquêtes approfondies : 7000 seront contraints à la démission, 739 révoqués.
l’administration fédérale à faire l’objet d’enquêtes approfondies : 7000 seront contraints à la démission, 739 révoqués.
Comme le rappelle Natalie Beunat dans Dashiell Hammet, parcours d’une œuvre, les questions de McCarthy à l’époque sont très précises et ciblées : « était-il membre du parti communiste quand il a écrit La moisson Rouge, ses droits d’auteur ont-ils servi à alimenter les caisses du parti ? ». Il en ira de même pour chaque suspect. Au point qu’Albert Einstein lui-même s’élèvera contre ce véritable climat de terreur, « minant le caractère démocratique de notre société ». En 1954, les attaques de McCarthy contre l’armée lui sont fatales. Le Sénat américain nomme à son tour une commission pour statuer sur son cas. Blâmé par ses pairs, désavoué enfin par l’opinion publique et les media, il sombre dans l’alcoolisme et meurt en 1957 dans l’indifférence générale.
Une question demeure, cependant : au vu de faits récurrents qui jalonnent l’histoire des États-Unis, d’hier jusqu’à nos jours sous l’ère Trump, l’Amérique a-t-elle vraiment exorcisé tous les démons de la manipulation et du mensonge ? Yonnel Liégeois
En savoir plus
– La chasse aux sorcières : le maccarthysme (1947-1957), par Marie-France Toinet (Editions Complexe, 206 p., 7€90)
– Interrogatoires : les trois comparutions d’Hammett, traduites par Natalie Beunat (Editions Allia, 95 p., 3€)
– Dashiell Hammett, parcours d’une œuvre, par Natalie Beunat (Encrage éditions, 127 p., 9€)
Chronologie
27/05/1894 : naissance de Hammett à Saint Mary’s County, dans le Maryland
1929 : publication de Moisson Rouge, en 1930 du Faucon de Malte
1947 : condamnation des « Dix de Hollywood » et publication d’une liste noire
09/02/1950 : discours du sénateur républicain McCarthy à Wheeling
09/07/1951 : premier interrogatoire de Dashiell Hammett à New York
1952 : nomination de McCarthy à la sous-commission d’enquête du Sénat
1953 : exécution des époux Rosenberg pour espionnage en faveur de l’URSS
10/01/1961 : mort de Hammett. Enterré au cimetière national d’Arlington
Noir, c’est noir
« Hammett est, par excellence, l’homme des paradoxes », souligne Natalie Beunat, « d’une élégance raffinée mais un alcoolique invétéré, un grand romancier qui cesse mystérieusement d’écrire à l’âge de 40 ans et au sommet de sa gloire ».
Il est surtout celui qui pose les bases du roman noir américain avec Moisson Rouge, son premier livre publié en 1929 : un coup d’essai, un coup de maître ! L’ancien détective de l’agence Pinkerton, pour la première fois, « introduit le réel et la vraisemblance dans la littérature policière. Moisson Rouge est un grand livre politique, le roman du capitalisme sauvage et triomphant ». Le vrai boulot du détective, chez Hammett ? « Entre l’être et le paraître, faire émerger le mensonge et la société du spectacle. Hammett est cohérent avec sa façon de vivre et sa façon de créer une figure littéraire : toujours se  tenir droit et debout. Chez lui, c’est une vraie posture politique ».
tenir droit et debout. Chez lui, c’est une vraie posture politique ».
Grande prêtresse de Hammett, Natalie Beunat est avant tout celle qui rend sens et rythme à la langue du romancier américain. En signant une nouvelle traduction, somptueuse et dépouillée de l’argot parisien des années 40, de cinq de ses romans… Du grand art, vraiment un plaisir de lecture renouvelé.
À lire : Dashiell Hammett, romans (Moisson Rouge, Sang Maudit, Le faucon maltais, La clé de verre, L’introuvable) dans la nouvelle traduction intégrale de Natalie Beunat (Quarto Gallimard, 1064 p., 28€50). Moisson rouge est disponible aussi en Série Noire, Le faucon maltais et autres romans en collection Folio, chez le même éditeur. Dashiell Hammett, mon père, par sa fille Jo Hammet (Rivages/Noir, 191 p., 7€50. Traduction Natalie Beunat).
 la Coupe du monde…
la Coupe du monde… discrimination sexiste.
discrimination sexiste. courir, à rester en retrait et à perdre en motricité.
courir, à rester en retrait et à perdre en motricité.