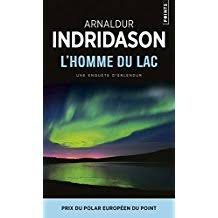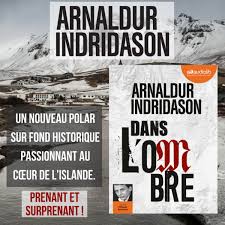En présence de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, fut inaugurée le 16 octobre la nouvelle Comédie de Saint-Étienne, place Jean Dasté. À l’heure du 70ème anniversaire de la décentralisation théâtrale, un événement majeur que la renaissance d’un outil culturel au service d’un public avide de richesses et découvertes scéniques.
Sur le plateau de la grande scène, la bande de garçons et filles salue le public. Salve d’applaudissements, salle comble. Sous la houlette du patron des lieux, Arnaud Meunier, les élèves du lycée Etienne Mimard ont rendu une copie parfaite ! Comme leurs jeunes collègues du collège Gambetta, en levée de rideau… Deux spectacles amateurs encadrés par des comédiens professionnels, « L’homme libre » de Fabrice Melquiot et « Nous sommes plus grands que notre temps » de François Bégaudeau, parmi les cinq projets artistiques à l’affiche confiés à la crème des auteurs et metteurs en scène contemporains, une réussite totale lors de ces trois semaines de représentations gratuites ouvertes à la population stéphanoise, en prélude à l’inauguration officielle de la Comédie en cette mi-octobre 2017. Pour que le public découvre et s’approprie les nouveaux lieux, ce magnifique temple des planches érigé sur la cathédrale de fer que fut l’antique Société Stéphanoise des Constructions  Mécaniques : un symbole fort, le mariage de la matière et de l’esprit, rouges peintures et rideau rouge, l’alliance des travailleurs et des bateleurs, tous créateurs en leur spécifique humanité.
Mécaniques : un symbole fort, le mariage de la matière et de l’esprit, rouges peintures et rideau rouge, l’alliance des travailleurs et des bateleurs, tous créateurs en leur spécifique humanité.
Jean Dasté, le pionnier et défricheur, doit s’en féliciter et s’esclaffer de plaisir dans les cintres de sa divine Comédie ! C’est lui qui, en 1947 à l’aube de la décentralisation théâtrale initiée par Jeanne Laurent, plantait les premiers tréteaux au pays de l’or noir et, sillonnant villages et campagnes, allumait des étincelles de bonheur dans les yeux de tous ces gens de peu : en témoignent dans l’album « Le théâtre de ceux qui voient », toujours aussi émouvantes au regard, les superbes photographies d’Ito Josué. « Quelle beauté, quel miracle, quel mystère réussissent à remplir ces visages, ces corps d’épouvante, de jouissance, de terreur, d’effroi, de plaisir ? », s’interroge l’héritier et compagnon de route Jean-Louis Hourdin. « Les photos saisissent la beauté des êtres, dans le temps même de la représentation, au moment où ils ne s’appartiennent plus, où, libres, ils créent, avec les acteurs, une nouvelle communauté des hommes ». Pour qui croit au ciel et celui qui n’y croit pas, pour l’un qui scande son adresse au dieu  comme pour l’autre qui se refuse à tutoyer la divinité, ainsi que l’énonce avec pertinence et talent l’écrivain Erri de Luca, c’est le miracle du spectacle vivant toujours renouvelé !
comme pour l’autre qui se refuse à tutoyer la divinité, ainsi que l’énonce avec pertinence et talent l’écrivain Erri de Luca, c’est le miracle du spectacle vivant toujours renouvelé !
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, à l’heure de la reconstruction quand les crédits si chichement comptés se dirigeaient essentiellement vers l’investissement économique et industriel, des hommes et des femmes osèrent mettre la culture au devant de la scène, une priorité à égalité avec d’autres ! Dans l’esprit nouveau insufflé par le Conseil national de la résistance, ce fut le pari d’une femme exceptionnelle, Jeanne Laurent, alors fonctionnaire au ministère de l’Éducation nationale, bien avant que le Général concède un ministère de la Culture à André Malraux : irriguer le territoire d’outils susceptibles de propager la bonne parole au cœur des villes et campagnes, s’appuyer sur les talents qui fleurissent déjà en ces contrées. En 1946, la Comédie de l’Est voit le jour à Colmar, suivent la Comédie de Saint-Étienne en 1947, le Grenier de Toulouse en 1948, le Centre dramatique de l’Ouest en 1949, la Comédie de Provence en 1952… Le réseau des centres dramatiques nationaux est né (trente-huit à ce jour). Fondateur du TNP (le Théâtre National Populaire) puis du Festival d’Avignon, Jean Vilar n’avait eu de cesse d’affirmer que le théâtre est un service public qui doit rejoindre l’ensemble des citoyens « au même titre que l’eau, le gaz et l’électricité » ! Après l’inauguration des premières Maisons de la culture en 1961 sous l’égide de Malraux, est créé en 1990 le label « Scène nationale », 71 au total tant en France métropolitaine qu’en Outre-Mer. La mission commune de tous ces lieux, selon leur statut et budget ? Faire exister la création et la culture hors la capitale, se donner les moyens de rejoindre et rassembler tous les publics avec priorité en direction des couches sociales éloignées des institutions  culturelles ou privées des codes d’accès, partager outil et moyens de la structure avec les artistes et compagnies du cru.
culturelles ou privées des codes d’accès, partager outil et moyens de la structure avec les artistes et compagnies du cru.
Une mission initiée en 1947 par Jean Dasté dont Arnaud Meunier, le talentueux metteur en scène et directeur des lieux depuis 2011, s’enorgueillit de poursuivre. Fier d’hériter, sept décennies plus tard, de ce superbe écrin avec ses deux salles (700 et 300 places), ses grands espaces et studios de travail dévolus aux élèves de l’École supérieure d’Art dramatique, ses moyens techniques ultra-performants, son monumental hall d’accueil du public… « La Comédie de Saint-Étienne est forte de son histoire, en quittant la rue Loubet pour le quartier de la Plaine Achille, elle n’a rien perdu de son âme », souligne le jeune directeur. « La maison demeure tournée vers la création et les auteurs vivants, elle poursuit et développe son travail de sensibilisation avec les jeunes des lycées et collèges, elle n’abandonnera surtout pas son immersion dans les quartiers populaires et sa présence dans des lieux de représentation qui touchent un public fort éloigné du théâtre ». Et de l’affirmer haut et fort, « La Comédie de Saint-Étienne est l’un des théâtres les plus populaires de France » ! Qui est parvenue à presque doubler son taux de fréquentation en une petite décennie, qui consacre
92% de son budget au bénéfice des compagnies locales et artistes du cru, qui bâtit les 2/3 de sa programmation en leur faveur… « Nous sommes la génération de la télévision, nous nous devons d’être ouverts et attentifs aux nouvelles générations ».
Une évidence s’impose aussi, la patte ou la griffe, le souffle que le patron des lieux est parvenu à distiller dans tous les recoins de la maison, administratif-technique ou artistique. Un besoin presque viscéral de partager ses convictions, par tous les moyens « rendre vivant le théâtre populaire », briser les clichés entre les publics, faire du théâtre un lieu chaleureux, convivial, accueillant… Et d’ajouter, ce dont l’homme fera silence par modestie et discrétion, la qualité des spectacles (Chapitres de la chute, Saga des Lehman Brothers qui obtient le Grand prix du Syndicat de la critique en 2014, Le retour au désert, Je crois en un seul dieu…) qu’il met en scène : remarqués et salués par la critique, recommandés et applaudis sans modération par le public des salles parisiennes ou autres ! Arnaud Meunier ? Pas un homme d’appareil ni un banal faiseur de spectacles, un authentique militant de la culture qui ne craint pas d’écrire en majuscules le mot « combat » pour la défendre. « Avec d’autres, je suis et demeure un militant au service d’un idéal, d’un imaginaire ». Une belle et forte profession de foi à l’ouverture d’une saison stéphanoise qui prend forme dans un nouveau décor, du vert au rouge ! Yonnel Liégeois
De Los Angeles à Saint-Étienne
Des petits « Frenchies » en Californie ? Ce n’est pas un conte à la Walt Disney, mais la réalité : une dizaine d’élèves de l’école d’art dramatique de Saint-Étienne ont rejoint leurs collègues de CalArts, la réputée école d’art de Los Angeles fondée en 1971 par la veuve du célèbre réalisateur ! Pour répéter ensemble, sous la conduite d’Arnaud Meunier, une pièce qu’ils donneront en février 2018 sur les planches de la Comédie… Un texte écrit par l’auteure noire-américaine Aleshea Harris, « Fore ! » (un terme de golf qui veut dire « attention balle ! », ndlr) qui dénonce autant le racisme ambiant aux États-Unis que l’accession au pouvoir, sous les traits de Trump, d’une classe sociale blanche et riche. En dépit des différences culturelles entre jeunes Français et Américains, un projet artistique qui semble enthousiasmer les élèves de chaque coté de l’océan, suscite autant l’interrogation que la jubilation du public stéphanois dans l’attente du lever de rideau !