Les rapports qu’entretiennent l’activité artistique et l’entreprise industrielle ou commerciale, et donc la « société du travail », connaissent aujourd’hui une acuité nouvelle. Un séminaire, intitulé Art&Mondes du travail, fut organisé sous l’égide du ministère de la Culture d’avril à novembre 2015.
Au fil des cinq séances, les participants (directions d’entreprise, entrepreneurs, comités d’entreprises, syndicats,  associations culturelles ouvrières territoriales, artistes, chercheurs en sciences du travail) ont confronté leurs réflexions et leurs expériences, mesuré les évolutions, débattu de l’ampleur des enjeux et défis.
associations culturelles ouvrières territoriales, artistes, chercheurs en sciences du travail) ont confronté leurs réflexions et leurs expériences, mesuré les évolutions, débattu de l’ampleur des enjeux et défis.
En mars 2017, une publication au titre éponyme (disponible auprès de la Direction de la création artistique – service des arts plastiques ((MCC) : jean-yves.bobe@culture.gouv.fr) a rendu compte de ces travaux.
Au fil des semaines, Chantiers de culture proposera à l’attention de ses lecteurs plusieurs de ces contributions. Seconde livraison : la suite et fin du texte de Jean-Pierre Burdin, consultant « Artravail-s », dans une version légèrement remaniée. Yonnel Liégeois
L’ENTREPRISE, UN NOUVEAU TERRITOIRE DE L’ART
Dépassant la seule problématique d’accès aux œuvres du patrimoine ou contemporaines, de nouvelles démarches artistiques à l’entreprise se sont affirmées depuis le début des années 1980 (1). Considérant l’entreprise comme une ressource essentielle pour appréhender et explorer la complexité du monde, des artistes cherchent à croiser et à confronter leur création aux valeurs/croyances, aux formes, aux pratiques, aux « matérialités » des mondes du travail. Ils sont maintenant nombreux à penser leurs démarches artistiques dans de multiples disciplines, souvent conjuguées, non seulement au sein de l’entreprise mais avec l’entreprise et les hommes et les femmes qui la composent, y produisent, y interprètent leur travail. C’est ainsi, comme « naturellement », qu’ils recherchent des partenaires médiateurs associatifs, privés ou publics, pour mettre en place de tels dispositifs de résidences. Faire de  l’entreprise un « nouveau territoire de l’art » ne relève pas de l’évidence. Dissiper des confusions, lever des contradictions demande courage, clairvoyance, patience, ingéniosité, détermination et conviction. Cela nécessite de casser des représentations, de renouveler des schèmes de pensées. Pour tous les protagonistes.
l’entreprise un « nouveau territoire de l’art » ne relève pas de l’évidence. Dissiper des confusions, lever des contradictions demande courage, clairvoyance, patience, ingéniosité, détermination et conviction. Cela nécessite de casser des représentations, de renouveler des schèmes de pensées. Pour tous les protagonistes.
Les expositions « Et voilà le travail ! » (Aix-en-Provence, 2007), « Usine » (Paris, 2000), « (Be)au boulot ! » (Paris, 2012) et d’autres manifestations ont témoigné de l’émergence, puis de la multiplication de telles démarches artistiques et de leurs pertinences. Les comptes-rendus de chacune des séances du séminaire montrent bien que d’autres modalités, d’autres protocoles différents s’affirment : ils dépassent mais n’annulent pas ceux qui cherchaient initialement à permettre l’accès à l’art, à soutenir une occupation d’usine, à instruire, à initier et éclairer en exposant des œuvres dans les locaux sociaux, à recevoir soutien et commande. En 2008, la première Biennale d’art contemporain de Rennes s’inscrivait dans cette dynamique en proposant plusieurs résidences (2). Organisé en 2013 par le Centre de culture populaire de Saint-Nazaire, le colloque national « Art et travail, culture et entreprise : nouveaux horizons ! » témoignait de

Le travail, selon Fernand Léger
l’engagement hardi d’organismes et d’associations du monde du travail à poser ainsi une alternative à la seule consommation massive de produits culturels proposés par un marché qui a pris son essor fin des années 1960.
Le travail, terra incognita à explorer
Toutes les sphères de notre société connaissent des transformations. Le salariat, dans sa diversité professionnelle et hiérarchique, est pris dans leurs rets. Elles touchent son identité, sa composition organique, sa représentation, sa culture, son rapport à la société entière. Surtout, elles affectent, au-delà de ses conditions d’exercice, le travail lui-même, la « tâche ». Le travail, son activité et ses métiers, est profondément brouillé, empoisonné, comme mis en incapacité « d’exister ». Bref, la culture même du travail est en question. Il faut la « manifester » à nouveau, la concevoir à nouveaux frais, la sortir réellement de là où l’enferme la seule vision étroite et ressassée de la souffrance, qui tend à replier sa compréhension sur la seule étymologie latine de « tripalium ». Cette définition fait oublier que le travail devrait être, qu’il est d’abord et toujours un peu résolution, force, affirmation de soi, puissance d’agir, refus du sort, invention, attention et confrontation au réel. Ce dont il pâtit, c’est tout bonnement de ne pas être émancipé et, comme le souligne Yves Clot, d’être « empêché ». C’est peut-être là que l’art peut nous aider pour approcher cette terra incognita qu’est l’activité de travail. L’art, qui est d’ailleurs lui-même un travail, peut nous armer

Nicolas Frize, la musique in situ
en pensée pour explorer cette boite noire : il réveille la perception, l’approche critique, instruit le jugement, la dispute. Il permet de « lire », dans les contradictions du réel, des richesses que nous ne savons voir sans lui.
Qu’est-ce que travailler, si ce n’est s’inscrire dans la transformation du monde et de soi ? Il s’agit d’habiter le monde. Et l’homme n’habite le monde qu’en le faisant. Et peut-être, enfin, ne l’habite-t-il véritablement que poétiquement (Hölderlin). Il apparaît dès lors inconcevable, profondément injuste et au fond inefficace, que l’activité de travail dans son exercice-même, sur son temps et son lieu, soit écartée de la réflexion sensible, du monde des formes et des représentions. La déperdition est préjudiciable pour le travail, pour l’entreprise collective qu’il est, pour les sphères artistiques et pour la cité elle-même. Dangereuse, car lorsque aucune proposition artistique n’épouse la société du travail, c’est le travail lui-même qui est exilé du

« Ateliers », menuiserie Riaux, Bazouge-la-Pérouse. *Co Cédric Martigny
mouvement de la société, de la cité. Il est alors le trou noir de la démocratie. On touche là une limite de la démocratisation culturelle telle qu’elle a été menée de façon assez consensuelle, et pourtant non sans succès, depuis le lendemain de la guerre en 1945.
Tout appelle aujourd’hui à ce que le travail concoure à la composition d’une démocratie culturelle, qu’il entre en culture commune. « On ne saurait donc penser la liberté dans la Cité sans la penser d’abord dans le travail. Toute cité est d’abord une cité du travail et elle n’est vraiment libre que si elle permet à ses membres d’éprouver leur liberté dans le travail », nous dit Alain Supiot dans sa belle introduction à La cité du travail, le livre de Bruno Trentin. Tout le contraire de Metropolis. Jean-Pierre Burdin
(1) Différentes rencontres nationales et rapports témoignent de ces évolutions : « Pour la culture dans l’entreprise, rapport au ministre de la Culture », par Pierre Belleville (La documentation française, 1982). « Création et monde du travail, actes des rencontres nationales de la création et du monde du travail », par Luc Carton, Jean-Christophe Bailly, Nicolas Frize, Michèle Perrot, Michel Verret (Maison de La Villette, octobre 1993). « Culture et monde du travail », par Claude Goulois (Enquête commandée par l’IRES et le ministère de la Culture et de la Communication, 2000).
(2) « Valeurs croisées. Les ateliers de Rennes-Biennale d’art contemporain » (Les presses du réel, 2009).
*La photographie de Cédric Martigny est extraite de la superbe manifestation « Usimages », un parcours de douze expositions réparties sur l’agglomération de Creil, qui se déroule jusqu’au 04/06/17.
 établissements culturels sans exception et d’annoncer une date de revoyure dans un calendrier raisonnable : musées, salles de cinéma et salles de spectacles doivent être ouverts dans un même tempo.
établissements culturels sans exception et d’annoncer une date de revoyure dans un calendrier raisonnable : musées, salles de cinéma et salles de spectacles doivent être ouverts dans un même tempo. la circulation du virus dans les territoires, et ainsi garantir les meilleures conditions d’accueil des publics et des professionnels.
la circulation du virus dans les territoires, et ainsi garantir les meilleures conditions d’accueil des publics et des professionnels.











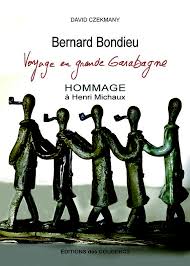





































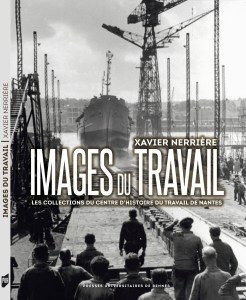


















 Un étonnant voyage aujourd’hui dans le paysage urbain de la ville de Sevran (93), hier de surprenants paysages industriels colorés ou de fantomatiques hommes en fuite vers un ailleurs, Michel Séméniako transfigure la réalité au moyen de ses multiples faisceaux lumineux projetés sur tel ou tel élément, au gré de ses torches graphiques et de son imaginaire. Tel un peintre réinventant et découpant le réel pour donner à voir son expérience du monde où les temps de pose se comptent parfois en heures… « Mon travail se veut invitation à nous réapproprier notre propre regard, loin de ceux-là programmés et standardisés qui nous privent de l’expérience du monde et en abolissent même le désir. Pour que chacun puisse se dire : moi-aussi, j’ai pouvoir de repeindre le monde en couleurs ! » Yonnel Liégeois
Un étonnant voyage aujourd’hui dans le paysage urbain de la ville de Sevran (93), hier de surprenants paysages industriels colorés ou de fantomatiques hommes en fuite vers un ailleurs, Michel Séméniako transfigure la réalité au moyen de ses multiples faisceaux lumineux projetés sur tel ou tel élément, au gré de ses torches graphiques et de son imaginaire. Tel un peintre réinventant et découpant le réel pour donner à voir son expérience du monde où les temps de pose se comptent parfois en heures… « Mon travail se veut invitation à nous réapproprier notre propre regard, loin de ceux-là programmés et standardisés qui nous privent de l’expérience du monde et en abolissent même le désir. Pour que chacun puisse se dire : moi-aussi, j’ai pouvoir de repeindre le monde en couleurs ! » Yonnel Liégeois






