Le 31 juillet 1914, rue du Croissant à Paris, Raoul Villain assassine Jean Jaurès. Ses obsèques sont organisées le 4 août. La veille, l’Allemagne a déclaré la guerre à la France. Aux éditions Fayard, Gilles Candar et Vincent Duclert ont publié Jean Jaurès. L’ouvrage de référence, la somme incontournable sur ce géant du socialisme, autant homme d’action que de réflexion.

Le 31/07 à 11h, comme chaque année, le directeur du quotidien L’Humanité invite le public à se rassembler devant le Bistrot du Croissant, anciennement Café du Croissant, pour un hommage à Jaurès, le fondateur du journal
Jaurès ? Plus qu’un roc, pour paraphraser la célèbre tirade de Cyrano, il personnifie le gigantisme même de la pensée politique, sociale et philosophique ! Rien n’échappe à la sagacité du professeur de philosophie, à l’élu du Tarn, au défenseur des ouvriers de Carmaux ou de Decazeville : qu’il s’agisse de l’enseignement des enfants, des droits de douane sur les céréales, de l’avenir des retraites ouvrières ou du statut des délégués mineurs… Jean Jaurès, signé Gilles Candar et Vincent Duclert, nous plonge dans une authentique saga. Le décryptage d’une personnalité hors du commun, d’une figure profondément enracinée dans l’imaginaire collectif du peuple de France.

« Son assassinat, le 31 juillet 1914 au Bar du Croissant à Paris, y est pour beaucoup », confirme Gilles Candar, professeur d’histoire à l’E.N.S. (École normale supérieure) et président de la Société d’études jaurésiennes depuis 2005. « Une mort à l’image de celle des grands tragiques grecs, qu’il aimait beaucoup… La guerre de 14-18, et la grande boucherie qui va suivre sa disparition, donneront sens à la vie et à la vérité de Jaurès : son combat pour la paix, son engagement politique enraciné dans un profond humanisme. Las, au fil des décennies, il deviendra aussi ce totem que l’on exhibe, mais que l’on ne lit plus : le culte a fait place à l’étude ! ». Le vrai travail sur l’œuvre et la pensée de Jaurès ne débutera en fait que dans les années 50-60. Grâce à une génération d’historiens tels que Maurice Aghulon, Ernest Labrousse, Jean Maîtron, Rolande Trempé et surtout la regrettée Madeleine Rebérioux…
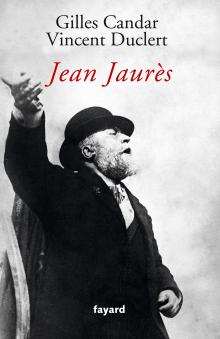
La biographie que signent Candar et Duclert nous livre d’abord des éléments éclairants et déterminants sur l’enfance de Jaurès : le petit Jean, issu d’un milieu bourgeois désargenté, n’est pas un gamin de la ville, le monde rural est pour lui la première référence. Brillant élève, il sera reçu troisième à l’agrégation de philosophie, derrière Bergson ! Ensuite, au fil des pages, l’ouvrage nous permet surtout de déceler comment se construit, s’affine et mûrit la pensée du futur tribun. La force et grande qualité de Jaurès ? « Être en permanence capable de se renouveler », souligne Gilles Candar. « Il refuse de se laisser enfermer là où on l’attend, il refuse de s’installer dans un socialisme convenu ou dans un socialisme de dénonciation. Il aurait pu faire une belle carrière de grand républicain, or il se veut avant tout un homme libre ». Jaurès, l’enfant à la tête farcie des héros de Plutarque et qui vit au carrefour des milieux rural et urbain, élargira son univers en partant à la découverte d’un milieu ouvrier qui n’était pas le sien d’origine : celui des mineurs de Carmaux, celui des ouvriers du textile dans le Nord.

Il fait alors le choix de s’adresser à un électorat ouvrier, mais sans jamais s’y enfermer : un monde certes encore minoritaire en cette fin de XIXème siècle, mais un monde d’avenir qui, pour lui, s’imposera comme une force essentielle dans le développement de l’économie et de la société. « Aux yeux de Jaurès, cette minorité détient les clefs de l’avenir », confirme l’historien. « C’est ainsi d’ailleurs que Jaurès le patriote, en s’intéressant au sort des ouvriers allemands après l’annexion de l’Alsace-Lorraine, forge sa conscience internationaliste ! L’humanisme de Jaurès se caractérise ensuite par cette capacité à joindre vision politique à vision de l’être : chez lui, le politique est toujours très lié au philosophique, au métaphysique. C’est d’ailleurs ce regard profondément humaniste qui le fait bouger, avancer, qui le démarque de bien des socialistes de son temps. En particulier, à l’heure de l’affaire Dreyfus ».

Le lecteur de Jean Jaurès éprouve un plaisir évident et un intérêt grandissant à découvrir cette pensée en train de se faire, au sens fort du terme, jamais prisonnière de sa propre production, toujours réinvestie et réévaluée au contact du quotidien et des soubresauts de l’actualité : de la « question sociale » à l’urgence des réformes à mettre en œuvre sous une IIIème République foncièrement conservatrice, du débat sur la loi de séparation de l’Église et de l’État à la défense de l’école laïque, de l’unification des courants socialistes aux idéaux de justice à l’heure de l’affaire Dreyfus, de la grande cause de la paix à la veille de l’embrasement guerrier de l’Europe… « Jaurès est avant tout un homme politique qui ne prétend pas détenir un système tout fait. Pour le trouver, il va lire, rencontrer d’autres gens, changer d’avis : une pensée en mouvement en quelque sorte, ce qui en fait toute la richesse parce qu’elle se construit au cœur des évolutions et des contradictions d’une société. Le Jaurès d’hier s’inscrit fortement dans le monde d’aujourd’hui où nous sommes revenus des grands systèmes idéologiques. D’où l’intérêt de retrouver la pensée d’un homme tout à la fois génial, ouvert et en recherche constante ». Candar et Duclert y parviennent avec brio et talent dans cette magistrale biographie qui ambitionne de « rapprocher, synthétiser, résumer ou suggérer l’immense connaissance, toujours fragmentée, sur Jaurès », lui qui désirait « aider les hommes de pensée à devenir des hommes de combat ».

Outre leur plongée érudite dans le corpus jaurésien, Gilles Candar et Vincent Duclert s’aventurent sur des terres d’histoire plus mouvantes, mais pas moins passionnantes : qu’en est-il de « Jaurès au XXème siècle … et au XXIème » ? Près d’un siècle après sa panthéonisation (23/11/1924), « en ascension constante au sein de la gauche française à la fin du XXème siècle, Jaurès se retrouve même au cœur des campagnes pour l’élection présidentielle de 2007 et de 2012», soulignent les auteurs. Or, il est aujourd’hui bien plus qu’une référence à la solde des hommes politiques : « un personnage d’aventure, un héros de roman ou de bande dessinée, joué au théâtre ou au cinéma, une chanson de Brel revisitée par le groupe Zebda, une affiche d’Ernest Pignon-Ernest, un souvenir fugace mais essentiel d’un moment de la conscience humaine ». Le chapitre « Jaurès, du roman national à l’histoire problème » l’atteste, il faut attendre 1959 et la création de la Société d’Études Jaurésiennes (SEJ) pour que se construise une authentique recherche universitaire, scientifique et historique, surtout collective, autour de Jaurès… En 2009, cinquante ans plus tard est publié Les années de jeunesse, le premier volume des « Œuvres » suivi de neuf autres dont « Le Pluralisme culturel », l’un des seuls à ne pas être chronologique et paru en 2014, l’année du centenaire.

Richesse du verbe et de la plume, intelligence hors norme, profondeur d’esprit et rigueur philosophique : autant de qualités qui nous font aimer Jaurès, « notre bon Maître », qui nous incitent à le (re)lire et (re)découvrir ! Avec une valeur fondamentale qui en assoit la stature : sa haute conscience morale. Dans les pas de Jaurès assurément, « il est temps de réfléchir à la dignité politique au XXIème siècle », concluent d’une même voix les deux historiens. Yonnel Liégeois

À lire : Jaurès, la parole et l’acte, de Madeleine Rebérioux. Les années de jeunesse, 1859-1889, de Madeleine Rebérioux et Gilles Candar : l’éminente et regrettée historienne signe la préface à l’édition des œuvres de Jaurès. Le monde selon Jaurès, de Bruno Fuligni qui, à travers citations-réflexions et extraits de discours replacés dans leur contexte, invite à découvrir la pensée vivante d’un orateur et d’un chercheur hors-pair. Jean Jaurès ou le pari de l’éducation, sous la direction de Gilles Candar et Rémy Pech : historiens, juristes, philosophes et théoriciens de l’enseignement décryptent la pensée jaurésienne en matière d’éducation.
À consulter : le site de la Société d’études jaurésiennes










































































