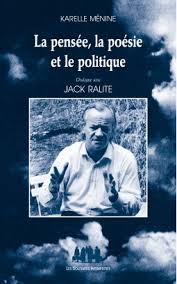Jusqu’au 15/06, aux Ateliers Berthier-Odéon (75), Célie Pauthe et Claude Duparfait adaptent Oui, le roman de Thomas Bernard. Ils font leur miel du pessimisme actif de l’auteur autrichien. Ils se frottent aux affres d’un homme arraché au désespoir par la survenue d’une étrangère qu’il ne parviendra pas à sauver de l’abîme.

Le comédien s’adresse directement au public, assis en porte à faux sur une chaise, unique meuble sur le plateau nu, à ses côtés un sac poubelle. Mi narquois, mi renfrogné, il s’empare avec gourmandise de la langue ressassante et contournée de l’auteur, de ses formules aiguisées. Le narrateur de cette histoire a sombré dans une sorte d’impasse dont ne le sortent ni ses recherches scientifiques, ni la musique de Schumann, ni la sagesse de Schopenhauer,… Pour illustrer cet état, il cite une parabole de son philosophe de chevet : « Par une froide journée d’hiver, un troupeau de porcs-épics s’était mis en groupe serré pour se garantir contre la gelée par leur propre chaleur. Mais aussitôt, ils ressentirent les blessures de leurs piquants, ce qui les fit s’écarter les uns des autres (….) de sorte qu’ils étaient ballottés entre les deux maux jusqu’à ce qu’ils trouvent une distance moyenne qui leur rende la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres mais leurs nombreuses manières d’être antipathiques et leurs insupportables défauts les dispersent de nouveau » (In Parerga et Paralipomena). Le ton est donné, personne ne peut sauver personne dans le monde gelé où vit le narrateur. Prostré dans sa maison à en devenir fou, dans sa haine envers la « société répugnante de cupidité, de stupidité », jusqu’à ce que l’arrivée d’une étrangère, originaire de Chiraz, le sorte de sa torpeur et lui redonne goût à la vie. Mais lui, que peut-il faire pour elle ?
Du monologue au dialogue
Célie Pauthe et Claude Duparfait n’en sont pas à leur première aventure commune avec l’écrivain autrichien. Ils avaient réalisé, en 2013, Des arbres à abattre, histoire tout aussi funèbre : un homme raconte les obsèques d’une amie de jeunesse qui s’est donnée la mort… L’adaptation ici se focalise sur la relation entre le narrateur et la Persane rencontrée chez l’agent immobilier Moritz, seul ami du narrateur dans ce village de l’Autriche profonde. En périphérie, un personnage mystérieux, le Suisse, compagnon de l’étrangère. Il a acheté dans cette région un terrain humide et pentu pour construire à sa femme une maison de béton, dans la perspective, selon elle, de l’y reléguer. Dans le roman, la Persane n’est évoquée qu’à travers le monologue du narrateur. De coupes en réécriture, les artistes ont créé des dialogues entre les deux protagonistes. Ce court roman, inspiré d’une histoire vécue par l’écrivain, devient ici un requiem, un tombeau poétique. La comédienne iranienne Mina Kavani nourrit son personnage de sa présence décalée, son léger accent et des poèmes de Forough Farrokhzad égrenés en farsi.

Thomas Bernhard avait imaginé deux titres, Promenade et La Persane. La relation entre les deux êtres se noue dans des séquences filmées, souvenirs de leurs promenades dans la forêt de mélèzes. Des moments d’échange intense. Lui, ému par sa présence et sa fragilité, elle, se livrant sans jamais se sentir réconfortée. Elle se perçoit rejetée, exclue, perdue. « Tout est si sombre, je pourrais me perdre, j’ai froid (…) Je suis comme déchiquetée ». Ils partagent pourtant leur passion pour Schumann en lisant ensemble les partitions, ils échangent sur Schopenhauer et elle lui fait entendre de la poésie persane. Plans larges de leurs déambulations sur les sentiers, gros plans sur le visage bouleversant de Mina Kavani doublent le récit de Claude Duparfait à la fois présent dans l’image et sur scène, le corps traversé par ces réminiscences fantomatiques. Comme aspiré par le spectre de celle qui n’est plus qu’une figure évanescente projetée sur le mur du fond.
Adresser la parole pour échapper à la folie
Dans son livre, Thomas Bernhard pose inlassablement cette question : comment survivre alors qu’on a été sauvé sans avoir pu en retour sauver l’autre ? Ce violent paradoxe est le moteur d’une écriture exutoire où il n’épargne personne et encore moins lui-même. Pour lui, « le monde est une sorte d’hiver » et l’être humain a besoin d’un manteau pour se réchauffer. La mise en scène file la métaphore du gel : malgré son grand manteau de mouton noir, la Persane n’est plus protégée de rien et sa disparition est matérialisée par un brouillard rampant qui monte insidieusement du sol et va jusqu’à engloutir le narrateur dans un froid mortel. Claude Duparfait endosse la fourrure que la défunte a laissée derrière elle, et, à travers lui le narrateur ne trouvera le réconfort qu’en verbalisant sa détresse. Le comédien semble dans l’urgence de nous adresser cette parole, puisée par l’auteur au tréfonds de la noirceur humaine. « Lorsque je lis Bernhard, c’est comme s’il se mettait à me parler en direct« , dit-il, « il est là, en chair et en os, tout près de moi, avec son hyper exigence, son humour, son exagération érigée comme un art ».

Transporté par l’élan viscéral de l’écriture, Claude Duparfait l’incarne et la partage en direct avec le public. Quelle performance ! Par la mise en scène lumineuse de Célie Pauthe, dépouillée de tout artifice, au plus près de la tragique lucidité de Thomas Bernhard, la beauté de ce Oui transcende le désespoir distillé par Schopenhauer : « Vouloir vivre, faire effort et souffrir, telles sont les trois phases invariables de toute existence. La souffrance est d’autant plus vive que l’intelligence est plus éclairée ». Mireille Davidovici, photos Jean-Louis Fernandez
Oui, Célie Pauthe et Claude Duparfait : jusqu’au 15/06, du mardi au samedi à 20h, le dimanche à 15h. Théâtre Odéon-Ateliers Berthier, 1 rue André Suarès, 75017 Paris (Tél. : 01.44.85.40.40). Le texte est publié en Folio Poche (Gallimard).