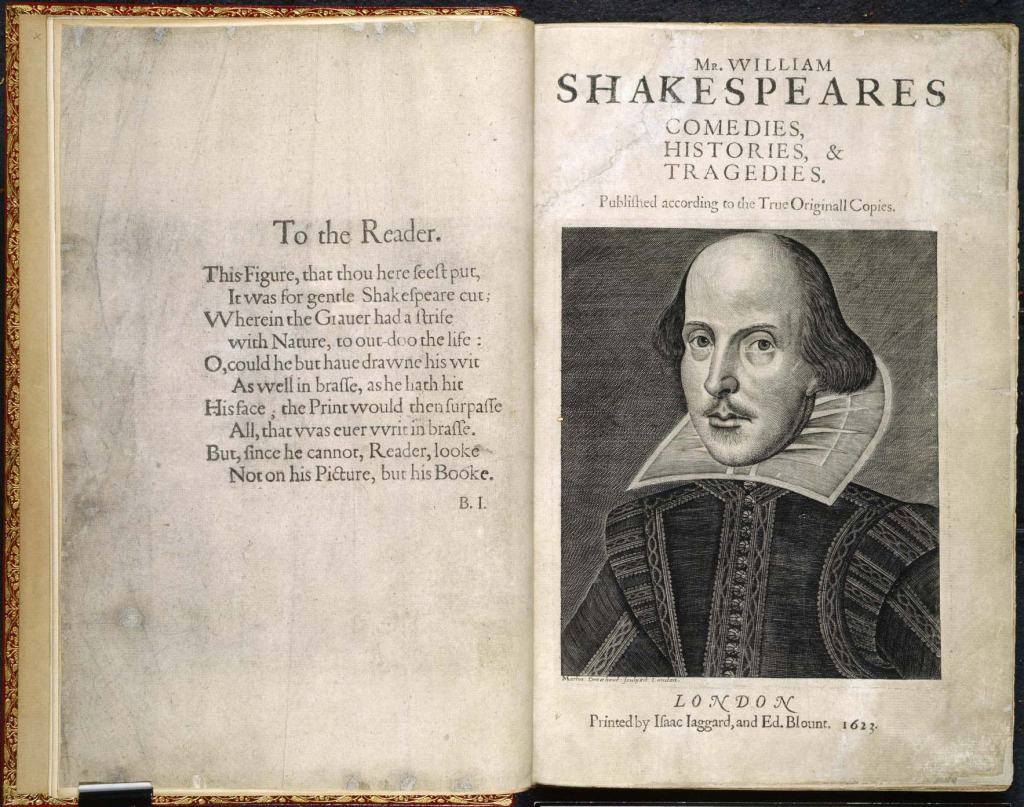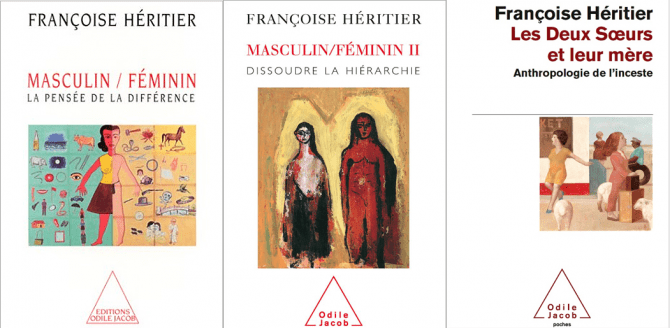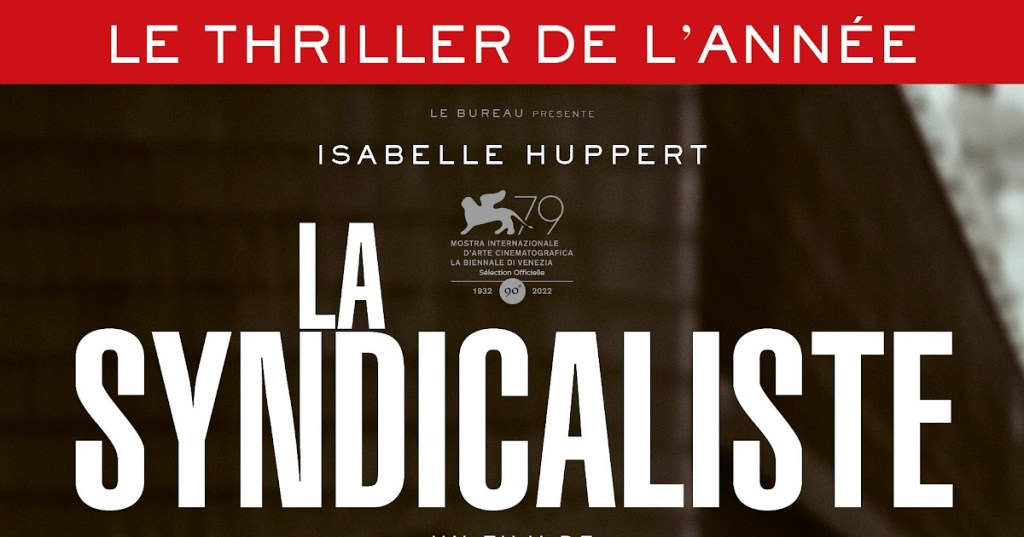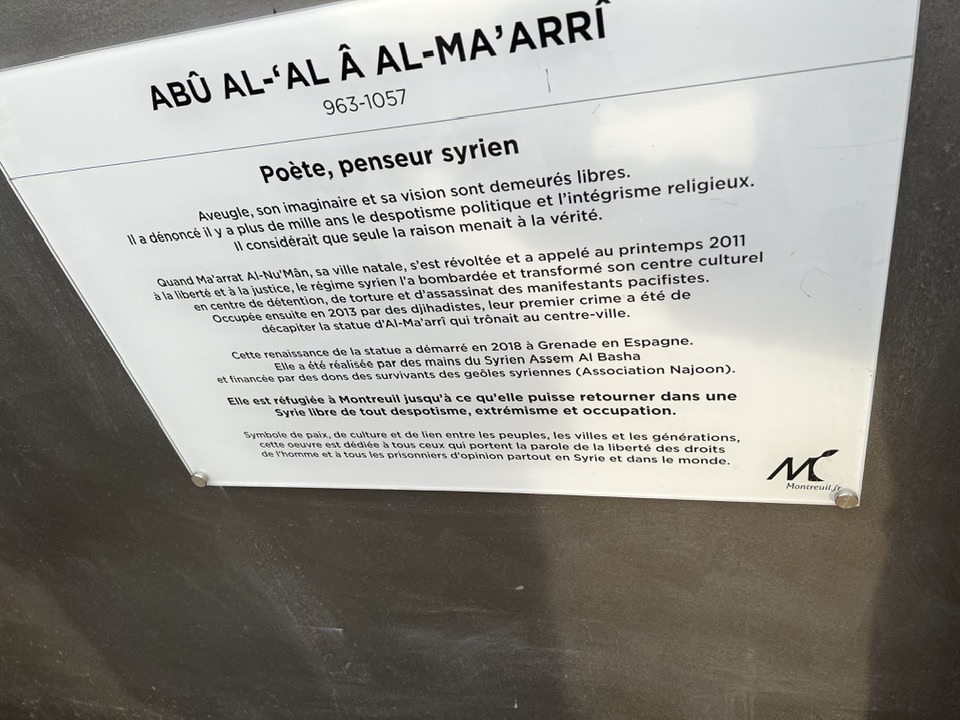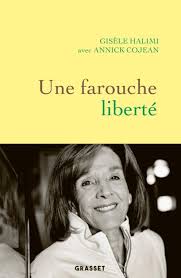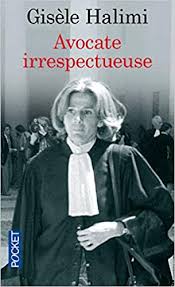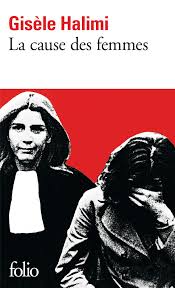Jusqu’au 06/04, à La Scala (75), Lena Paugam présente Gisèle Halimi, une farouche liberté. Avec Ariane Ascaride et Philippine Pierre-Brossolette, l’adaptation théâtrale des entretiens menés par Annick Cojean avec la célèbre avocate et humaniste. Un bel ouvrage, émouvant et passionnant, qui retrace une vie de combats pour la justice, les droits des femmes et l’indépendance des peuples.
« Ma liberté n’a de sens que si elle sert à libérer les autres ». L’avocate Gisèle Halimi a fait de cette profonde conviction le sens et le guide de toute une vie. Ce sont ses combats qu’Annick Cojean, grand reporter au Monde devenue son amie, a permis de retracer dans un très beau livre d’entretiens, chaleureux et denses, paru en août 2020. Quelques semaines à peine après son décès, survenu le 28 juillet à 93 ans. Une farouche liberté relève à la fois de l’hommage à un parcours de combat ininterrompu (pour le droit, la justice, les droits des femmes) et du témoignage, précieux, pour toutes celles et ceux qui entendent le poursuivre. Pour Gisèle Halimi, la révolte contre l’injustice naît dès l’enfance. « Tout ! Ma révolte, ma soif éperdue de justice, mon refus de l’ordre établi et bien sûr mon féminisme », rappelle-t-elle d’emblée à Annick Cojean,  comme elle l’avait raconté déjà à France Culture. Le désir de combattre pour la justice ne la quittera jamais.
comme elle l’avait raconté déjà à France Culture. Le désir de combattre pour la justice ne la quittera jamais.
Refuser l’assignation à la sujétion
Née en Tunisie dans une famille pauvre, avec une mère très pieuse (fille de rabbin sépharade), Gisèle Halimi est dès la naissance assignée à la non-reconnaissance, parce que née fille et non garçon (son père attend plusieurs semaines avant de la déclarer) puis à un rôle, celui, immuable, qu’ont connu mère, grand-mère, et auquel elle doit se soumette : servir ses frères avant de se marier et de « passer sous l’autorité et la sujétion d’un époux ». Un destin tracé d’avance, absurde et injuste, duquel Gisèle Halimi n’aura de cesse de vouloir échapper. Première révolte : une grève de la faim, encore enfant, lui permet de ne plus devoir servir ses frères. Une seconde, faite d’expérience plus intime, lui permet d’échapper à la foi religieuse et aux contraintes que la tradition patriarcale lui attachait. Elle comprend très vite que l’émancipation passe par l’éducation, la lecture (boulimique), l’école (qu’elle adore et où elle excelle). En jeu : apprendre, devenir indépendante économiquement, échapper à la « malédiction » qui fait des 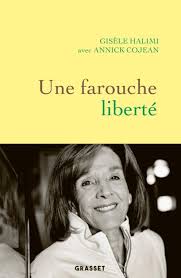 femmes « des obligées, des dominées, des infantilisées ». Et un objectif : devenir avocate.
femmes « des obligées, des dominées, des infantilisées ». Et un objectif : devenir avocate.
Elle le sera, d’abord au barreau de Tunis puis à celui de Paris, en dépit du serment obligatoire que le futur avocat devait proclamer : « je jure de ne rien dire ou publier, comme défenseur ou conseil, de contraire aux lois et aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix publique, et de ne jamais m’écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques ». Elle qui interroge la notion toute relative de « bonnes mœurs » et veut faire du droit une arme pour modifier les lois sait qu’elle prête serment sous réserve. Des années plus tard, c’est elle qui permettra de « dépoussiérer » ce serment, le limitant à une phrase : « je jure, comme avocat, d’exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience et indépendance ». Elle combat alors l’arrogance de magistrats qui toisent de leur supériorité masculine présumée la jeune avocate. Elle sait que « les mots ne sont pas innocents. Ils traduisent une idéologie, une mentalité, un état d’esprit. Laisser passer un mot, c’est le tolérer. Et de la tolérance à la complicité, il n’y a qu’un pas ».
Contre la torture, pour l’indépendance des peuples
Parmi les premiers procès de maître Halimi, des militants et militantes indépendantistes tunisiens et algériens, souvent condamnés à mort après avoir été torturés. Menacée, notamment en Algérie par l’OAS ou des militaires, elle ne renonce pas. Elle découvre en Algérie que « les pouvoirs spéciaux votés en 1956 avaient pris le droit en otage. (…) Soldats et magistrats travaillaient main dans la main pour rétablir l’ordre répressif français : les premiers tuaient, les seconds condamnaient ». Elle découvre aussi lors de demandes de grâces qu’elle plaide, souvent avec son « confrère et complice » Léo Matarasso (ancien résistant dans le mouvement Libération-Sud, défenseur d’Henri Alleg et plus tard de Mehdi Ben Barka ou d’Henri Curiel…), la toute-puissance monarchique laissée à la présidence de la République qui attribue à un homme le droit de vie ou de mort sur un autre. En défendant militants et militantes victimes de la torture, elle comprend qu’il s’agit de « résister contre le mal absolu ». Ce qu’elle fait notamment en défendant Djamila Boupacha, jeune militante de 22 ans du FLN algérien, qui avait déposé un obus piégé dans un café d’Alger en septembre 1959, finalement désamorcé. Arrêtée, elle est atrocement torturée, violée, subit l’introduction d’un goulot de bouteille dans le vagin, ce qui la marquera à vie. Gisèle Halimi assure sa défense, où se conjuguent « la lutte contre la torture, la dénonciation du viol, le soutien à l’indépendance et au droit des peuples à 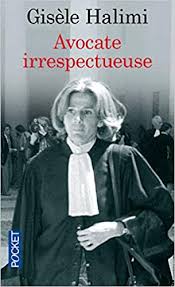 disposer d’eux-mêmes, la solidarité avec les femmes engagées dans l’action publique et l’avenir du pays ».
disposer d’eux-mêmes, la solidarité avec les femmes engagées dans l’action publique et l’avenir du pays ».
Le procès se fait tribune politique contre la torture, jusqu’alors taboue. Gisèle Halimi mobilise un réseau de soutien, dont Simone de Beauvoir, plusieurs journaux jouent leur rôle en informant l’« opinion publique ». Djamila Boupacha est finalement amnistiée en 1962 après l’indépendance de l’Algérie. Kidnappée par le FLN qui la ramène directement en Algérie, elle ne pourra pas rencontrer Simone de Beauvoir. Au lendemain du décès de Gisèle Halimi, elle dit simplement : « Ce n’était pas seulement mon avocate, c’était ma sœur ! ». D’autres combats de Gisèle Halimi contre le colonialisme et ses pratiques inhérentes, et pour la défense des droits des peuples à l’autodétermination, auraient sans doute pu trouver place dans ce livre. Ainsi de son engagement auprès du peuple vietnamien contre la guerre menée par Washington. Membre du tribunal international contre les crimes de guerre au Vietnam, le tribunal créé en 1966 par Bertrand Russell et Jean-Paul Sartre pour juger les militaires américains dans ce pays (la guerre a duré de 1955 à 1975), elle participe en 1967 à la mission d’observation que le Tribunal délègue au Vietnam. L’autre lutte pour laquelle l’avocate parisienne s’est pleinement engagée, c’est celle du peuple palestinien. Avocate, avec Daniel Voguet, du dirigeant palestinien Marwan Barghouti kidnappé par l’armée israélienne en 2001 après une  tentative ratée d’assassinat, condamné à la perpétuité par un tribunal militaire sans légitimité.
tentative ratée d’assassinat, condamné à la perpétuité par un tribunal militaire sans légitimité.
C’est tout un système que dénonce alors Maître Halimi, notamment dans la revue Pour la Palestine. Lors d’une énième offensive militaire israélienne à Gaza à l’été 2014, elle écrit, dans un appel publié par L’Humanité : « Un peuple aux mains nues — le peuple palestinien — est en train de se faire massacrer. Une armée le tient en otage. Pourquoi ? Quelle cause défend ce peuple et que lui oppose-t-on ? J’affirme que cette cause est juste et sera reconnue comme telle dans l’histoire. Aujourd’hui règne un silence complice, en France, pays des droits de l’homme et dans tout un Occident américanisé. Je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me résigner. Malgré le désert estival, je veux crier fort pour ces voix qui se sont tues et celles que l’on ne veut pas entendre. L’histoire jugera mais n’effacera pas le saccage. Saccage des vies, saccage d’un peuple, saccage des innocents. Le monde n’a-t-il pas espéré que la Shoah marquerait la fin définitive de la barbarie ? ». Cette même année, l’ambassadeur de Palestine en France lui décerne la citoyenneté 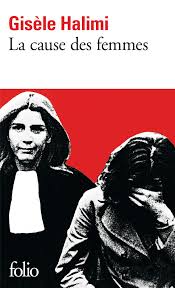 d’honneur d’un État qui continue de lutter pour son indépendance et sa reconnaissance.
d’honneur d’un État qui continue de lutter pour son indépendance et sa reconnaissance.
Choisir la cause des femmes
Le droit et la justice donc, toujours. Celui des femmes d’abord, les droits de toutes les femmes que Gisèle Halimi contribue à faire progresser. C’est le cas avec deux procès décisifs, que rien ne permettait d’imaginer gagnants sinon la conviction de la justesse des causes défendues, et qui font figure d’électrochocs dans la société avant de permettre des avancées législatives considérables. En 1972, à Bobigny, elle défend Marie-Claire Chevalier violée à seize ans, dénoncée à la police par son violeur parce qu’elle a avorté ce qui est alors passible d’emprisonnement, ainsi que sa mère et trois « complices » qui l’ont aidée. L’année précédente, le Nouvel Observateur a publié le manifeste de 343 femmes affirmant haut et fort qu’elles ont avorté et réclamant la dépénalisation et la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse. Gisèle Halimi en est signataire, malgré les sanctions possibles pour une avocate. Cette même année 1971, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi fondent le mouvement Choisir la cause des femmes. Le procès se fait accusation de la loi de 1920 sanctionnant l’avortement. Gisèle Halimi n’hésite pas à dénoncer, dans un tribunal où des hommes jugent une femme atteinte dans son corps, la justice  de classe condamnant des femmes qui n’ont pas les moyens d’avorter à l’étranger.
de classe condamnant des femmes qui n’ont pas les moyens d’avorter à l’étranger.
De Delphine Seyrig à Aimé Césaire, de Paul Milliez (pourtant a priori défavorable à l’IVG) à des milliers d’autres anonymes, les soutiens se multiplient. Le procès est gagné. Simone Veil fera aboutir la loi dépénalisant l’IVG. Gisèle Halimi sera de celles et ceux qui plaideront pour son remboursement. En 1978, à Aix, elle défend deux jeunes touristes belges, sauvagement agressées et violées par cinq hommes dans la tente où elles campaient à l’été 1974. Gisèle Halimi, qui met en lumière « la mort inoculée aux femmes un jour de violence », décrit à Annick Cojean le climat de haine et de raillerie antiféministe et homophobe contre ces femmes et leurs défenseuses qui régnait alors parmi des magistrats, des avocats… « et avec lesquels les accusés créaient une complicité inavouée ». Elle souligne « le mépris et la négation de l’identité de l’autre » qui se joue dans ce crime qu’est le viol et ajoute qu’« il ressemble furieusement à un acte de fascisme ordinaire ». Les « grands témoins » cités à la barre par Gisèle Halimi mais chassés du tribunal par le juge, s’exprimeront devant les caméras. Ils contribueront eux-aussi à faire changer la honte de camp,  à « changer les mentalités et les mœurs », à permettre de modifier la loi sur le viol et les crimes sexuels.
à « changer les mentalités et les mœurs », à permettre de modifier la loi sur le viol et les crimes sexuels.
« La politique est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seuls hommes »
Puisque c’est au Parlement que se font les lois, Gisèle Halimi se laisse tenter par l’idée d’y participer. Car les femmes doivent participer, « en masse », dit-elle, à leur écriture. Une réflexion qui mûrit, alors que le féminisme des années 60-70 se défiait du politique. En 1978, Choisir présente des candidatures féminines. Sous sa propre bannière, aucune organisation ne lui ayant laissé la moindre place. Un slogan : « cent femmes pour les femmes ». Et un « programme commun des femmes », avec une douzaine de propositions de loi. Avec moins de 1,5 % des suffrages en moyenne, aucune candidate n’est élue. Mais Choisir a fait progresser des débats. Gisèle Halimi est cependant élue en 1981. Elle ne restera pas longtemps sur les bancs de l’Assemblée où sa non appartenance à une organisation politique, sa liberté de réflexion et de parole, un machisme encore dominant à l’Assemblée, la condamnent à l’isolement. Elle poursuit cependant son engagement pour faire du droit un instrument de libération. Dès 1979 et les premières élections européennes, elle milite pour « la clause de l’Européenne la plus favorisée », pour que tous les droits conquis par les femmes  dans un des pays européens deviennent la norme dans les autres. Choisir engage un travail d’inventaire et de propositions considérable.
dans un des pays européens deviennent la norme dans les autres. Choisir engage un travail d’inventaire et de propositions considérable.
C’est un joli mot, féminisme
« Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque » : c’est avec ce vers de René Char que Gisèle Halimi et Annick Cojean ont choisi d’ouvrir ce livre et de transmettre le flambeau aux nouvelles générations. Des femmes d’aujourd’hui, elle attend la révolution : « des colères se sont exprimées, des révoltes ont éclaté ça et là, suivies d’avancées pour les droits des femmes. Mais nous sommes encore loin du compte », constate celle qui ne cesse de plaider pour l’indépendance d’abord économique des femmes, premières à subir le chômage en temps de crise, à subir le temps partiel, à subir les bas salaires… Elle en appelle à une révolution des mœurs et des rapports humains, à poursuivre la lutte pour pérenniser des conquêtes toujours précaires et pour une égalité loin d’être atteinte. « Enfin, n’ayez pas peur de vous dire féministes. C’est un mot magnifique, vous savez. C’est un combat valeureux qui n’a jamais versé de sang ». Les obsèques, émouvantes, de Gisèle Halimi ont eu lieu le 6 août au cimetière du Père Lachaise à Paris. Le siège prévu pour le nouveau Garde des sceaux est resté vide. Avocate remarquable, militante de convictions, à la fois bienveillante et exigeante comme la décrivent toutes celles et ceux qui ont eu la chance de la connaître et de la fréquenter, elle est partie tandis que résonnait les paroles de la chanson Bella Ciao.
Gisèle Halimi nous laisse en héritage des droits nouveaux qui sont autant de ruptures avec une vision patriarcale de la société et du monde. Plus encore, elle nous lègue des valeurs fondamentales pour poursuivre le combat féministe : égalité, liberté, indépendance et justice. Isabelle Avran
Gisèle Halimi, une farouche liberté : jusqu’au 06/04 au théâtre La Scala, Du mardi au samedi à 19h, le dimanche à 15h. L’ouvrage est disponible aux éditions du Livre de poche (168 p., 7€20).