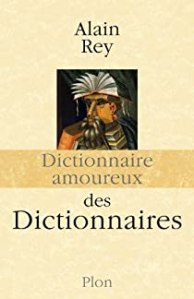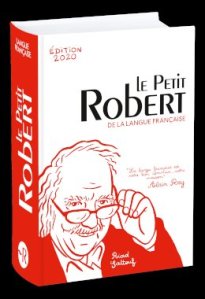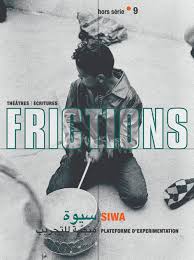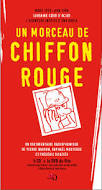Professeur émérite à l’université Stendhal de Grenoble, agrégé de philosophie et spécialiste d’Aragon dont il a dirigé l’édition des Œuvres romanesques complètes dans la bibliothèque de la Pléiade, Daniel Bougnoux nourrit un blog au titre évocateur, Le randonneur. Dans une chronique en date du 21/10, il rend hommage à Samuel Paty, à tous les enseignants. Célébrant le statut de la philosophie, l’enjeu de l’éducation, le plaisir de la disputation, le bienfait de la culture cultivée dès la jeunesse jusqu’à point d’âge.
Une méditation enrichissante, un retour historique et une projection dans l’avenir que Chantiers de culture propose à ses lectrices et lecteurs. Comme objet de réflexion et de débat. Yonnel Liégeois
Éveiller les esprits (avec Samuel Paty)

Samuel Paty (1973-2020)
L’infortuné prof d’histoire-géo victime du poignard islamiste n’était pas un héros, juste une bonne personne persuadée d’accomplir sa mission éducative, en proposant à sa classe de réfléchir, au-delà des limites du programme, sur des sujets tels que la liberté d’expression, l’intolérance, la place de la religion ou les vertus de l’humour… Je partage d’autant mieux l’émotion collective qui s’empare depuis quatre jours de notre pays qu’ancien enseignant moi-même, j’aurais fait comme lui.
Il est vrai que mon service dans l’enseignement secondaire (en philosophie) n’a duré que trois ans, à une époque (1970-1973) et dans un lieu (le lycée de jeunes filles Bonaparte à Toulon) où les conditions offertes au pédagogue étaient à l’évidence plus faciles : les valeurs de l’école faisaient encore consensus, mes étudiantes venaient pour apprendre et passer leur bac, et je n’avais pas dans mes classes pourtant remplies au maximum (40 élèves), de minorités ethniques capables de contester mes contenus de cours. Fraîchement issu moi-même de l’ENS et de l’agrégation, j’avais pour article de foi les bienfaits inconditionnels de la réflexion philosophique, et le vif désir de partager  celle-ci chaque matin avec ma classe. Laquelle y consentait assez bien, faisant de moi un prof somme toute heureux.
celle-ci chaque matin avec ma classe. Laquelle y consentait assez bien, faisant de moi un prof somme toute heureux.
Autre époque, heureuse utopie ? Je voudrais ici, en hommage à Samuel Paty, mieux cerner cet idéal partagé.
Si je tente d’évaluer ma situation par rapport à la sienne, je dirai d’abord que je n’ai pas affronté l’obscurantisme. Je me suis heurté comme chacun à l’ignorance, au dédain, à la bêtise crasse ou satisfaite, aux clichés et aux vulgarités où s’enlise la parole courante, mais pas à la remise en cause de ce qui m’animait : éveiller les esprits. Je croyais, et au fond je crois toujours, aux valeurs intrinsèques de l’ironie philosophique, aux bienfaits de sa discipline verbale, de son appel incessant au dialogue et aux raisons de l’autre, voire à des points de vue ou des hypothèses très étranges d’où le monde se découvre autrement. Dans la mesure où la philo se propose comme un éveil, un voyage ou une secousse libératrice hors des pensées enkystées, elle séduit assez facilement les jeunes gens qui, sur le point de quitter leur milieu familial, cherchent leur voie et leur équilibre. Ma légitimité n’était donc pas remise en cause, je n’avais pas de problème d’acceptation.
Plus qu’une autre matière, à l’exception peut-être des sports, la philo accompagne son disciple ou son étudiant sur les chemins de sa propre vie ; on peut, en classe de philo, apporter le récit d’un rêve, ou d’une péripétie intime, ouvrir le journal du matin, s’intéresser à une chanson, aborder une mode ou une œuvre d’art, bref réfléchir à toute sortes d’événements qui tissent notre quotidien sans sortir aucunement du sacro-saint programme ; la philo étant auto-référentielle, elle cherche à mieux cadrer ce qui arrive, et à composer à partir de ces sujets de réflexions en apparence disparates un monde  un tant soit peu commun, ou une pensée communicante.
un tant soit peu commun, ou une pensée communicante.
Commun est le grand mot : la philosophie surmonte les conflits en leur offrant une arène ou un cadre de discussion, la mise en arguments demeure sa grande affaire, elle répudie la violence, ou l’affirmation brutale d’un dogme ou d’une opinion personnelle qu’elle remplace par l’injonction : prenez la parole, vous et moi causons ! Je suis conscient, en rappelant cela, que ce filet de la dialectique ou du dialogue n’empêchera pas la révolte d’un Gorgias ou d’un Calliclès ; et qu’un islamiste, ou le porteur d’un dogme qui l’a fanatisé, ne fait pas irruption pour s’asseoir à la table des  discussions, mais pour la renverser.
discussions, mais pour la renverser.
Le logos ou le cercle de la raison nous éclairent comme un phare, ou une lampe de poche, mais en laissant beaucoup de forces obscures et sauvages hors de leur clairière. Comment élargir ce rond de lumière ? Au niveau d’une classe, la mise en commun de la parole garde un fort pouvoir d’appel ; le sujet convié à une table ouverte où l’on échange des arguments et non des coups, sans dogmes a priori ni censure venue d’en haut, se trouve sécurisé et stimulé pour peu que cette parole, libératrice, soit présentée comme un jeu, ou une joute sportive. Car les lieux (familiaux, sociaux) qui stimulent une pensée personnelle ne sont pas si nombreux. Autour du sujet, l’institution scolaire puis universitaire trace une enceinte, protectrice, où les religions, les traditions, les trafics et les luttes d’influence en principe n’entrent pas. Et la philosophie en particulier a soin de découper cette « chambre à soi » (disait Virginia Woolf) ou ce sanctuaire, espace de retraite et de construction personnelle où le sujet retrouve des coudées franches ; elle réveille et stimule en  nous cette faculté justement d’être un sujet, avec son pouvoir d’articuler, d’objecter et de répondre… Et elle fait advenir du même coup un nous, l’évidence d’une communauté de partage et d’écoute.
nous cette faculté justement d’être un sujet, avec son pouvoir d’articuler, d’objecter et de répondre… Et elle fait advenir du même coup un nous, l’évidence d’une communauté de partage et d’écoute.
L’affinité entre ce programme (limité pour la philo à la terminale) et les valeurs de la laïcité et de la République n’a pas besoin d’être soulignée : chaque classe, si le prof s’appuie sur sa bienfaisante clôture pour y éveiller les esprits, à l’écart des autorités ailleurs constituées, reproduit en petit ce modèle de tolérance et d’émulation qui définit les fondements de notre République. L’école, et l’exercice philosophique en particulier, s’adressent à notre liberté. Mais l’exigence d’avoir à penser par soi-même n’est pas spontanée, ni forcément bienvenue, quel est ce soi-même qui parle par la bouche des enfants ? Trop souvent celui des préjugés extérieurs et (Descartes) des « contes de nourrice ». L’enseignant, celui qui promeut et porte véritablement le commun au-delà des intérêts et des affrontements particuliers, doit donc montrer tout ce qu’on gagne à cette ouverture, à ce passage d’une société close à une communauté moins fermée, celle dans laquelle on lit, on raconte, on pense et on joue à sa guise, selon ses propres goûts. Le grand défi est de faire préférer par les élèves cette ouverture aux routines de leurs mondes propres, de leur faire comprendre (et choisir) la supériorité de la parole et de l’examen personnel sur les dogmes ou les réponses toutes faites, de les aider à articuler contre les facilités du « J’te raconte pas », de l’inattention,  contre les mille séductions d’internet, la paresse du par-cœur ou l’expression désordonnée des pulsions, contre le chantage sentimental ou la violence primaire… Vaste programme, toujours à reprendre !
contre les mille séductions d’internet, la paresse du par-cœur ou l’expression désordonnée des pulsions, contre le chantage sentimental ou la violence primaire… Vaste programme, toujours à reprendre !
À l’horizon de cette ouverture il y aurait l’universel, auquel l’enseignement de la raison s’efforce d’accéder. Personne ne se meut dans l’universel mais il est bon, avec Kant, de poser que la moralité suppose non seulement qu’on se pense comme un autre (« ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse »…), mais encore comme un sujet du genre humain au-delà des mœurs, des lois, des doctrines et des religions qui quadrillent les différentes sociétés. Cet appel à sortir du cercle des mimétismes partagés fait la supériorité de la science, comme de la vraie moralité. Et il ne reste pas sans écho : quelle récompense, pour chaque enseignant, de voir un jeune esprit s’ouvrir à cet horizon qui en effet l’élève, ou le grandit ! L’éducation n’est pas un mot creux ni une vaine tâche, elle amorce un cercle vertueux entre les  consciences, moins d’intolérance, plus d’humour et d’audace dans la pensée.
consciences, moins d’intolérance, plus d’humour et d’audace dans la pensée.
J’imagine que Samuel Paty reproduisait, dans son coin et sans faire de foin, cet idéal des Lumières ; et que les profs sont légion, aujourd’hui en France, à transmettre sans forcément s’y référer les rudiments des philosophes qui nous ont formés, Socrate contre Calliclès, Montaigne, Pascal acharné à démêler en lui-même les évidences de la science et l’enthousiasme de la foi, Voltaire et son combat contre l’infâme, Kant et son partage critique entre les domaines de la religion et de la raison… Cet héritage est toujours à reprendre, à défendre contre ceux qui voudraient nous faire croire que ces mêmes Lumières ne sont qu’une croyance ou une idéologie parmi d’autres, ou que notre prétention à l’universel a entraîné le colonialisme et humilié les autres cultures. Au nom de quelles valeurs supérieures peut-on s’élever contre la laïcité ? Contre les principes de tolérance, et de libre circulation des idées, des pensées ?
Cette laïcité constitue un horizon indépassable, imprescriptible, mais elle ne conduit pas à l’angélisme ni à la naïveté : pas de tolérance pour les ennemis de la tolérance ! Sachons nommer, et traiter en conséquence, les adversaires de l’idéal scolaire et républicain qui nous a formés, et continue de nous inspirer. Une longue série de crimes fomentés par l’islam radical vient de culminer dans le meurtre, particulièrement atroce, de Samuel Paty.
Comment réagir ? Certainement pas en trouvant aux fanatiques des excuses, en se cachant derrière son petit doigt ou en répétant, comme le proviseur du dessin de Plantu, « pas de vagues »… Le prof comme le flic ou le juge se trouve confronté à ce qu’une société a parfois de pire, ses laissés pour compte, ceux que la famille, le quartier, le travail n’ont pas su éduquer et qui trouvent assez fatalement dans le prêche islamiste un lambeau de dignité ou une manière d’identité, fût-elle barbare. Entre leur charia et les lois de la République, la guerre est donc déclarée mais elle ne peut être, du côté des enseignants, que non-violente : nos armes sont le discours, la discussion, la  lecture, cette lumière qui vient des œuvres inscrites au programme et d’une tradition critique de libre-examen… En un mot et encore une fois, l’éveil des esprits.
lecture, cette lumière qui vient des œuvres inscrites au programme et d’une tradition critique de libre-examen… En un mot et encore une fois, l’éveil des esprits.
Grand promoteur de notre école laïque, Victor Hugo y a insisté dans des vers superbes, connaissez-vous dans La Légende des siècles le poème intitulé « An 9 de l’Hégire » ? Avez-vous ouvert et médité Le Fou d’Elsa (1963) où Aragon nous fait partager en quatre-cents pages de proses et de vers savamment mêlés la splendeur de la civilisation arabo-andalouse de Grenade, et la douleur de son égorgement par les Rois catholiques ? Quelques poètes de notre langue ont ainsi jeté des ponts ; et notre tradition critique des Lumières propose un horizon de conciliation, et un programme d’éducation. Un islam non-radical partage forcément ces valeurs, à lui de faire le ménage dans ses rangs, car il est la première victime des « amalgames », et d’aider nos profs (au lieu de les traiter de « voyous ») dans ce combat qui est aussi le sien. Daniel Bougnoux
 choses, on en trouve de « l’argent magique » !
choses, on en trouve de « l’argent magique » ! « gilets jaunes ». Alors que tout défilait sur les réseaux sociaux.
« gilets jaunes ». Alors que tout défilait sur les réseaux sociaux. femmes progresse en BD ?
femmes progresse en BD ?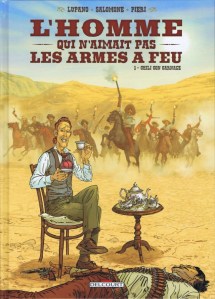 gros succès depuis son lancement en 2014, dépassant le million d’exemplaires vendus. La série raconte les tribulations d’une bande de papis anarchistes, d’anciens ouvriers et syndicalistes orchestrant des actions en mode « guérilla festive » contre des multinationales.
gros succès depuis son lancement en 2014, dépassant le million d’exemplaires vendus. La série raconte les tribulations d’une bande de papis anarchistes, d’anciens ouvriers et syndicalistes orchestrant des actions en mode « guérilla festive » contre des multinationales.