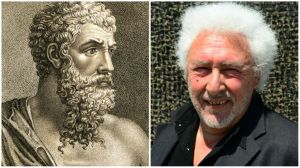Dans le cadre du festival Normandie impressionniste, jusqu’au 22 novembre, le musée des Beaux-Arts de Caen consacre une surprenante, et passionnante, exposition sur le travail. Sous le label « Les villes ardentes. Art, travail, Révolte. 1870 – 1914 », des chantiers de la ville au feu des aciéries, le regard des peintres sur l’avènement d’un nouveau monde : industriel et ouvrier.
En haut de la butte, l’homme est assis. Songeur, pensif, divers détritus autour de lui… Un ouvrier assurément, l’habit ne trompe pas : en balade, en pause, au chômage ou en congé ? Au premier plan une terre de désolation, au loin se détachent dans un ciel gris les cheminées des usines avec leurs nuages de fumée. Le tableau date de 1902, Les usines est l’œuvre de Jean-Emile Laboureur… Si le paysage urbain a fait sa révolution, les peintres dits impressionnistes font aussi la leur : adieu paysages marins et vagues écumantes, falaises et galets, bains de mer et belles de jour, toiles et pinceaux braqués désormais sur  d’autres réalités, le regard tourné vers ce nouveau monde industriel, urbain, ouvrier !
d’autres réalités, le regard tourné vers ce nouveau monde industriel, urbain, ouvrier !
Lassés des règles de l’Académie, exclus des Salons parisiens, ils sont une poignée d’artistes en cette seconde moitié du XIXe siècle à se rebeller ! Monet et Renoir ont ouvert la voie : place à la lumière, à l’explosion des couleurs, à la pointe légère du pinceau qui désormais fait tache… Sus aux grandes batailles du passé ou aux scènes bibliques, il est temps de peindre la vie de tous les jours ! Certes, la querelle entre anciens et modernes n’est pas aussi simple, le cadre des débats pas aussi caricatural, mais les points de rupture ainsi exposés s’affichent désormais au tableau. Au Salon des Refusés, le Déjeuner sur l’herbe de Manet fait scandale en 1863. Face aux critiques, violentes et répétées, les  réprouvés se révoltent et s’organisent. Leurs noms ? Degas, Pissaro, Sisley, rejoints plus tard par Guillaumin, Luce, Signac, Steinlen…
réprouvés se révoltent et s’organisent. Leurs noms ? Degas, Pissaro, Sisley, rejoints plus tard par Guillaumin, Luce, Signac, Steinlen…
Une révolte qui n’est point étrangère aux bouleversements de l’époque, à ce monde qui change et bouge à vue d’œil, sous leurs yeux : la manufacture cède la place à l’usine, la mère au foyer devient femme à l’atelier, les grands chantiers urbains exposent corps et métiers en pleine rue. De quoi nourrir l’imaginaire, libérer le pinceau et bousculer la nature du tableau ! De la Commune à la veille de la première guerre mondiale, de 1870 à 1914, la vision de cette nouvelle ère industrielle inspire alors peintres et plasticiens, affichistes et caricaturistes. « Les impressionnistes, post-impressionnistes et  naturalistes se retrouvent autour de ce même motif qu’est le travail, marqués par une sensibilité à la réalité de leur temps », commentent les deux commissaires de l’exposition, Emmanuelle Delapierre et Bertrand Tillier, directrice – conservatrice en chef du musée pour l’une et professeur à la Sorbonne pour l’autre. « En s’attachant à la représentation des scènes de travail en ville, le musée des Beaux-Arts de Caen souhaite tout autant déplacer les oppositions habituelles de style, de genre et d’école, qu’élargir le regard porté sur l’art impressionniste, plus volontiers considéré comme un art d’agrément, attentif à la société de loisirs plus qu’à celle du travail ». Un pari osé mais gagné, le public surpris et conquis par ce qu’il découvre d’une salle à l’autre !
naturalistes se retrouvent autour de ce même motif qu’est le travail, marqués par une sensibilité à la réalité de leur temps », commentent les deux commissaires de l’exposition, Emmanuelle Delapierre et Bertrand Tillier, directrice – conservatrice en chef du musée pour l’une et professeur à la Sorbonne pour l’autre. « En s’attachant à la représentation des scènes de travail en ville, le musée des Beaux-Arts de Caen souhaite tout autant déplacer les oppositions habituelles de style, de genre et d’école, qu’élargir le regard porté sur l’art impressionniste, plus volontiers considéré comme un art d’agrément, attentif à la société de loisirs plus qu’à celle du travail ». Un pari osé mais gagné, le public surpris et conquis par ce qu’il découvre d’une salle à l’autre !
Sur les quais de Seine où sont déchargées les marchandises, dans le ventre de Paris où s’activent sous terre les forçats du métropolitain, du haut des chantiers sur les grands boulevards, dans la fournaise des aciéries, partout des hommes à la tâche, forts en gueule et en muscles… Point de misérabilisme dans le regard  des artistes, leurs tableaux expriment d’abord la grandeur de l’effort, la beauté du chantier, la qualité du métier : un hymne aux « Premiers de corvée », plus d’un siècle avant l’heure ! Beauté des flammes et majesté des usines explosent sur la toile, du lever au coucher du soleil, comme Monet le fit à Rouen avec sa série de cathédrales. Ainsi, Armand Guillaumin multiplie les regards sur Les forges d’Ivry, sous la neige ou au printemps. Aciéries et chantiers de construction semblent s’imposer dans l’imaginaire des peintres : force des couleurs et rectitude des lignes ! Certes, mais pas seulement… Les regards esthètes deviennent regards engagés, d’aucuns affichant leurs convictions libertaires et anarchistes. Du haut de l’échafaud à la chaleur du four, leurs représentations symbolisent par excellence cette nouvelle condition humaine qui plie et broie les corps : la misère, la maladie, le chômage mais aussi l’accident et la mort. Autant de thèmes dont s’emparent artistes et affichistes, plus qu’œuvre d’art le tableau ou l’imprimé devenant comme vecteur de la revendication sociale ! Les femmes ne sont pas en reste. Têtes baissées, dans le noir de la nuit toujours pas
des artistes, leurs tableaux expriment d’abord la grandeur de l’effort, la beauté du chantier, la qualité du métier : un hymne aux « Premiers de corvée », plus d’un siècle avant l’heure ! Beauté des flammes et majesté des usines explosent sur la toile, du lever au coucher du soleil, comme Monet le fit à Rouen avec sa série de cathédrales. Ainsi, Armand Guillaumin multiplie les regards sur Les forges d’Ivry, sous la neige ou au printemps. Aciéries et chantiers de construction semblent s’imposer dans l’imaginaire des peintres : force des couleurs et rectitude des lignes ! Certes, mais pas seulement… Les regards esthètes deviennent regards engagés, d’aucuns affichant leurs convictions libertaires et anarchistes. Du haut de l’échafaud à la chaleur du four, leurs représentations symbolisent par excellence cette nouvelle condition humaine qui plie et broie les corps : la misère, la maladie, le chômage mais aussi l’accident et la mort. Autant de thèmes dont s’emparent artistes et affichistes, plus qu’œuvre d’art le tableau ou l’imprimé devenant comme vecteur de la revendication sociale ! Les femmes ne sont pas en reste. Têtes baissées, dans le noir de la nuit toujours pas  dissipé, elles s’en vont trier le charbon. D’autres empruntent le chemin de la filature, déjà pour des salaires au rabais, plus souvent encore celui des fabriques de porcelaine, des ateliers de taille de faux diamants ou de repassage : là, Degas les immortalisera !
dissipé, elles s’en vont trier le charbon. D’autres empruntent le chemin de la filature, déjà pour des salaires au rabais, plus souvent encore celui des fabriques de porcelaine, des ateliers de taille de faux diamants ou de repassage : là, Degas les immortalisera !
Mêlant quelques cent cinquante œuvres (peintures, affiches, dessins, cartes postales…) réparties en huit grandes sections, l’exposition embrasse vraiment cette époque charnière sous tous les angles. Du défilé mortuaire à la manifestation populaire, du chômeur prostré sur sa chaise à l’arrogance des bourgeoises en visite à l’usine, du fardier au cheval blanc aux plis chaloupés du drapeau rouge, de la blanchisserie nivernaise à la filature du Nord, de l’affiche de L’assiette au beurre à celle de La bataille syndicaliste, de la grève de  Fougères à celle de Graulhet, de l’enfant à la forge au jeune verrier… Quelques signatures marquantes, et pourtant méconnues du grand public ? Armand Guillaumin bien sûr, Maximilien Luce, Gaston Prunier originaire du Havre, Théophile-Alexandre Steinlen. Pour ne point se perdre sur le chemin de l’usine ou à l’embauche du chantier, celui du Sacré-Cœur ou du Métropolitain, d’une salle l’autre, sont aussi placardées au mur les heures mouvementées qui scandèrent ce temps nouveau : la création du corps de l’inspection du travail en 1874, le premier congrès féministe en 1878 pour l’égalité des salaires, la naissance de la CGT en 1895 au congrès de Limoges, la loi Millerand de 1900 abaissant à onze
Fougères à celle de Graulhet, de l’enfant à la forge au jeune verrier… Quelques signatures marquantes, et pourtant méconnues du grand public ? Armand Guillaumin bien sûr, Maximilien Luce, Gaston Prunier originaire du Havre, Théophile-Alexandre Steinlen. Pour ne point se perdre sur le chemin de l’usine ou à l’embauche du chantier, celui du Sacré-Cœur ou du Métropolitain, d’une salle l’autre, sont aussi placardées au mur les heures mouvementées qui scandèrent ce temps nouveau : la création du corps de l’inspection du travail en 1874, le premier congrès féministe en 1878 pour l’égalité des salaires, la naissance de la CGT en 1895 au congrès de Limoges, la loi Millerand de 1900 abaissant à onze  heures la durée journalière du travail, le Code du travail instauré en 1910 parmi un large éventail de dates marquantes !
heures la durée journalière du travail, le Code du travail instauré en 1910 parmi un large éventail de dates marquantes !
Une exposition superbement agencée, brûlante et ardente comme les chaleurs de l’été ! Quand le musée voit rouge, quand le tableau devient ainsi œuvre vivante et page d’histoire poignante, du beau travail, de la belle ouvrage : aussi ludique que pédagogique, aussi plaisant qu’émouvant, un regard toujours d’actualité en ces temps mouvementés. Yonnel Liégeois
À savoir :
« Les villes ardentes. Art, travail, Révolte. 1870 – 1914 » : jusqu’au 22/11/20. Fermé le lundi, ouvert en semaine de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h, le week-end de 11h à 18h. À consulter, sur le site du musée, les originales et succulentes « chroniques ardentes » : musiciens, comédiens, écrivains, plasticiens ont choisi une œuvre et la mettent en regard d’un texte littéraire, d’une partition musicale, d’une création plastique… À feuilleter le magnifique catalogue coédité par le musée et les éditions Snoeck (200 p., 25€), avec une  étonnante huile sur toile de Paul Louis Delance en couverture, Grève à Saint-Ouen (1908), mêlant procession religieuse et défilé révolutionnaire.
étonnante huile sur toile de Paul Louis Delance en couverture, Grève à Saint-Ouen (1908), mêlant procession religieuse et défilé révolutionnaire.
Une balade au temps d’avant que le visiteur prolongera, non sans plaisir, à l’écoute des « Cris dans la ville, Paris et Bologne », l’exposition organisée conjointement : « une centaine d’estampes issues de la collection du musée montrant les petits métiers de la rue, métiers de service et de commerce peu qualifiés mais qui paradoxalement constituent une réelle source d’inspiration pour les graveurs du XVIe siècle jusqu’à l’ère industrielle ». Des artisans et marchands  ambulants de la ville de Bologne aux dessins du petit peuple parisien d’Edme Bouchardon gravés par le comte de Caylus.
ambulants de la ville de Bologne aux dessins du petit peuple parisien d’Edme Bouchardon gravés par le comte de Caylus.
Dans le cadre du festival Normandie impressionniste 2020, parmi une multitude de propositions au label « La couleur au jour le jour » (à Dieppe, Fécamp, Honfleur…), deux autres expositions à visiter : Les nuits électriques au MuMa du Havre, François Depeaux-L’homme aux 600 tableaux au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Sans oublier de faire halte au Musée des impressionnismes à Giverny !