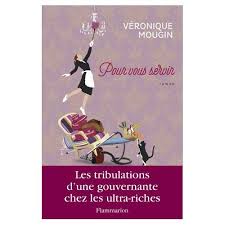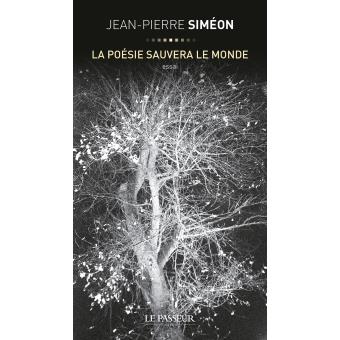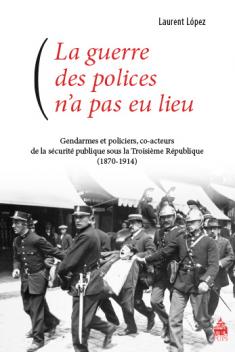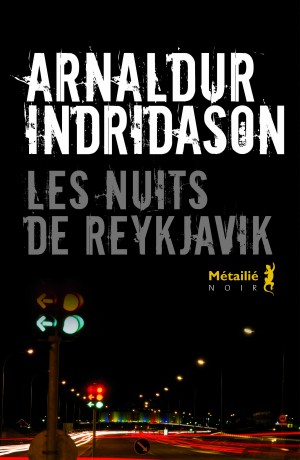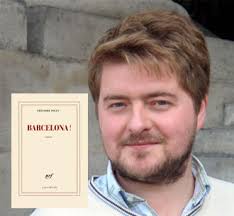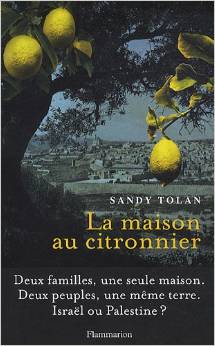Feuilles volantes ? Idées, impressions flottantes, subjectives, éphémères, jetées à la dérive pour faire venir le poème en nous… Comment l’esprit d’un lieu, un bruit, une image, des musiques, un texte, un travail, un film, un parfum-même, nous atteignent dans notre quotidien, nous altèrent et nous désaltèrent, nous invitent à renouveler notre présence au monde.
D’où vient que lorsqu’on voit un film l’on sait, dès la première image, que ce sera un film fort, que l’on ne l’oubliera pas de sitôt ? Qu’il vous fait violence et qu’il vous fera vivre, qu’il changera votre rapport au monde, aux êtres, à l’espérance ? Et que l’on se trompe là-dessus presque jamais, tant c’est certain. Comme une rencontre ! Ainsi en va-t-il avec « L’inquiet » de Miguel Gomes, le premier volume de sa trilogie des « Mille et une nuits ».
 « L’inquiet » est le premier volume, sorti en salles le 29 Juin, de la trilogie des « Mille et une nuits », de Miguel Gomes. Les deux films suivants sont attendus pour juillet et août. Dès le premier plan du film, l’on est saisi. Saisi par l’énergie rassemblée, condensée. Ce film est une arme. Il nous met en éveil et nous arme pour penser.
« L’inquiet » est le premier volume, sorti en salles le 29 Juin, de la trilogie des « Mille et une nuits », de Miguel Gomes. Les deux films suivants sont attendus pour juillet et août. Dès le premier plan du film, l’on est saisi. Saisi par l’énergie rassemblée, condensée. Ce film est une arme. Il nous met en éveil et nous arme pour penser.
D’emblée, l’annonce du déploiement. Pareil en musique lorsque l’accord d’attaque installe au fond, avec autorité, un silence. Mobilisation immédiate de toute l’oreille pour la révélation de la promesse. Non pas que le film soit parfait. En tout cas, son accomplissement n’est pas de l’ordre de ce que l’on entend généralement par là. Non, le collage est rugueux. Il accroche et écorche. Le montage ne s’articule pas selon la belle harmonie sucrée, mélodieuse à laquelle nous sommes habitués. Cela parait souvent être de guingois, peut-être même maladroit. En fait, tout cela se cherche et c’est ce qui nous touche. C’est cette esthétique-là qui émeut et parle. Émergent en nous de nouvelles émotions qui fondent un être-au-monde nouveau. « L’inquiet » ne fait pas croire que ce nous voyons paresseusement à l’ordinaire est le réel. Il ne nous installe pas dans nos évidences. Il détache notre regard de visions aux perspectives trop bien assurées, aux cadrages propres. Il cherche la forme cinématographique apte à nous faire toucher du doigt la plasticité de la mécanique du monde pour en dégager la puissance. C’est fragile, incertain, mais tellement encourageant, tellement mobilisant. Ici, le poème jaillit du documentaire. Mieux, le documentaire est poème.
C’est le travail de la fiction, soutenu par la structure narrative du conte des « Mille et une nuits » qui n’est en rien -faut-il le dire- son illustration, qui permet l’émergence d’un documentaire de cette trempe. Cette volonté fictionnelle structure le film, en libère la pensée en approchant une forme qui le rend présent aux injonctions du réel. Que demander d’autre au cinéma que de nous donner des ressources pour penser et agir, non pour geindre, gémir, pleurer avec les endeuillés enterrant leurs morts. En fait, ce film nous ressuscite. Ce sont des « Magnifiques » que nous croisons. Sortie du tombeau.
 « L’élargissement du poème » de Jean-Christophe Bailly… Voilà ce que je lisais comme en écho ce mercredi-là en me rendant voir ce film. Je voulais d’abord échapper à la canicule oppressante qui s’installait sur Paris. Fuir cet enfer dans une salle obscure et fraiche, comme un égaré en proie à un délire mystique ! Difficile de ne pas établir des correspondances subjectives entre le film que je voyais et le livre dont je venais juste de suspendre la lecture. Parler d’un livre c’est inviter à le lire et me voilà bien embarrassé craignant que sa lecture, non pas déçoive, mais déconcerte trop.
« L’élargissement du poème » de Jean-Christophe Bailly… Voilà ce que je lisais comme en écho ce mercredi-là en me rendant voir ce film. Je voulais d’abord échapper à la canicule oppressante qui s’installait sur Paris. Fuir cet enfer dans une salle obscure et fraiche, comme un égaré en proie à un délire mystique ! Difficile de ne pas établir des correspondances subjectives entre le film que je voyais et le livre dont je venais juste de suspendre la lecture. Parler d’un livre c’est inviter à le lire et me voilà bien embarrassé craignant que sa lecture, non pas déçoive, mais déconcerte trop.
Bref, je crains qu’il demande trop d’endurance, de ténacité à un moment où nous aspirons tous, légitimement, à des lectures certes stimulantes mais plus récréatives, exigeant une attention moins soutenue. Ou bien même que certains soient encore en recherche d’écrits plus instructifs et plus utiles car plus en prise avec une actualité qui sollicite beaucoup, et en urgence. De toute évidence, ce livre ne relève pas de ces catégories. Il peut donc décevoir des attentes, brouiller les pistes et faire qu’on en abandonne la lecture. Il est donc hélas toujours possible qu’au hamac l’ouvrage fasse passablement bailler. Pourtant, sa lecture croise des préoccupations communes et des engagements envers la société des hommes, leurs travaux et leurs jours où nous sommes souvent camarades.
On y retrouve « l’aimable simplicité du monde naissant » (Fénelon), et le monde n’a jamais fini de naître. Peut-être alors que cette proximité, cette présence au monde motiveront suffisamment pour tenir ferme le livre ouvert et l’esprit en alerte jusqu’au bout.
« L’élargissement du poème » résulte d’une reprise d’articles et de différentes contributions de l’auteur. Le livre n’a pourtant rien d’une simple compilation. Il forme un écheveau dense mais souple à délier. Il développe des cohérences, tresse des parcours erratiques possibles. Cette écriture appelle à revenir, parfois de façon aléatoire, au texte déjà lu pour en dénouer la chevelure, trouver des richesses de lectures insoupçonnées ou passées inaperçues au premier balayage des yeux. Idées seulement entrevues, pas encore assimilées, ni même pensées. Il faut s’attarder. Il s’agit d’entrer en méditation (faire son chemin). Au fond, ce livre est un exercice de ralentissement. Un chapitre d’ailleurs en dit un peu la méthode. Et la vacance, n’est-ce pas ralentir pour laisser venir à soi l’étendu ? Avoir une lecture appliquée. Pour autant, il faut consentir à se perdre dans ses méandres, sans raidissement de la nuque. Cette disposition d’esprit n’est pas donnée, il faut la conquérir. Cette nonchalance est une exigence qui a ses contraintes. Gagner cette espèce de dessaisissement pour se laisser dépayser se révèle presque un effort ascétique ! On ne nage pas facilement en eau profonde. La récompense spirituelle est à ce prix.
Petite citation. « Dans le Bartleby de Melville, dans les personnages de Walser, dans les héros de l’Amérique de Kafka, dans ceux du Tchevengour de Platonov, c’est-à-dire aussi bien dans l’univers capitaliste que dans ce qui s’est retourné contre lui, nous voyons passer ces figures de cancres obstinés et de rêveurs souverains. Peut-on fonder sur eux une politique ? Je ne le crois pas, ils sont hors de la fondation, de toute fondation, et pour eux ruine et chantier sont synonymes. Mais mystérieusement, ce sont nos guides, car c’est sous leur pas que le monde revient comme cette brillance aveugle où l’homme, presque indument est admis ». Il n’est toutefois pas nécessaire d’avoir lu toute cette littérature pour comprendre ce que dit Jean-Christophe Bailly ! Et encore, la quatrième de couverture : « Élargir, c’est agrandir, mais c’est aussi libérer ce qui était détenu.  A partir de la « poésie élargie » de Novalis ce livre forme une boucle dont le poème est le nœud. Ce qu’il envisage, c’est une sortie hors des limites, non seulement du poète et de la littérature, mais aussi des hommes confinés dans des enclos qu’ils se sont donnés. L’indice et l’écho, le ricochet, la connexion, la résonance et l’évasion -tels sont les mots clés de cet élargissement proposé ici comme méthode ». Un moine poète, ailleurs, pas dans ce livre, parle lui d’alpage, de lecture d’alpage : « S’interdire de lire toute page qui ne soit pas un alpage; n’appeler page que celle-là qui est aussi alpage, qui en procure tout ensemble l’altitude, l’espace et la diversité ».
A partir de la « poésie élargie » de Novalis ce livre forme une boucle dont le poème est le nœud. Ce qu’il envisage, c’est une sortie hors des limites, non seulement du poète et de la littérature, mais aussi des hommes confinés dans des enclos qu’ils se sont donnés. L’indice et l’écho, le ricochet, la connexion, la résonance et l’évasion -tels sont les mots clés de cet élargissement proposé ici comme méthode ». Un moine poète, ailleurs, pas dans ce livre, parle lui d’alpage, de lecture d’alpage : « S’interdire de lire toute page qui ne soit pas un alpage; n’appeler page que celle-là qui est aussi alpage, qui en procure tout ensemble l’altitude, l’espace et la diversité ».
 « Soleil sur fond bleu » de Christine Spianti peut se lire comme un exercice de poésie pratique qui, me semble-t-il, n’est pas sans lien avec la méthode proposée par Jean-Christophe Bailly. Où, comme sur le bleu du ciel s’accrochent les nuages, sur le texte se brodent des images. Le texte dialogue avec elles pour fixer la pensée et faire poème. Oui, fixer la pensée, comme au temps de l’argentique où, après le bain de la révélation, se fixait le tirage sur le papier. C’est ainsi que s’agencent sur la page textes et images pour donner à voir la pensée. Pour autant, ce livre n’est pas ce qu’on appelle communément un livre d’art. Il se reçoit comme on recueille la parole de l’ami.
« Soleil sur fond bleu » de Christine Spianti peut se lire comme un exercice de poésie pratique qui, me semble-t-il, n’est pas sans lien avec la méthode proposée par Jean-Christophe Bailly. Où, comme sur le bleu du ciel s’accrochent les nuages, sur le texte se brodent des images. Le texte dialogue avec elles pour fixer la pensée et faire poème. Oui, fixer la pensée, comme au temps de l’argentique où, après le bain de la révélation, se fixait le tirage sur le papier. C’est ainsi que s’agencent sur la page textes et images pour donner à voir la pensée. Pour autant, ce livre n’est pas ce qu’on appelle communément un livre d’art. Il se reçoit comme on recueille la parole de l’ami.
On entre en partage. Nous croiserons là, parmi beaucoup d’autres, Walter Benjamin, Pierre-Paolo Pasolini, Paul Klee, Giuseppe Penone, Breton, Piero de la Francesca, des enfants. Une lecture vagabonde, à la cuisine on imagine, en épluchant les légumes, d’une page du Corriere della Sera. Magdalena et Jean-Sébastien Bach mis en miroir avec la « Fiancée » du tableau de Rembrandt. Le même ciel vu de la même fenêtre, décrit chaque jour durant plusieurs semaines à différentes heures. Deleuze, les fusillés du Mont Valérien, Joseph Beuys, Georges de la Tour, Miro, François Maspero. Nicolas de Staël et Van Gogh. Christine Spianti ne parle pas sur eux, ni non plus tellement d’eux. Elle nous fait partager l’intimité d’une conversation qu’elle entretient avec eux. Elle se met dans leurs pas, marche à leur souffle, épouse la sinuosité de leurs sentiers de création.
Voilà ce qui la relie au tout-monde, et de l’écrire sans crainte d’abuser de la pensée d’Édouard Glissant. Voilà ce qui la solidarise. Subversion du temps et de l’espace par l’écoute du silence qui s’instaure alors en elle et en nous. La joie spacieuse. Ce chemin qu’elle se fraie dans la toile, qu’elle tisse avec sa récolte de pensées/images sauvages, qu’elle confronte à son quotidien, c’est le poème. Une citation ? Arbitraire d’une citation : « En formation de CAP au CFA de Vesoul, une apprentie esthéticienne refuse de serrer la main des puissants (Président de la République, ministres et intendants en visite). Il lui tend la main et cette petite fille-là, tout d’un coup, se retourne et s’écarte. Elle remet tout en ordre, le réel apparait avec le refus. Haut courage de fille du peuple, courage ordinaire. Toute seule. Désapprouvée. Elle avait du se le promettre très fort. Elle l’a fait. Leçon d’intégrité ». Suit, après : « 09 h-37, ciel bleu troué de nuages s’épaississant ou descendant jusqu’à l’horizon des maisons où il devient mauve et un peu menaçant de pleuvoir ».  Juste avant un dessin colorié de Thomas Hirschhorn, « Crystal of resistance. 2011 » : « LOVE (acte symbolique) POLITICS (courage devant le puissant) AESTHETICS (esthéticiennes) PHILOSOPHIE (refus critique). Il y aussi la conviction, la précarité, l’urgence ». Suit alors une citation du Manifeste du Parti Communiste : « Tout ce qui était solide et stable est ébranlé, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés, enfin, d’envisager leurs conditions d’existence et leurs relations réciproques avec des yeux dégrisés… ».
Juste avant un dessin colorié de Thomas Hirschhorn, « Crystal of resistance. 2011 » : « LOVE (acte symbolique) POLITICS (courage devant le puissant) AESTHETICS (esthéticiennes) PHILOSOPHIE (refus critique). Il y aussi la conviction, la précarité, l’urgence ». Suit alors une citation du Manifeste du Parti Communiste : « Tout ce qui était solide et stable est ébranlé, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés, enfin, d’envisager leurs conditions d’existence et leurs relations réciproques avec des yeux dégrisés… ».
« La Sapienza » : beauté, beauté inouïe, claire, lumineuse de ce film d’Eugène Green… Une esthétique sur le fil du rasoir, d’une pureté qui fait peur. On redoute tant que le réalisateur sombre dans le cliché du beau style, où de « subliminales » images « vulgarisent » en mirage d’élégants espaces italiens, marbrés, roses, bleus et dorés comme on en trouve congelés dans les catalogues de voyages. Pauvres images de nos pauvres rêves. Freud disait, lorsqu’il n’allait pas trop bien, qu’il avait besoin d’Italie ! Oui, mais de quelle Italie parlons-nous ? Où l’on voit ici que ces beaux cadres ne se réduisent pas à la seule ornementation qu’on leur assigne. Ils font « monde ». C’est l’architecture même d’une pensée qu’ils portent et dont ils deviennent la métaphore. Structuration de l’espace-temps par la pensée qui alors s’en échappe, ouvrant sur un ciel qui n’est pas une clôture mais la mesure de l’incommensurable.  Architecture, musique, mathématique. Nous voyons la pensée s’accomplir dans une sorte d’assomption.
Architecture, musique, mathématique. Nous voyons la pensée s’accomplir dans une sorte d’assomption.
Notre regard est lavé, débarrassé des clichés convenus qui nous prive de nous confronter au travail d’une pensée et en gomme la force subversive. Ces traces monumentales, ici baroques, témoignent, sont signes vivants. Le film est juste. Il nous met à l’épreuve. Il nous rend présent. Cet ordonnancement du monde nous parle encore. Cette parole est performante, elle nous dit des choses puissantes, irrigue encore mystérieusement nos vies d’aujourd’hui. Elle appelle le miracle, renouvelle la sagesse. C’est pourquoi ce film est beau et mystérieusement si nécessaire. Jean-Pierre Burdin
 secret de sa mère, formulé comme dans un mirage sur son lit de mort : « Va, mon fils, va, retourne à la rue Darwin ! ». Et le jeune homme de partir à la conquête de ses origines, de sa filiation, convaincu qu’il lui faut résoudre l’énigme de sa naissance pour espérer enfin pleinement vivre…
secret de sa mère, formulé comme dans un mirage sur son lit de mort : « Va, mon fils, va, retourne à la rue Darwin ! ». Et le jeune homme de partir à la conquête de ses origines, de sa filiation, convaincu qu’il lui faut résoudre l’énigme de sa naissance pour espérer enfin pleinement vivre…