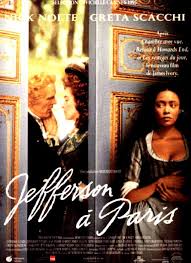En ce cinquantième anniversaire des événements du mois de mai 1968, fleurissent sur les écrans et dans les librairies moult documents et témoignages. Pour encenser ou disqualifier la révolte citoyenne, étudiante et ouvrière, qui embrasa la France durant plusieurs semaines… Un dossier chaud que Chantiers de culture inaugure avec trois ouvrages majeurs et une originale collection de films. Avant de laisser la parole, au fil du mois, à divers acteurs ou personnalités emblématiques qui font retour sur ces temps troublés.
Rues dépavées, voitures incendiées, barricades assiégées, facs et usines occupées, visages ensanglantés… La capitale à feu et à sang, Paris brûle-t-il ?, s’interroge le citoyen de province à cent lieux des émeutes qui secouent le Quartier latin. À l’heure où l’ORTF est en grève, que les journaux télévisés sont pilotés en direct de l’Elysée, seules les radios périphériques commentent les événements. Au cœur de l’action, voix essoufflées entre jets de grenades lacrymogènes et charges des CRS !
Loin de l’effervescence parisienne, entre Cherbourg sa ville natale et l’université de Caen où il est inscrit en section philo, un jeune homme vit aussi des heures chaudes. Mais depuis quelques mois déjà… « À Caen, Mai 68 commence en janvier », se souvient Jean-Pierre Le Goff dans La France d’hier, Récit d’un monde adolescent, Des années 1950 à Mai 68. Avec la réception mouvementée au cri de « Peyrefitte démission » du ministre de l’Éducation nationale venu inaugurer la nouvelle fac des Lettres le 18 janvier et, quelques jours plus tard, la grève illimitée votée par les 1500 ouvriers de l’usine Saviem de Caen. Le 26 janvier, la manif ouvrière, que les étudiants ont rejointe, tourne à l’émeute. Des affrontements qui durent toute la nuit, plus de 200 blessés, une répression policière qui suscite une large indignation. « Des triques à la mode de Caen », titre Le Canard Enchainé en première page ! Plus sérieusement, l’éditorialiste du quotidien Ouest-France constate que « pour la première fois à Caen, des jeunes sont descendus dans la rue. Avec des pierres dans les mains et des boulons dans les poches ». Et de poursuivre : « Dévalorisés à l’usine, ces jeunes ont voulu vendredi se valoriser dans la violence […] Il est urgent de prendre conscience de l’impatience de tous ces jeunes, impatients à vingt ans de mordre au fruit d’une vie dont on ne cesse de vanter le progrès ! Déçus trop longtemps, ils finiront par se croire collectivement victimes d’un mirage. Et ils viendront dire à leurs aînés qu’on  leur a menti ». La mèche est allumée, les meneurs autoproclamés du printemps parisien, « juif-allemand » ou maoïste, n’ont toujours pas accaparé les feux des projecteurs, désormais plus rien ne sera jamais comme avant !
leur a menti ». La mèche est allumée, les meneurs autoproclamés du printemps parisien, « juif-allemand » ou maoïste, n’ont toujours pas accaparé les feux des projecteurs, désormais plus rien ne sera jamais comme avant !
Qu’on se le dise et avant tout qu’on le lise, « La France d’hier » est un grand livre ! Pas seulement parce qu’il narre les événements de mai 68 d’un regard décalé, surtout parce qu’il les replace dans le contexte généralisé d’une France en pleine mutation, en plein basculement d’une époque l’autre où tous les repères générationnels hérités de l’après-guerre, éthiques – politiques – économiques, arrivent à saturation. Un modèle social s’effondre, la frustration est son comble. Et si l’impossible devenait possible : vivre dignement, partager les fruits de la croissance, libérer la parole, proclamer l’égalité des chances à l’école, briser les chaînes de l’usine ? À travers son parcours singulier d’un adolescent de province, Jean-Pierre le Goff en sociologue avisé nous conte de l’intérieur ce basculement sans retour dans un autre monde. Au lendemain de la guerre d’Algérie et en pleine guerre du Vietnam, entre catéchisme et premiers baisers volés, « les débuts de la grande consommation et des loisirs de masse, le livre de poche, le cinéma, la publicité, les lumières de la ville, le quotidien des femmes, le yéyé »… Une plongée fascinante, non sans humour et tendresse, dans cette France d’antan que la ménagère de moins de cinquante ans n’a pu connaitre, un document passionnant pour les survivants de ce temps révolu auxquels Le Goff offre une seconde jeunesse !
Et l’historienne Ludivine Bantigny, enseignante à l’université de Rouen Normandie, de lancer un autre pavé dans la mare avec la publication de 1968, de grands soirs en petits matins, un titre en hommage au fameux film de William Klein, tourné au jour le jour en ces heures chaudes ! Dès 1967, les braises sont ardentes, les disparités flagrantes, les grèves fréquentes. La production stagne, le chômage s’accroit, « fin 1967 à Longwy, les moins de 25 ans représentent désormais 50% des demandeurs d’emploi contre 25% deux ans auparavant […] Plus de 5 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté et 2 millions de salariés gagnent moins de 500 francs par mois, soit l’équivalent de 750 euros ». Non, contrairement au célèbre éditorial du quotidien Le Monde, la France ouvrière ne s’ennuie pas en ces années-là : elle souffre, galère, courbe l’échine et ne dit mot, se révolte parfois. À la Rhodiaceta de Besançon en février-mars 67, en Guadeloupe aux mêmes dates, aux chantiers navals de Saint-Nazaire en avril, pour ne citer que les conflits les plus emblématiques et au retentissement national… À l’unisson de Le Goff, en ce mois de janvier 68, « Caen fut « banc d’essai » et rampe de lancement », note la chercheuse aux premières pages de son volumineux ouvrage. De premiers liens se tissent entre monde ouvrier et monde étudiant, ténus et fragiles. Les jeunes de la fac sont souvent marqués par une idéologie d’extrême-gauche, les jeunes à l’usine les considèrent pour beaucoup comme des « favorisés, des fils de bourgeois ». Si la population étudiante a explosé (500 000 en 1968, 100 000 vingt ans plus tôt), il n’empêche : les enfants d’ouvriers ne représentent que 10%, les  enfants de paysans 7%… Pas étonnant donc que les deux mondes se toisent, s’épient, s’observent ! Hors les outrances des uns, les jeux de mots douteux des autres, la rencontre se fera pourtant au fil des événements.
enfants de paysans 7%… Pas étonnant donc que les deux mondes se toisent, s’épient, s’observent ! Hors les outrances des uns, les jeux de mots douteux des autres, la rencontre se fera pourtant au fil des événements.
C’est le grand mérite du livre de Ludivine Bantigny : quitter le pavé parisien et plonger dans les archives pour s’en aller explorer les chemins de province. Partout où ça bouge, ça parle, ça lutte… Elle déroule « l’événement 68 » pour montrer en profondeur ce qui change : l’avénement, l’éclosion d’un temps nouveau où chacun prend le temps de se parler, de se rencontrer, de se connaître et se reconnaître en de communes aspirations ! Ce qui compte, au final ? « Le temps d’un printemps, l’événement a renoué avec la démocratie du quotidien, il a bouleversé des existences », conclue l’historienne. « Il a rendu palpable le spectre d’autres avenirs, renoué avec l’hypothèse de la révolution en la rendant tangible et possible, fait de l’imagination une action. Le travail, les métiers, la culture, l’âge, l’art, le corps et la sexualité, le temps même y ont été repensés ».
Un bouleversement dont témoigne à juste titre Mai 68 par celles et ceux qui l’ont vécu ! Une démarche inédite, comme surgie de l’imaginaire de soixante-huitards sur le retour : enfants, jeunes et adultes, étudiants et ouvriers, salariés ou professions libérales de tout bord, reprendre fil avec leur mémoire et témoigner de « leur » Mai 68… Sans filtre, sans censure, en dix lignes ou trois pages, juste leurs récits organisés et coordonnés par trois universitaires, spécialistes de cette époque ( Christelle Dormoy-Rajramanan, Boris Gobille et Erik Neveu). « C’est un livre d’histoire, d’histoires au pluriel », précisent les trois chercheurs dans la préface, « écrit par des anonymes. Tel est le premier pari du livre : redonner la parole à celles et ceux qui en ont été privés au fur et à mesure des commémorations  décennales ». Et de poursuivre : « les témoignages rassemblés ici, dans tout leur bariolé, disent à hauteur d’homme, à hauteur de femme, à hauteur d’enfant, ce que fut la chair concrète de l’événement ».
décennales ». Et de poursuivre : « les témoignages rassemblés ici, dans tout leur bariolé, disent à hauteur d’homme, à hauteur de femme, à hauteur d’enfant, ce que fut la chair concrète de l’événement ».
Une affirmation qui se vérifie au fil des pages. Le Havre, Valenciennes, Dijon, Niort, Poitiers et tant d’autres villes, quartiers cossus ou banlieues ouvrières, fils à papa ou femme au foyer, acteur chaud bouillant ou spectateur atterré, employée des postes ou animateur culturel : ils viennent de partout et parlent de tout. Surtout, quelle que soit leur appréciation finale, victoire ou défaite, de « leur » Mai 68, du comment et pourquoi ces quelques semaines hors norme ont chamboulé, transformé leur existence. À jamais. Un livre aux senteurs poétiques et sensuelles quand l’ordinaire se révèle extraordinaire, des pages libérées de toute langue de bois à picorer au fil du quotidien pour que perdure le bonheur du dire ensemble. Yonnel Liégeois
À voir, le 02/05 sur la chaîne Toute l’Histoire à 20h50 : Les racines de mai, un documentaire de David Martin (60mn). Bien avant le fameux printemps, le film révèle combien la colère grondait dans le pays dès 1967 ! En compagnie des deux historiens Ludivine Bantigny et Xavier Vigna, retour sur les faits au côté des ouvriers de Massey-Ferguson et des cheminots de Lille.
Le cinéma de Mai 68
En deux coffrets superbement agencés (Une histoire et Un héritage), les éditions Montparnasse nous offrent une fantastique plongée dans Le cinéma de Mai 68 ! Si chanteurs et comédiens ont franchi les portes des ateliers à l’occasion des occupations d’usines, les cinéastes y ont aussi braqué leurs caméras. Du cinéma militant et partisan, certes, mais révélateur d’une démarche, d’un projet : filmer de l’intérieur, être partie prenante de l’Histoire en train de se faire. Du  « Premier mai à Saint-Nazaire » à « Citroën-Nanterre », pour beaucoup des films « inestimables, rarement montrés, voire occultés », commente Patrick Leboutte, le coordinateur du projet.
« Premier mai à Saint-Nazaire » à « Citroën-Nanterre », pour beaucoup des films « inestimables, rarement montrés, voire occultés », commente Patrick Leboutte, le coordinateur du projet.
Un printemps du cinéma qui dévoile Mai 68 sous tous ses aspects : ouvrier, paysan, étudiant. Qui se poursuit, dans le second coffret, avec l’objectif braqué sur le collectif Cinélutte opérant de 1968 à 1978, « symbolisant à lui tout seul tous les enjeux de la période et offrant quelques uns de ses plus beaux films du cinéma militant ». Des titres emblématiques ? « Le joli mois de mai », « Oser lutter, oser vaincre », « La reprise du travail aux usines Wonder » ou dix minutes d’intensité dramatique folle selon les propos de Jacques Rivette… Avec, en prime, « Reprise », le fameux film d’Hervé le Roux tourné trente ans plus tard : « Cette femme à la reprise du travail, comme une reprise de justice, j’ai décidé de la retrouver car elle n’a eu droit qu’à une seule prise et je lui en dois une deuxième ». Une précieuse collection, à offrir ou s’offrir. Y.L.
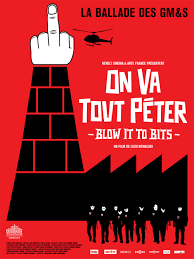 que l’actionnaire principal ou le donneur d’ordre vont faire davantage de profits ailleurs.
que l’actionnaire principal ou le donneur d’ordre vont faire davantage de profits ailleurs. les territoires en marge des grandes métropoles. Mais il est plus que ça.
les territoires en marge des grandes métropoles. Mais il est plus que ça.