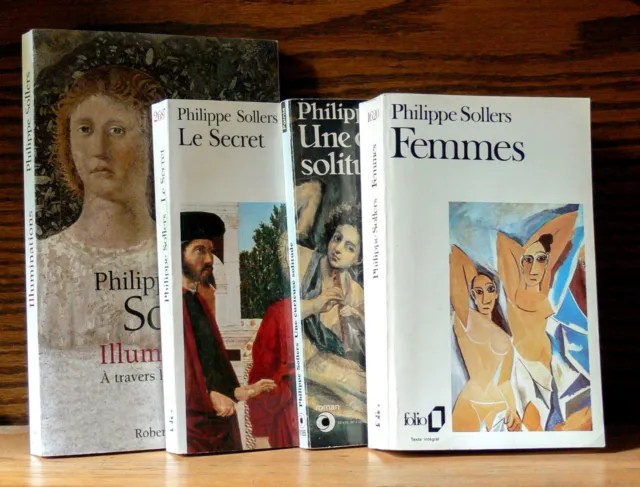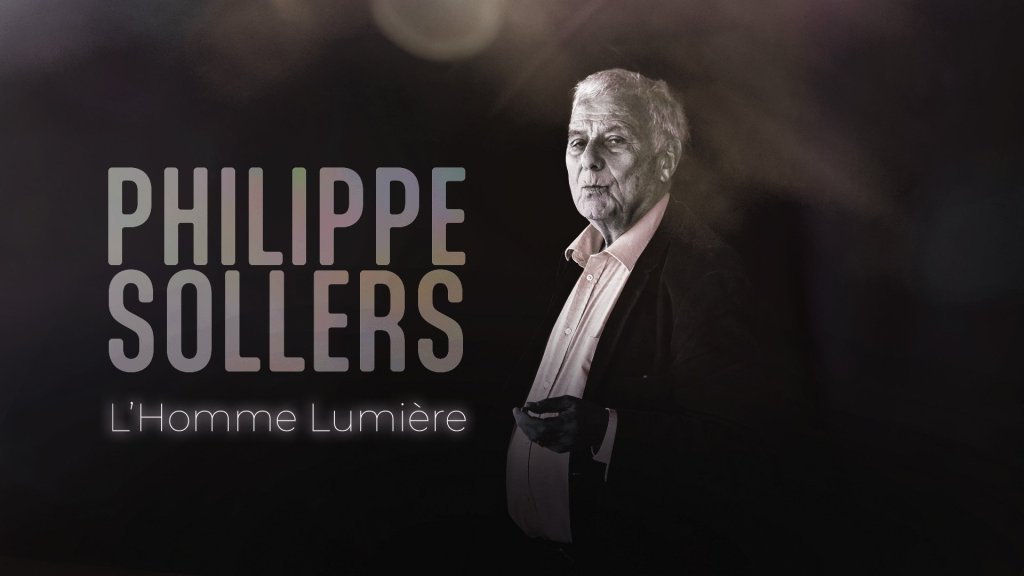Soixante-dix ans après sa mort, le 13 juillet 1954, Frida Kahlo, l’artiste mexicaine devenue icône, n’en finit pas de captiver. Au cours d’une existence menée au rythme de l’incendie, elle a tout vécu avec grâce et courage, au mépris de la douleur et des conventions. Communiste et féministe, libre et transgressive, elle s’est battue contre tous les carcans.

La postérité est capricieuse. C’est là son moindre défaut. Advient qu’elle ait du génie, gardant longtemps en lumière des êtres littéralement d’exception. Frida Kahlo est de ces élus. Soixante-dix ans après sa mort, elle n’est pas sortie de la mémoire de son pays natal, le Mexique, où elle concurrence la Madone, et sa peinture continue d’être exposée et admirée de par le monde. Il y a deux ans, l’exposition « Frida Kahlo, Au-delà des apparences » rencontrait un succès fou au palais Galliera, ce temple de la mode. Frida Kahlo n’a-t-elle pas inspiré de grands noms de la haute couture, tels Karl Lagerfeld, Jean Paul Gaultier, Alexander McQueen, Maria Grazia Chiuri, Yohji Yamamoto ou Ricardo Tisci ? On entrait dans son intimité, grâce à plus de 200 objets en provenance de la Casa Azul, sa demeure de famille devenue musée, sise à Coyoacan, au sud de Mexico. Il y avait de ses fameux vêtements aux couleurs vives, des lettres, des bijoux, des colifichets, des cosmétiques… Et aussi des prothèses, des corsets, ses bottines aux talons compensés. Cette artiste à l’insolite beauté, dont on connaît bien, désormais, la vie ardente et passionnée, comme on dit dans les journaux, a terriblement souffert dans son corps, depuis l’enfance jusqu’à son dernier souffle.
Alitée, elle entre en peinture comme en religion
À 6 ans, Magdalena Frida Carmen Kahlo est victime de la poliomyélite. Les morveux, en classe, la baptisent « Frida la coja » (Frida la boiteuse). Frida est née en 1904, sa mère analphabète dévote et son père photographe officiel au temps du général-président Porfirio Diaz. À la chute de ce dernier, il se retrouve simple photographe. Survient l’époque de la révolution mexicaine. Entre 1910 et 1920, le pays connaîtra soulèvements armés, coups d’État, conflits militaires. Le cinéma, local ou Hollywoodien, en popularisera les figures, celle du chef guérillero Zapata, par exemple, sous les traits de Marlon Brando dans une réalisation d’Elia Kazan. Quant au film Que viva Mexico !, du grand cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein, il demeurera, par la force des choses, un chef-d’œuvre empêché.

Frida a 15 ans en 1922. Elle quitte le cours supérieur du Colegio Aleman, pour entrer dans le meilleur établissement du pays. Sur un total de 2 000 élèves, il n’y a que 35 filles. Le sort va s’acharner sur ce corps fragile. Le 17 septembre 1925, Frida monte dans l’autobus qui doit la ramener chez elle. Le véhicule percute un tramway. Il y a des morts. Frida est atrocement blessée. Une barre de métal a traversé son abdomen et sa cavité pelvienne. Cela lui causera, ultérieurement, fausses couches et curetages. Sa jambe droite est fracturée en onze endroits. Bassin, côtes et colonne vertébrale sont brisées.
Elle reste alitée durant trois mois, dont un à l’hôpital. Elle y retourne un an après l’accident. On découvre qu’une de ses vertèbres est fracturée. Pendant neuf mois, elle est forcée de supporter des corsets en plâtre. C’est alors qu’elle entre en peinture comme en religion. Elle a ces mots : « Je ne suis pas morte et j’ai une raison de vivre, c’est la peinture ». Elle doit encore subir de nombreuses interventions chirurgicales et rester couchée. On fabrique un chevalet spécial. On installe un baldaquin au-dessus de son lit, avec un miroir pour ciel, ce qui lui permet d’user de son reflet comme modèle. N’est-ce pas, dans ce dispositif, qu’il faut voir la raison des 55 autoportraits en petit format qu’a peints Frida Kahlo, sur un total de 143 tableaux ?
Une vie amoureuse bien remplie
Elle apprend seule, acquiert d’emblée, en toute savante innocence, une maîtrise singulière, la franchise du trait, l’alchimie chromatique. En 1928, elle rencontre Diego Rivera, lui montre de ses toiles. Plus tard, il dira qu’elles « révélaient une extraordinaire force d’expression, une description précise des caractères et un réel sérieux. Elles possédaient une sincérité plastique fondamentale et une personnalité artistique propre ». Ces toiles « véhiculaient une sensualité vitale, encore enrichie par une faculté d’observation impitoyable, quoique sensible. Pour moi, il était manifeste que cette jeune fille était une véritable artiste ».

Le titan qui glorifie, sur une grande échelle, la geste révolutionnaire des paysans et des ouvriers, a reconnu, en Frida Kahlo, une âme sœur dans l’art. Ils se marient le 29 août 1929. C’est l’aube d’une relation intensément passionnée, devenue légendaire, entre la jeune femme aux bandeaux noirs, à la vénusté singulière, au gabarit corporel de statue de Tanagra et cet homme de vingt et un ans son aîné, grand et gros, qui semble un ogre bienveillant. Avec ça, deux tempéraments de feu. Diego n’a que faire de la fidélité conjugale. Frida, de bon cœur, lui rend la monnaie de sa pièce. Bisexuelle sans complexe, elle séduit hommes et femmes à parts égales. Ils divorcent en décembre 1938, se remarient en décembre 1940. On ne peut entrer, ici, dans tous les chapitres du roman érotique de Diego et Frida, à laquelle on prête de nombreuses liaisons, entre autres avec Joséphine Baker. Il y a, sur ce thème, une dizaine d’ouvrages en librairie.
Frida n’aime ni les États-Unis, ni les Américains
Un autre aspect de la personnalité de Frida ? Son adhésion au communisme. En 1928, son amie très chère, la photographe italienne Tina Modotti, l’incite à s’inscrire au Parti communiste mexicain. Elle n’en démordra pas. Elle considère son adhésion comme un acte résolu d’émancipation, dans un pays où le machisme a des fondements historiques. Au rebours de la majorité des femmes mexicaines, elle aspire à étudier, voyager, être libre, à connaître le plaisir. En 1935, elle ne peindra que deux tableaux. L’un a pour titre « Quelques petites piqûres ». Le thème en est le meurtre d’une femme par son mari jaloux. Frida a voyagé, seule ou avec Diego. Aux États-Unis voisins, d’abord, où au début des années 1930, à la faveur du New Deal(la nouvelle donne) institué par Roosevelt, il est invité à peindre dans diverses institutions. Frida n’aime ni les États-Unis, ni les Américains.

En 1939, elle est invitée à participer, à Paris, à l’exposition sur le Mexique organisée par le gouvernement Lazaro Cardenas. Elle est présentée à Yves Tanguy, Picasso, Kandinsky… Elle déteste Paris, qu’elle trouve sale. La nourriture l’indispose. Elle attrape une colibacillose. Quant aux surréalistes, elle écrit à l’un de ses amants, le photographe Nickolas Muray : « J’aimerais mieux m’asseoir par terre dans le marché de Toluca pour vendre des tortillas que d’avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris ». Elle loge chez André Breton, qu’elle juge « prétentieux ». Elle sent chez lui, à son égard, du mépris et de l’incompréhension. Il la range abusivement dans le tiroir du surréalisme. Elle, c’est du réalisme et non du rêve qu’elle se réclame, de ce réalisme plus tard dit « magique », consubstantiel à l’Amérique latine. Elle se venge sur place, en ayant une histoire avec Jacqueline Lamba, la femme du « pape du surréalisme ».
Frida Kahlo et Léon Trotsky
Cet épisode prend la suite de la venue de Breton à Mexico, l’année précédente, pour une série de conférences. Breton et son épouse sont accueillis par Frida et Diego. Breton, fasciné, écrit : « L’art de Frida Kahlo de Rivera est un ruban autour d’une bombe ». La formule n’amena pas Frida à de bonnes intentions, sa liaison avec Jacqueline s’était nouée à Mexico. En septembre 1937, Frida et Diego ouvrent les bras à Léon Trotsky et son épouse. C’est à Coyoacan qu’il sera assassiné, le 21 août 1940, par Ramon Mercader, d’un coup de piolet dans le crâne. Quelque trente ans plus tard, Joseph Losey tourne L’assassinat de Trotsky, avec Richard Burton dans le rôle de l’ancien chef de l’Armée rouge et Alain Delon dans celui de l’agent de Moscou.

Frida Kahlo et Léon Trotsky se sont aimés. Elle a peint Autoportrait dédié à Léon Trotsky, ou Entre les rideaux ainsi dédicacé : « Pour Léon Trotsky, cette peinture avec tout mon amour ». En août 1953, Frida est amputée de la jambe droite jusqu’au genou. Après une pneumonie, elle s’éteint dans la nuit du 13 juillet 1954. Son dernier mot aurait été « Viva la vida ». Ayant été couchée trop longtemps, elle veut être incinérée. Ses cendres sont à la Casa Azul, dans une urne qui a la forme de son visage. Diego Rivera lui survivra trois ans. Avant de s’éteindre, Frida Kahlo avait peint « Autoportrait avec Staline ».
Ancrée dans la culture populaire
Frida Kahlo, stoïque créature désirée, désirante, a souffert dans sa chair à l’instar d’une martyre chrétienne. Convertie au communisme, entrée en peinture par la fenêtre de l’hôpital, ne s’est-elle pas révélée souveraine dans sa liberté infinie, conquise avec grâce ? Avec ça quel caractère ! Sa peinture est crue. Elle a pu y faire figurer son arbre généalogique, s’y montrer avec une fleur dans les cheveux, un perroquet, Pancho Villa, des fruits rouges ou un bloc de métal dans sa poitrine ouverte. Elle est unique. La bellissime Salma Hayek l’a incarnée dans le film de Julie Taymor.

En 2022, à Toulon, c’était la création de Viva Frida, mise en scène de Karelle Prugnaud, avec Claire Nebout dans le rôle. J.-M. G. Le Clézio, l’un de nos prix Nobel, a écrit Diego et Frida et Gérard de Cortanze s’est fait, en plusieurs volumes, l’historiographe de celle qu’il nomme « le petit cerf blessé ». Ne dirait-on pas une héroïne de Luis Buñuel ? Dans son film « Tristana », Catherine Deneuve souffre d’une tumeur à la jambe… Étendard féminin du Mexique, déité aztèque sophistiquée aux grands sourcils arqués, cette fille nature, à la fois princesse et peuple, règne aussi dans les rues. Des gens se font tatouer son visage sur les biceps, le ventre, les mollets.

On trouve à l’effigie de Frida la mexicaine des tapis, des puzzles, des T-shirts et moult autres babioles. Son existence posthume s’inscrit aussi dans la pacotille. Jean-Pierre Léonardini