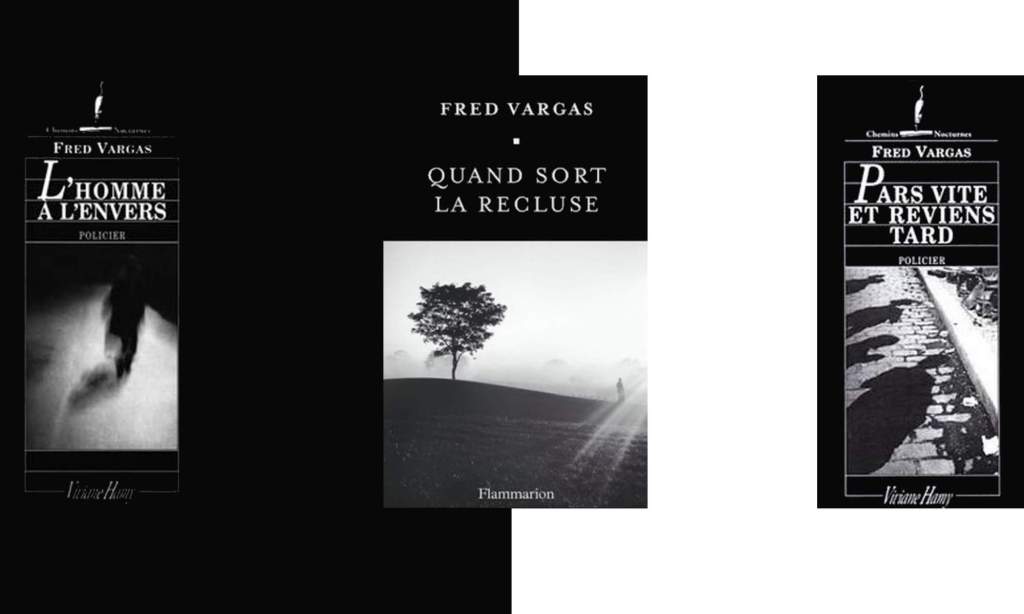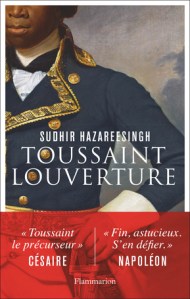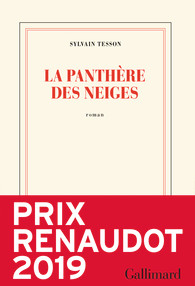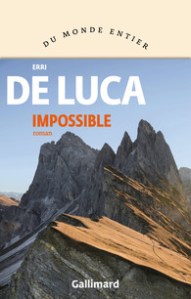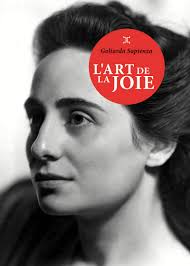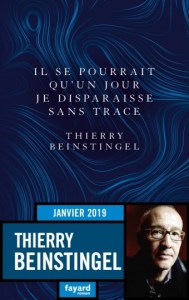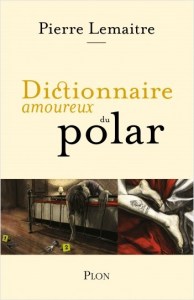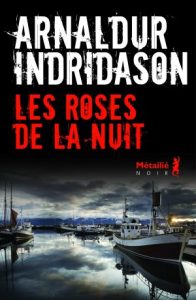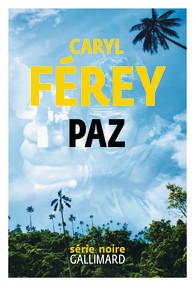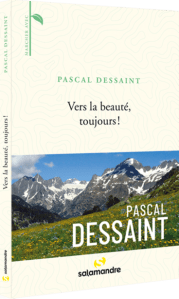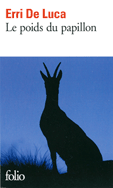À l’occasion de la parution de son dernier roman, Le tour de l’oie, le grand auteur italien Erri De Luca évoque ses années de jeunesse, ses combats et convictions avec le public français. À l’heure où Gallimard publiait Les poissons ne ferment pas les yeux et le Mercure de France Les saintes du scandale, tandis que ressortait en poche chez Folio Le poids du papillon, le ciseleur de mots au regard bleuté et envoûtant se confiait en exclusivité à Chantiers de culture. Retour sur une rencontre passionnante.
Yonnel Liegeois – Dans Le poids du papillon, vous dépeignez trois figures au fil des pages. Celles d’un braconnier, d’un chamois, et d’un papillon

Photo Daniel Maunaury/DR
justement : sous laquelle des trois avancez-vous masqué ?
Erri De Luca – Aucune, je suis juste le lieu de l’histoire, l’endroit où elle se déroule : je profite des droits d’auteurs mais je crois être seulement un rédacteur d’histoires ! Un « récolteur d’histoires » plus précisément, qui sont miennes ou d’autrui, envers lesquelles je suis à l’écoute. Vous le savez, je suis un pratiquant d’alpinisme, plus encore je suis un « écouteur » d’alpinisme. Quand des montagnards se sentent à l’aise, à l’écart des grandes voies ou des grandes parois, ils bavardent, ils se racontent. J’aime écouter, et retenir bien sûr. À la publication de Sur la trace de Nives (le récit de ses expéditions himalayennes dans les pas de la célèbre alpiniste italienne aujourd’hui disparue, ndlr), elle-même s’étonnait que j’aie pu retenir ainsi nos conversations sans jamais prendre de notes, je suis une espèce de réservoir d’histoires ! Dans l’un des psaumes de David, il y a une image qui me plaît où il prétend que « la divinité lui a creusé des oreilles ». Un verbe concret, manuel que les traducteurs modernes de la Bible délaissent au profit de « former », alors que dans l’hébreu ancien c’est le même mot qui définit l’action de creuser un puits. Qu’est-ce à dire, sinon que l’oreille de David est un puits où la parole divine entre et demeure ? Une transmission où, telles des gouttes d’eau, pas un mot ne se perd. Un puits où les mots peuvent être récupérés sans jamais gaspiller la réserve. Les histoires se présentent, ainsi, pour moi : des provisions dont je peux m’abreuver à tout moment.
Y.L. – À lire cette histoire de braconnier à l’heure de sa dernière chasse, on se dit que vous aimez bien laisser traîner une oreille sur les chemins de traverse ?
E.D-L. – Là ou ailleurs ! J’écoute, j’écoute où que je sois, là où je suis dans l’instant. J’ai écouté des braconniers et des chasseurs sans être moi-même ni l’un ni l’autre. Avec cette expérience de la montagne qui nourrit mon imaginaire, comme elle nourrit celui de tous ceux qui vont s’égarer là-haut : l’écoute des pierres, des arbres, des animaux… On ne peut défier la nature, je suis une fourmi face à un géant. Devant elle je suis à la rigueur un passant, celui qui bénéficie d’un sauf-conduit provisoire, jamais un résident.
Y.L. – Deux éléments sont frappants dans votre roman : d’abord la solitude de vos deux héros, chamois et braconnier, ensuite le fait que l’histoire se déroule intégralement sur les hauteurs, loin de la foule et de l’agitation. Faut-il donc désormais fuir la société pour se faire homme et braver l’altitude pour atteindre notre humanité ?
E.D-L. – J’apprécie la société parce qu’elle permet à une grande partie de ses membres de vivre, ou de survivre. Pour moi, la vraie question, ce n’est pas le choix de la solitude mais la pratique de l’isolement. La solitude relève d’une démarche poétique, pour ma part je suis né et j’ai grandi dans l’isolement quand, à 18 ans, je me suis retrouvé au cœur d’une génération d’insurgés : comme on retourne sa veste, mon caractère en fut renversé ! J’ai connu la violence faite et subie, je ne vivais que pour la cause. Tout le reste de mon existence, mes amours, mes lectures, je les vivais comme des éléments extérieurs à moi-même C’est une part de ma vie que je ne puis renier ou censurer. Mon engagement militant, dans les années 70, relevait de la nécessité. On ne devient pas révolutionnaire parce que l’on rêve d’aventure, on le devient parce que la situation est révolutionnaire et contraint les gens à réagir ainsi : je ne pouvais déserter ce combat, j’ai quitté Naples à cette époque pour appartenir totalement à la cause.
Y.L. – Entre votre précédent roman, Le jour avant le bonheur et celui-là, semble s’opérer justement comme un glissement entre révolte et apaisement. L’homme, et l’écrivain, aurait-il enfin touché à la sérénité, à défaut de n’être plus

Photo Daniel Maunaury/DR
un révolté ?
E.D-L. – Révolté, on ne l’est jamais seul, c’est un mot qui a horreur du singulier ! La révolution concerne une multitude en lutte, sans ce collectif être révolté n’a aucun sens, le mot a nécessité d’être relié à une expérience chorale. Je dois mon éducation sentimentale, qui englobe mes indignations, à ma ville de Naples. C’est là que se sont formées mes colères, mes compassions, mes hontes, c’est là où elles se sont ancrées historiquement et collectivement. C’est pourquoi j’éprouve quelques réserves à l’égard du titre « Indignez-vous » de Stéphane Hessel. « Indignons-nous » oui, d’autant que pour s’indigner il faut avoir expérimenté la honte. Je considère la honte comme le sentiment politique par excellence : c’est elle qui oblige à réagir, plus que la colère qui s’éteint et n’est que passagère. La honte, c’est une lèpre sur la peau qui a besoin d’être soignée ! L’indignation de ma jeunesse ? Une réponse à la honte d’appartenir à un monde qui fut responsable des pires massacres de l’humanité, je suis d’un siècle où l’histoire majeure est entrée dans les histoires mineures de chacun.
Y.L. – Osons la comparaison entre la position de chefs d’état actuels et l’attitude du roi des chamois : comme lui, ne vaut-il pas mieux se retirer élégamment plutôt que de risquer le mandat, le combat de trop ?
E.D-L. – À la différence de l’homme, l’animal sait lorsque vient le moment de se retirer. Il sait, dans le présent, ce qu’il doit faire. Aucun animal ne se repentit de ce qu’il a fait. À contrario, l’espèce humaine est peu lucide dans le présent, trop alourdie de cet immense passé chargé sur les épaules de chacun d’entre nous. Non seulement nous sommes surchargés de passé, mais en plus nous avons cette incroyable faculté d’imaginer le futur, de l’organiser : nous sommes ainsi coincés entre cette immensité du temps passé et celle du temps futur ! Alors, nous trébuchons dans le présent, souvent incapables de réagir au bon moment… La bête, au contraire, est précise, exacte à l’heure du rendez-vous, concentrée sur le présent parce que distraite ni par le passé ni par le futur : le chamois sait qu’il a épuisé ses forces et qu’il doit sortir de l’arène. Comme la mer est formée d’une myriade de gouttes, la vie est composée d’instants et le poids du papillon a exactement le poids du dernier instant, celui de l’ultime gouttelette. La supériorité de l’animal, la faiblesse de l’homme : l’animal sait quand il va mourir, le chasseur non.
Y.L. – Et le rendez-vous entre le chamois et le chasseur, à la vie à la mort, se  joue dans un décor grandiose ! Loin du délabrement actuel de l’Italie berlusconienne ?
joue dans un décor grandiose ! Loin du délabrement actuel de l’Italie berlusconienne ?
E.D-L. – La vie politique italienne ? Pour moi un sujet inintéressant, insignifiant… Je reste toujours émerveillé à l’écoute de gens d’autres pays qui se posent encore la question ! Il faut s’interroger aujourd’hui au delà de l’Italie : la politique a changé de centre, l’Europe n’est plus un centre, elle est une espèce de grande Suisse : une expression économique, une entité qui a juste unifié et sa monnaie et sa police. Ce qui rend l’ensemble peu intéressant, au contraire de ce qui se passe dans les pays au sud de la Méditerranée. En Turquie et en Syrie, là se joue l’avenir ! De même qu’en Amérique du Sud et en Afrique : je m’imagine un jour, nous Européens, devenir à notre tour les émigrants en Afrique… L’histoire offre parfois de belles surprises ! D’autant que nous Italiens, nous avons l’expérience, d’un bateau l’autre nous fûmes les meilleurs passagers du XXème siècle. En troisième classe, certes, mais ce siècle fut celui des grandes migrations pour nous. Y compris pour moi, qui suis venu travailler sur les chantiers en France… Je fus certainement le dernier italien, ouvrier maçon en France : le chef d’équipe était déjà portugais, l’italien l’entrepreneur qui organisait l’embauche !
Y.L. – Vous ne craignez donc point l’arrivée en masse de ces Africains qui débarquent à Lampedusa ?
E.D-L. – Aucunement, parce que l’Italie est une forme de pont jeté par l’Europe en direction du sud de la Méditerranée. De tout temps. C’est un fait historique, la géographie a bâti l’histoire de l’Italie. C’est donc un non-sens de construire des barrages pour rejeter à la mer des hommes qui fuient la guerre. Plus forte que le risque du naufrage et de la mort, ils éprouvent la nécessité de la fuite. Obéissons à notre géographie, laissons les passer, ils émigreront un peu partout en Europe, ils sont déjà arrivés à Paris : nous ne pouvons mettre un condom à l’Europe ! On peut arrêter un train, un avion, à pied l’homme passe partout. Même aux États-Unis, la frontière avec le Mexique est perméable.
Y.L. – À vous entendre parler aussi passionnément de l’avenir du monde, on est loin d’imaginer l’homme, autodidacte, plongé dans l’étude de l’hébreu ancien !

Photo Daniel Maunaury/DR
Cette langue vous subjugue toujours autant ?
E.D-L. – Je ne m’en lasse point ! Tous les jours, chaque matin au lever, en fait avant même le matin parce que je me lève très tôt, je lis un chapitre de la Bible en hébreu ancien. Pas mon livre de chevet donc, celui du réveil : un besoin, une nécessité ! Avec ces lignes qui marchent de droite à gauche, la rencontre de mes paupières occidentales avec ces lettres orientales produit de l’énergie dans mon corps ! Une expérience qui renouvelle mon point de vue : en tant que laïc je ne m’autorise pas à tutoyer la divinité, il n’empêche, c’est dans cette langue que s’est fondée la civilisation du monothéisme. Et dans cette langue, cette langue seule, cette civilisation est encore là présente, toute entière. Ce qui me donne l’impression de la recevoir à la source. Je suis un peu comme Livingston, remontant à la source du Nil. Lentement, avec discipline… Révolutionnaire, l’indiscipline était ma maîtresse. La discipline, la règle, les contraintes, les horaires, je les ai appris grâce à la vie ouvrière. La « vie ouvrière », une belle expression pour moi…
Y.L. – Le Nil, disiez-vous, le sable et l’immensité désertique donc… N’est -t- il pas paradoxal d’affirmer dans « Le poids du papillon » qu’il n’y a pas plus grand silence que celui de la neige ?
E.D-L. – C’est en fait une question de stabilité, de pression sur la terre qui contribue à cette impression de silence. Dans le désert, où j’ai dormi quelquefois, j’ai souvent eu la sensation que même l’étoile faisait du bruit ! Au final toutefois, en montagne comme au désert, le bruit est présent parce que le règne minéral est un monde du vivant. Et puis, au plus profond du silence, il y a le bruit du vent, le bruit de notre corps, celui de notre cœur qui bat, que l’on grimpe ou que l’on marche… Notre corps a une cadence musicale. Quand j’étais à l’usine ou sur le chantier, mon corps épousait le rythme du travail. Au point d’avoir parfois envie de chanter. Non parce que le travail me rendait heureux, juste parce que notre corps est musical. D’où le choix d’écrire mes livres à la main ! La frappe n’intervient qu’au stade ultime, pour la remise du manuscrit. Le corps ? Une formidable machine que nous exploitons sans vraiment bien la connaître. Propos recueillis par Yonnel Liégeois
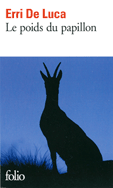 L’homme et la bête
L’homme et la bête
Le poids du papillon ? Une incroyable histoire entre un braconnier, un chamois et un papillon, une fable, une parabole à vrai dire où l’on voit s’affronter trois maîtres en leur domaine : le dieu de la chasse, le roi de la horde et le prince de la légèreté. Dans la majesté des cimes enneigées, loin du tumulte de la cité, sur ces hauteurs escarpées où le sabot de l’animal se pose avec assurance là où le pied de l’homme se fait tremblant. Un combat de titans entre l’homme et la bête, narré avec ce souffle épique et poétique cher à De Luca : une légèreté de la phrase, à l’image de celle du papillon qui virevolte d’un héros à l’autre, entre ciel et terre. Vaincre ou mourir ? Selon De Luca, le dernier mot est ailleurs : vivre en harmonie avec soi-même.
 Des poissons et des saintes
Des poissons et des saintes
Chez Erri de Luca, le paradoxe n’est point de mise ! Dans un même élan, l’écrivain sait se faire aussi magistralement conteur de la petite comme de la grande histoire, du portrait d’un enfant parmi tant d’autres à celui de saintes à la biographie consacrée dans les pages de la Bible… Avec le même étonnement, la même jubilation pour le lecteur : d’un authentique récit d’initiation dans Les poissons ne ferment pas les yeux à la revisitation de ces portraits de femmes qui eurent pour nom Ruth, Bethsabée ou Marie dans Les saintes du scandale, le romancier italien use du même verbe léché et poétique pour nous rendre ses héros de plume, le gamin napolitain en vacances au bord de mer comme ces figures féminines historiques, formidablement proches et attachants … La découverte du monde des adultes et du verbe « aimer » pour l’un, la puissance de leur féminité pour les autres ! Entre le parler napolitain et la musique de l’hébreu ancien, la langue d’Erri De Luca ne marque aucune frontière, sinon celle du souvenir ou de la méditation pour l’un et l’autre genre littéraire. Du bel et grand art.
 Portrait
Portrait
Du marteau au stylo
Autodidacte, Erri De Luca a tout fait, tout appris de ses mains. A manier la faucille et le marteau de la révolution, comme la plume et le stylo pour l’écriture… Sa vraie rencontre avec les livres ? Pas à l’école, mais à la maison. « Une famille pauvre, mais riche en livres. S’il y avait eu des armes au mur, peut-être serai-je devenu chasseur ! C’est dans les livres que j’ai découvert la meilleure part de moi-même. Lecture et écriture ont toujours accompagné ma vie alors que je n’ai commencé à publier que très tard, vers l’âge de quarante ans ». Le gamin découvrit les livres en dévorant ceux de son père. Une frénésie de lectures qui a nourri sa passion de l’histoire autant que sa volonté de changer le monde… Ouvrier à la chaîne de la Fiat, militant de « Lotta Continua » durant les années de plomb, maçon sur les chantiers du bâtiment en France, l’homme a trempé sa plume au dur labeur quotidien, avec la lecture et l’écriture toujours à la fin d’une journée de travail, un temps sauvé contre le temps vendu ! Le livre, compagnon de tous les jours, à l’usine comme au temps de la révolution : l’homme ne renie rien de ses engagements antérieurs, défendant en son temps la cause de Cesare Battisti jusqu’au bout, s’insurgeant « contre cet État italien qui s’obstine à proclamer des victoires à perpétuité sur les vaincus d’un autre temps ».
Son ambition aujourd’hui, de livre en livre ? Explorer notre humanité trébuchante au regard de ce siècle tourmenté où s’est commis en Europe « le plus grand massacre de l’humanité, une génération avant la mienne ». Et tenter de renouer avec la vie, « au rez-de-chaussée de la ville », dans les souterrains napolitains ou au sommet de l’Himalaya, à la fréquentation surtout des gens de peu, ses compagnons de travail « d’une humanité parfois brutale mais honnête et loyale ». Il le reconnaît, un apprentissage rude sur les chantiers au contact par exemple de ces ouvriers napolitains déracinés, nostalgiques de leurs terres, de leurs familles. « Je fus durablement touché par leurs souffrances, leurs cous tordus ou tendus vers leurs origines ». Naples ? La ville où il naquit en 1950, la ville de tous les apprentissages et de toutes les révoltes pour celui qui en fit souvent matière à roman : Pas ici, pas maintenant, Montedidio, Le jour avant le bonheur… De Luca ne se veut pourtant point écrivain de terroir. Ses héros sont figures de proximité certes, napolitaines ou populaires, mais il les convoque d’une plume légère et jamais prisonnière, s’évadant d’emblée du singulier vers l’universel. Se risquant même, lui le laïc invétéré qui s’interdit de tutoyer la divinité, sur les chemins plus austères de la spiritualité : l’apprentissage, en solitaire, de l’hébreu ancien. Pour tenter, comme le montagnard au pied du sommet ou le saumon sautant le gué, de remonter sans relâche à la source de vie. Ultime étape avant la mort.
Raconteur d’histoires ou passeur de mémoire, en tout cas vrai montagnard, l’ouvrier devenu écrivain sait mieux que quiconque accoucher vertiges poétiques et textes flamboyants sur notre humanité vacillante, et pourtant sans cesse renaissante. Erri De Luca ? Une langue ciselée, un souffle épique, le mot juste… Prix Fémina étranger en 2002 pour Montedidio, l’un des plus grands auteurs italiens contemporains.