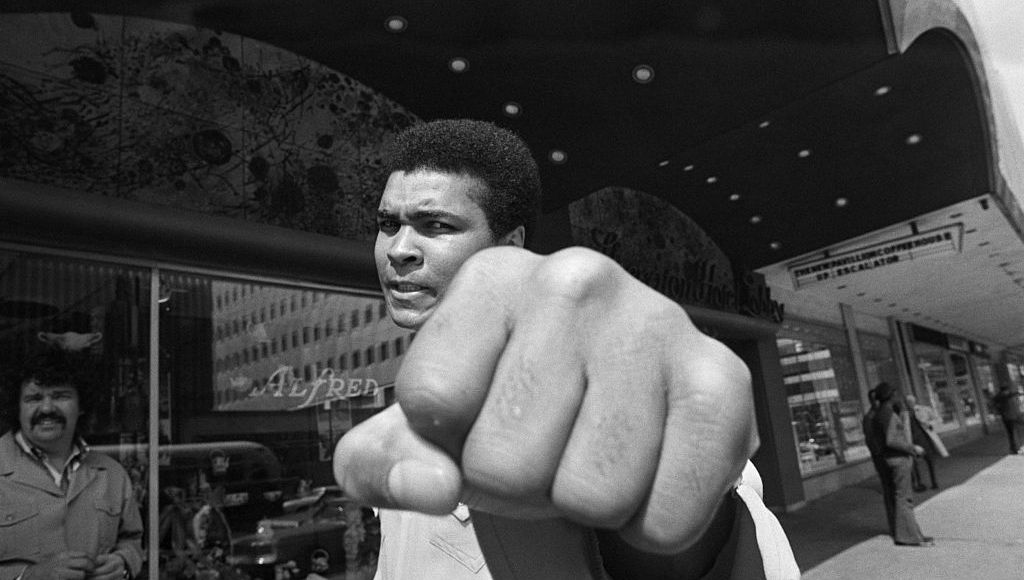Jusqu’en juillet 2022, Mister Tambourine Man sillonne la France. Un spectacle survolté, signé Eugène Durif et mené tambour battant par Karelle Prugnaud…. Avec Denis Lavant et Nikolaus Holz, deux acteurs définitivement inclassables !

L’un est circassien. Jongleur. Plus précisément, poète jongleur. Au bout des doigts de Nikolaus Holz, les balles rouges virevoltent, s’envolent, glissent le long de ce corps longiligne, tout de muscles saillants. Il jongle avec les balles, les touches d’un vieux piano bancal, égrène quelques notes de musique, tiens, on dirait un vieil air de Chopin… L’autre est acteur. Mieux encore, Denis Lavant est acteur poétique, musicien, acrobate… What else ? Saltimbanque, clochard céleste, son concertina caché dans sa besace. Pour les réunir, un auteur facétieux, Eugène Durif, qui cause aux étoiles et aux gilets jaunes dans un même mouvement. Une metteuse en scène circassienne, performeuse, Karelle Prugnaud, une jeune femme qui n’a pas froid aux yeux…
Chassé-croisé de haute voltige
Mister Tambourine Man, tel est le nom du spectacle qui se joue de ville en village, sous chapiteau ou à la salle des fêtes. Ce titre était jusqu’alors celui d’une chanson de Bob Dylan relatant un trip sous LSD. Il s’agit maintenant d’une comédie burlesque dans laquelle se rencontrent un homme-orchestre un tantinet givré et un garçon de café misanthropo-contorsionniste, en quête de salut. L’histoire se déroule à Hamelin. Hameau désertique. Un étrange bonhomme (Denis Lavant) enveloppé dans un manteau en peau d’ours pousse les portes du café. « Il fait grand soif ! » crie-t-il accoudé au comptoir. Un serveur – Nikolaus Holz – fait mine de ne pas le voir. Chassé-croisé de haute voltige dans un décor de bric et de broc qui se construit et se détruit à vue. Attention, vertige. Les répliques fusent, s’évitent, se chevauchent, tandis que les deux compères pirouettent, funambulent entre les verres, les chaises et tables renversées.

Faut dire qu’à Hamelin, on n’aime pas les étrangers. Mais cet étranger s’incruste, ne veut pas quitter les lieux. Il parle, raconte sa vie, ses rencontres sans lendemain, ses services rendus sans retour : l’ingratitude, l’égoïsme, sa lassitude du genre humain. Le serveur ne veut rien entendre, rien savoir. Il est serveur, point. Monsieur, passez votre chemin. Mais peu à peu, un mot, un air de concertina, un feulement, et voilà qu’il retrouve cette part d’enfance enfouie au plus profond de son être. L’un et l’autre vont s’apprivoiser, se respecter, se rencontrer. La pièce prend des allures de manifeste. Pour dénoncer le cynisme, l’hypocrisie, le libéralisme. Mister Tambourine Man ? Un hymne à la fraternité, à la liberté, pour résister à cet air du temps malsain. Marie-José Sirach
Les 24 et 25/05 à l’Espace des Arts, Scène nationale de Châlon-sur-Saône (71). Du 31/05 au 03/06 aux Scènes du Jura (Dole, Lons-le-Saunier), Scène nationale (39). Le 01/07 à La Maline, Île-de- Ré (17). Du 29 au 31/07 au Festival L’Horizon fait le mur, La Rochelle (17).
Frictions frappe fort !

Dans sa dernière livraison (N°34, 168 p., 15€), une nouvelle fois Frictions frappe fort ! Outre les contributions fort percutantes de Robert Cantarella et d’Olivier Neveux, la revue consacre un imposant dossier, jubilatoire et instructif, à l’iconoclaste Mister Tambourine Man. « De sa conception à sa réalisation, un spectacle totalement hors-normes », précise Jean-Pierre Han, le rédacteur en chef, « une troublante affaire » que décortiquent ses protagonistes : Eugène Durif l’auteur, Nikolaus Holz et Denis Lavant les interprètes, Karelle Prugnaud la metteure en scène… Disponible aussi sous forme de tiré à part (60 pages, 5€), un grand moment de lecture ! Y.L.