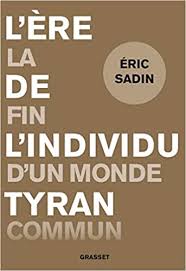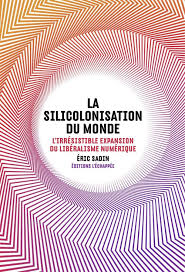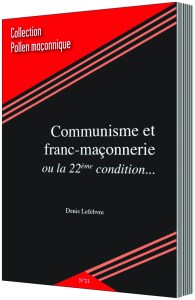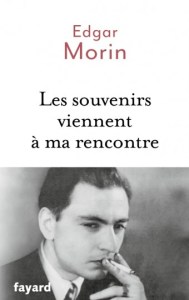Vice-Présidente d’honneur du Syndicat de la critique, Dominique Darzacq s’est éteinte le vendredi 8 janvier. Elle avait 88 ans. Avec elle, disparaît une grande dame de la critique. Régulièrement, nous  l’avons croisée : au théâtre d’abord, aux rencontres du Syndicat ensuite. Une femme attachante, aux convictions affirmées, la mémoire du spectacle vivant… C’est avec plaisir, et non sans passion, que nous partagions et débattions : sur les œuvres, les artistes, les publics, la critique théâtrale, le futur du Syndicat. Une journaliste férue de l’histoire des planches, en questionnement toujours sur l’avenir du spectacle vivant. Nous regrettons déjà le silence de son parler franc et sincère. Yonnel Liégeois
l’avons croisée : au théâtre d’abord, aux rencontres du Syndicat ensuite. Une femme attachante, aux convictions affirmées, la mémoire du spectacle vivant… C’est avec plaisir, et non sans passion, que nous partagions et débattions : sur les œuvres, les artistes, les publics, la critique théâtrale, le futur du Syndicat. Une journaliste férue de l’histoire des planches, en questionnement toujours sur l’avenir du spectacle vivant. Nous regrettons déjà le silence de son parler franc et sincère. Yonnel Liégeois
En ultime hommage à Dominique Darzacq, Chantiers de culture ouvre ses colonnes à trois plumes reconnues de la critique, Marie-José Sirach, Gilles Costaz et Armelle Héliot. Qu’elles en soient ici chaleureusement remerciées
Dominique Darzacq, cheville ouvrière de la critique

La Vice-Présidente d’honneur du Syndicat de la critique dramatique s’est éteinte le 8 janvier, rattrapée par la maladie. Elle allait avoir 89 ans. On la reconnaissait de loin à sa frêle silhouette. Pas très grande en taille mais forte en gueule, incroyablement pudique, elle a consacré toute sa vie à l’exercice de la critique dramatique dont elle fut, jusqu’à son dernier souffle, une représentante émérite.
De Combat au JT de TF1
Ses premiers articles paraissent dans Combat. Indépendante jusqu’au bout de sa plume, elle écrira pour Connaissance des arts, le Monde, Révolution, le Journal du théâtre, Théâtre d’aujourd’hui et, ces derniers temps, pour Webthéâtre, un blog théâtral animé entre autres par notre confrère Gilles Costaz… Chroniqueuse un temps à France Inter, elle avait intégré l’ORTF avant de se faire virer en 1968, ce dont elle était fière, disait-elle en riant. C’est Yves Mourousi qui lui offre la possibilité de revenir à la télévision, où elle animera une émission théâtrale sur TF1. Elle avait aimé travailler avec ce journaliste qui lui ouvrait sans souci son JT de 13 heures. « Il ne me demandait même pas de quoi j’allais parler. Il me faisait confiance, et je parvenais à balancer des sujets de plus de six minutes, ce qui aujourd’hui n’est même plus imaginable », me racontait-elle.
Un soutien, un pilier, une référence
Pour l’INA, elle a réalisé des documentaires précieux, désormais étudiés à l’université, sous le titre Mémoire du théâtre. Elle a ainsi réalisé les portraits d’Hubert Gignoux, Roger Planchon, René Allio, Jorge Lavelli, Isabelle Sadoyan, Aurélien Recoing, Antoine Bourseiller ou encore Jean-Pierre Vincent. Avec ce dernier, ils ont écrit ensemble le Désordre des vivants. Mes quarante-trois premières années de théâtre, en 2002. En 2006, elle publie Mission d’artistes : les centres dramatiques de 1946 à nos jours, tandis qu’en 1985 elle avait consacré un ouvrage au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, Du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer.
Membre très active du Syndicat de la critique dramatique, c’était une figure qui pouvait impressionner les plus jeunes d’entre nous, une lectrice attentive des uns et des autres qui m’appelait souvent le lundi pour réagir aux chroniques de son « cher Léo » (Léonardini) ou à nos papiers. Elle fut un soutien, un pilier, une référence pour beaucoup d’apprentis critiques, une militante sans faille du théâtre, curieuse des artistes, des créations. Ses critiques étaient travaillées, exigeantes, chaque mot ayant son importance, jamais choisi au hasard.
Un amour joyeux et courageux
En juin, sa compagne de toute une vie, Martine Spangaro, disparaissait des suites de « ce maudit crabe ». Martine avait dirigé le Théâtre de Sartrouville et, ces dernières années, le Théâtre du Petit Louvre, l’un des lieux les plus emblématiques du off d’Avignon. « La vie sans elle n’a plus de saveur », me confiait-elle il y a quelques jours, « depuis que ma moitié solaire n’est plus ». Elles se sont aimées pendant quarante ans, courageusement, joyeusement face à l’adversité. Leurs vies étaient entièrement dédiées au théâtre. Jusqu’au bout, malgré son cancer dont elle ne parlait jamais, Dominique est restée cette journaliste curieuse du théâtre sous toutes ses coutures sans se préoccuper des modes « qui ne font que passer », comme elle disait. Marie-José Sirach (L’Humanité), présidente du Syndicat de la critique (Théâtre-Musique-Danse)
Une grande figure de la critique et de l’histoire théâtrale

Notre collaboratrice et amie Dominique Darzacq vient de mourir, le 8 janvier. Elle était née à Paris en 1932. C’était une grande figure de la critique et de l’histoire théâtrale, qui avait su s’exprimer sur différents médias, la presse, la radio, la télévision et internet.
Elle avait fait ses premiers articles à Combat dans les années 60, sous la houlette de Philippe Tesson. Sa forte personnalité l’avait amenée à être rapidement à la fois un témoin critique, une intervieweuse savante, une réalisatrice de documentaires fouillés et quelqu’un de très proche du milieu théâtral – sa compagne, Martine Spangaro, qui devait devenir son épouse ces dernières années, participa à la direction du théâtre de Sartrouville, au temps de Claude Sévenier, et dirigea longtemps le théâtre du Petit Louvre qui s’ouvre chaque été pendant le festival d’Avignon. Chroniqueuse à France Inter, Dominique Darzacq anima pendant plusieurs années une émission consacrée au théâtre sur TF 1, grâce au patronage d’Yves Mourousi : un exploit, et un exemple quand on pense au peu d’intérêt que les grandes chaînes de télévision manifestent aujourd’hui à l’égard de l’art dramatique quand il n’est pas porté par des vedettes (car elle défendait tous les genres de théâtre).
Sans être une critique à laquelle on confiait un feuilleton ou une collaboration régulière, elle écrivit dans beaucoup de journaux et revues : la revue de l’ATTAC, Connaissance des arts, Le Monde, Révolution, Itinéraire, Le Journal du théâtre, Théâtre d’aujourd’hui… Elle prolongeait cette intense activité journalistique par des livres qui resteront : C’était du théâtre comme il n’était pas à prévoir mais comme il est à espérer (1985) sur le théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, L’Abécédaire Heyoka Sartrouville (1999 : elle s’intéressa beaucoup au théâtre jeune public et à la marionnette), Le Désordre des vivants (de longs entretiens avec Jean-Pierre Vincent, 2002).
Devenue réalisatrice, elle a fait, essentiellement pour l’INA, des documentaires remarquables sous le titre générique de « Mémoire du théâtre » : elle a ainsi fait parler et témoigner Hubert Gignoux, Roger Planchon, René Allio, Jacques Mauclair, Jean-Pierre Vincent, Jorge Lavelli, Isabelle Sadoyan, Aurélien Recoing, Pierre Vial, Antoine Bourseiller… L’histoire du théâtre lui doit, lui devra beaucoup ! Entière dans ses jugements et ses amitiés, elle ne redoutait pas les désaccords et la polémique. En même temps, elle était solidaire de ses confrères et fut toujours très engagée dans l’action du Syndicat professionnel de la critique de théâtre, de musique et de danse, dont elle avait été faite vice-présidente d’honneur.
C’est dans un ses textes écrits pour le bulletin du Syndicat que nous relevons ce qu’elle dit de l’art de juger : « Alors que pour Émile Zola la critique était « une des choses les plus inutiles et les plus sottes qui se puissent voir », Oscar Wilde, au contraire, affirmait qu’« une époque qui n’a pas de critique est une époque où l’art est immobile ». Pour sa part, le critique Gilles Sandier (1924-1982) la concevait comme « une franchise qui se bat, la partialité éclairée », tandis que Francisque Sarcey (1827-1899) affirmait qu’elle était « la voix de la foule, et son premier cri ». On la classerait plutôt du côté de Gilles Sandier, personnage un peu oublié mais qui fut l’un des ténors de la critique passionnée au cours des années 60-80.
Atteinte par la maladie, elle continua à aller régulièrement au théâtre et à donner ses articles à Webtheatre, malgré des séjours réguliers à l’hôpital. Elle eut la grande tristesse de voir son épouse Martine mourir au mois de juin. Restée seule, elle ne voulait rien abandonner de son activité principale. Les messages qu’elle envoyait à la rédaction étaient combatifs, chaleureux et rieurs. Récemment, elle nous annonçait un entretien avec l’actrice Anne Le Guernec, quand elle fut de nouveau emmenée à l’hôpital où elle devait succomber de crises respiratoires. Webtheatre et la presse théâtrale perdent une observatrice de premier plan, d’une écriture particulièrement gourmande. Gilles Costaz (Webthéâtre)
Dominique Darzacq, un modèle

Dans les métiers de la transmission, on apprend beaucoup de ses aînés. Et Dominique Darzacq, par sa présence et son travail, a été un modèle pour de nombreux journalistes culturels. Vice-Présidente d’honneur du Syndicat de la critique, elle aura, sa vie durant, défendu un théâtre d’art, aussi bien dans la presse écrite, la radio, qu’à la télévision. Elle s’est éteinte vendredi, quelques mois après la mort de celle qui avait été une compagne de vie et de passion artistique, Martine Spangaro. Dominique Darzacq avait eu 88 ans au mois de décembre dernier. Elle luttait contre une leucémie et le chagrin la minait depuis la disparition de Martine, en mai 2020. Elle s’est éteinte, entourée d’amis précieux, d’amies fidèles.
Souvenons-nous d’elle souriante, rieuse, caustique avec les fats, inlassable lorsqu’il s’agissait d’élargir le cercle des spectateurs du théâtre. Une femme engagée, qui était d’abord journaliste et abordait l’art du théâtre comme un grand reporter. Aller à l’aventure, découvrir, faire connaître, faire aimer, défendre. Si l’on se souvient bien, elle débuta à Combat dans les grandes années du quotidien. Ensuite, c’est sans doute à France Inter où sa pugnacité fit merveille. Elle travaillera pour Le Monde, Connaissance des arts et même Révolution. Et ces dernières années, elle écrivait aussi pour le site webtheatre.
Mais c’est sans doute en entrant à TF1, auprès de Marie-Laure Augry et d’Yves Mourousi, et en faisant une place extraordinairement large à l’art dramatique dans les journaux qu’ils présentaient, que Dominique Darzacq aura su, avec rigueur et exigence, faire connaître à un cercle très large le théâtre, les comédiens, les metteurs en scène, les auteurs. Dans ces grandes années 80, elle sillonne la France, de Strasbourg à Marseille, de Nanterre à Saint-Denis ou à la MC93. Elle était d’une culture profonde et ondoyante : elle défendait aussi bien le théâtre privé que le réseau public. Elle était une femme de service public. Elle aime le monde du théâtre. Elle le défend avec ardeur. Elle y puise d’indéfectibles amitiés : René Gonzales, notamment.
Dominique Darzacq a également publié quelques livres : Du théâtre comme il n’était pas à prévoir…en 85 (TGP/Solin), Jean-Pierre Vincent, mes quarante-trois premières années de théâtre (Les Solitaires Intempestifs, 2002) et aussi un ouvrage collectif, Les centres dramatiques de 1946 à nous jours (Théâtrales, 2006). D’elle, resteront également des portraits-entretiens, des films d’une remarquable valeur documentaire, qu’elle a tourné pour l’INA dans une collection qu’elle lança, « Mémoire du théâtre ». René Allio, Hubert Gignoux, Roger Planchon, Jacques Mauclair, Jean-Pierre Vincent, elle savait mener des entretiens, mettre en confiance, laisser sourdre les personnalités profondes des artistes interrogés. Dominique Darzacq était officier dans l’ordre des Arts et Lettres et, on l’a dit, Vice-Présidente d’honneur du syndicat de la critique. Elle s’intéressait à la place du théâtre dans les médias et à la relève. Armelle Héliot (Le journal d’Armelle Héliot)
 établissements culturels sans exception et d’annoncer une date de revoyure dans un calendrier raisonnable : musées, salles de cinéma et salles de spectacles doivent être ouverts dans un même tempo.
établissements culturels sans exception et d’annoncer une date de revoyure dans un calendrier raisonnable : musées, salles de cinéma et salles de spectacles doivent être ouverts dans un même tempo. la circulation du virus dans les territoires, et ainsi garantir les meilleures conditions d’accueil des publics et des professionnels.
la circulation du virus dans les territoires, et ainsi garantir les meilleures conditions d’accueil des publics et des professionnels.