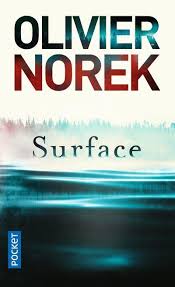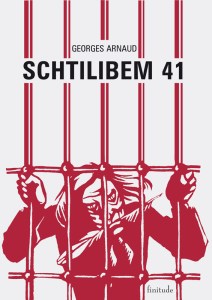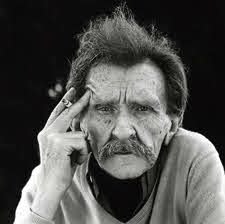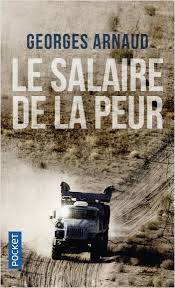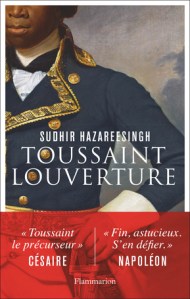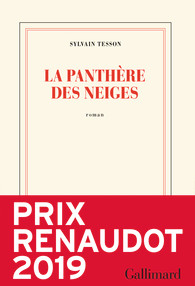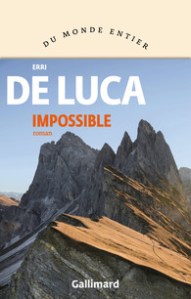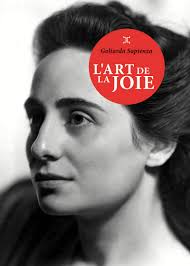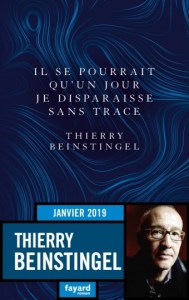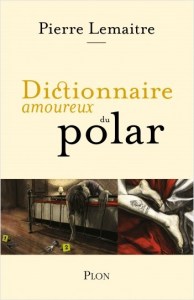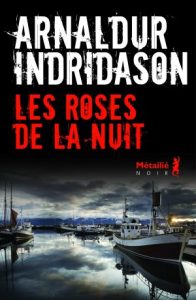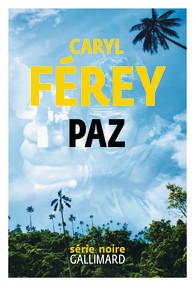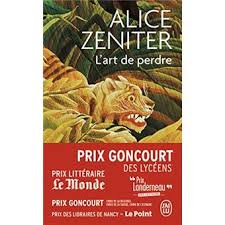En ces jours de fêtes, Chantiers de culture vous propose sa sélection de livres : biographie, illustration, récit, roman, polar… Tous les styles à tous les prix, du plaisir toujours entre les lignes ! Yonnel Liégeois
BIOGRAPHIE :
 – Marie Curie, une femme dans son siècle : Préfacé par Hélène Langevin-Joliot, un superbe album en hommage à la jeune émigrée polonaise, à la scientifique couronnée de deux prix Nobel (de physique en 1903, de chimie en 1911) ! De son enfance jusqu’au transfert de ses cendres au Panthéon en 1995, Marion Augustin nous conte les mérites d’une femme qui conjugua discrétion et sagesse avec la même intelligence, qui ne sacrifia jamais à la science sa quête d’amour : la première docteure es-sciences, la première professeure en Sorbonne, la première femme à recevoir le Nobel ! Un livre grand format, riche de moult documents et photographies (Gründ, 240 p., 30€).
– Marie Curie, une femme dans son siècle : Préfacé par Hélène Langevin-Joliot, un superbe album en hommage à la jeune émigrée polonaise, à la scientifique couronnée de deux prix Nobel (de physique en 1903, de chimie en 1911) ! De son enfance jusqu’au transfert de ses cendres au Panthéon en 1995, Marion Augustin nous conte les mérites d’une femme qui conjugua discrétion et sagesse avec la même intelligence, qui ne sacrifia jamais à la science sa quête d’amour : la première docteure es-sciences, la première professeure en Sorbonne, la première femme à recevoir le Nobel ! Un livre grand format, riche de moult documents et photographies (Gründ, 240 p., 30€).
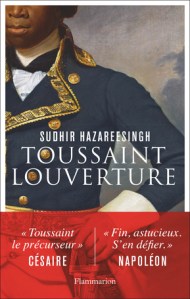 – Toussaint Louverture : Sudhir Hazareesingh, historien et professeur à Oxford, l’affirme : « Premier « modèle noir », Toussaint Louverture a inspiré Victor Schoelcher, le militant antiesclavagiste Frederick Douglass et les plus grandes contestations du colonialisme, dont le mouvement de la négritude porté par Aimé Césaire ». Du jeune Haïtien, enfant des Lumières, à celui qui décréta l’indépendance de son île en 1801, une époustouflante biographie qui nous révèle toutes les facettes du personnage : un visionnaire fin diplomate, un chef de guerre hors-pair, un législateur avisé…. Une figure marquante dans l’histoire émancipatrice des peuples (Flammarion, 592 p., 29€).
– Toussaint Louverture : Sudhir Hazareesingh, historien et professeur à Oxford, l’affirme : « Premier « modèle noir », Toussaint Louverture a inspiré Victor Schoelcher, le militant antiesclavagiste Frederick Douglass et les plus grandes contestations du colonialisme, dont le mouvement de la négritude porté par Aimé Césaire ». Du jeune Haïtien, enfant des Lumières, à celui qui décréta l’indépendance de son île en 1801, une époustouflante biographie qui nous révèle toutes les facettes du personnage : un visionnaire fin diplomate, un chef de guerre hors-pair, un législateur avisé…. Une figure marquante dans l’histoire émancipatrice des peuples (Flammarion, 592 p., 29€).
 – Nathalie Sarraute : Professeure émérite à l’université d’Oxford, proche de l’écrivaine qu’elle a fréquenté assidûment, Ann Jefferson analyse avec finesse, et sans complaisance, le parcours de la jeune émigrée russe et juive, l’œuvre surtout de celle qui fut considérée un temps comme la figure de proue du Nouveau Roman… D’une discrétion légendaire, en doute permanent sur son statut d’auteure, Nathalie Sarraute a signé parmi les textes des plus percutants du XXème siècle : de Tropismes à Pour un oui pour un non, sa pièce de théâtre la plus célébrée et jouée. Un regard instructif et plaisant sur la table de travail d’une grande dame de plume (Flammarion, 490 p., 26€).
– Nathalie Sarraute : Professeure émérite à l’université d’Oxford, proche de l’écrivaine qu’elle a fréquenté assidûment, Ann Jefferson analyse avec finesse, et sans complaisance, le parcours de la jeune émigrée russe et juive, l’œuvre surtout de celle qui fut considérée un temps comme la figure de proue du Nouveau Roman… D’une discrétion légendaire, en doute permanent sur son statut d’auteure, Nathalie Sarraute a signé parmi les textes des plus percutants du XXème siècle : de Tropismes à Pour un oui pour un non, sa pièce de théâtre la plus célébrée et jouée. Un regard instructif et plaisant sur la table de travail d’une grande dame de plume (Flammarion, 490 p., 26€).
ILLUSTRATION :
 – Le corps de la lettre : De A à Z, Jacquie Barral décline l’alphabet en des formes aussi originales qu’extravagantes. Le dépaysement du dessin à l’encre noire s’allie et se marie amoureusement au texte de Pierre Bergounioux… Une histoire savamment instruite, ludique et poétique, de la découverte de la lettre à l’émergence de l’écriture, que l’écrivain conte d’un phrasé toujours élégant (à poursuivre avec Le premier mot). D’une naïve beauté déconcertante, un petit livre d’art par le format mais un grand puits de réflexion quand l’auteur mêle son itinéraire personnel à celui de l’écriture à travers les siècles : du chasseur-cueilleur à l’ordinateur ! (Fata Morgana, 64 p., 13€).
– Le corps de la lettre : De A à Z, Jacquie Barral décline l’alphabet en des formes aussi originales qu’extravagantes. Le dépaysement du dessin à l’encre noire s’allie et se marie amoureusement au texte de Pierre Bergounioux… Une histoire savamment instruite, ludique et poétique, de la découverte de la lettre à l’émergence de l’écriture, que l’écrivain conte d’un phrasé toujours élégant (à poursuivre avec Le premier mot). D’une naïve beauté déconcertante, un petit livre d’art par le format mais un grand puits de réflexion quand l’auteur mêle son itinéraire personnel à celui de l’écriture à travers les siècles : du chasseur-cueilleur à l’ordinateur ! (Fata Morgana, 64 p., 13€).
 – Frantz Fanon : Un roman graphique à dire vrai, signé Frédéric Ciriez et Romain Lamy. Un magnifique ouvrage, d’une fulgurante audace, pour nous plonger dans la vie et le combat anticolonialiste du célèbre psychiatre martiniquais, durablement engagé dans le combat pour l’indépendance algérienne. D’un dessin l’autre, grâce à la couleur et au graphisme original, le décryptage à portée de chacun d’une réflexion souvent complexe. Les deux auteurs, de la plume et du crayon, nous projettent à Rome, lorsque Fanon rencontre Sartre le philosophe : le dialogue entre deux grands de la pensée, deux mondes et deux couleurs de peau (La Découverte, 240 p., 28€).
– Frantz Fanon : Un roman graphique à dire vrai, signé Frédéric Ciriez et Romain Lamy. Un magnifique ouvrage, d’une fulgurante audace, pour nous plonger dans la vie et le combat anticolonialiste du célèbre psychiatre martiniquais, durablement engagé dans le combat pour l’indépendance algérienne. D’un dessin l’autre, grâce à la couleur et au graphisme original, le décryptage à portée de chacun d’une réflexion souvent complexe. Les deux auteurs, de la plume et du crayon, nous projettent à Rome, lorsque Fanon rencontre Sartre le philosophe : le dialogue entre deux grands de la pensée, deux mondes et deux couleurs de peau (La Découverte, 240 p., 28€).
 – J’avais un rendez-vous : Le dernier ouvrage d’Hugo Pratt, certainement le plus grand maître de la bande dessinée ! Dans une explosion de couleurs, le créateur de Corto Maltese nous embarque pour un ultime voyage à la découverte des îles du Pacifique : Pâques, Fidji, Cook, Samoa… Entre croquis, photos, aquarelles, planches, la nouvelle édition d’un ouvrage paru initialement en 1992, enrichi d’inédits, où Pratt fait retour sur sa vie, ses rencontres, ses amours et ses découvertes. Une sorte d’autobiographie, empreinte d’un profond humanisme pour le franc-maçon qu’il fut, soulignée d’un trait de crayon d’une délicatesse infinie (Le Tripode, 224 p., 29€).
– J’avais un rendez-vous : Le dernier ouvrage d’Hugo Pratt, certainement le plus grand maître de la bande dessinée ! Dans une explosion de couleurs, le créateur de Corto Maltese nous embarque pour un ultime voyage à la découverte des îles du Pacifique : Pâques, Fidji, Cook, Samoa… Entre croquis, photos, aquarelles, planches, la nouvelle édition d’un ouvrage paru initialement en 1992, enrichi d’inédits, où Pratt fait retour sur sa vie, ses rencontres, ses amours et ses découvertes. Une sorte d’autobiographie, empreinte d’un profond humanisme pour le franc-maçon qu’il fut, soulignée d’un trait de crayon d’une délicatesse infinie (Le Tripode, 224 p., 29€).
Récit :
 – Idiotie : L’homme, disparu en 2020 et par qui le scandale arriva en 1970, Eden, Eden, Eden censuré pendant plus de dix ans, nous proposait dans son ultime ouvrage couronné du prix Médicis un édifiant retour sur existence ! Une famille mortifiée pour actes de Résistance, une jeunesse errante, une aversion envers la guerre d’Algérie qui l’a enrôlé, une rébellion contre les pouvoirs constitués, un goût prononcé à braver les interdits dans le réel autant que par la plume… Le parcours d’un écrivain atypique à l’écriture singulière, une œuvre littéraire saluée par ses pairs : du prix Nobel Claude Simon à Michel Foucault, de Philippe Sollers à Roland Barthes (Folio, 304 p., 8€50).
– Idiotie : L’homme, disparu en 2020 et par qui le scandale arriva en 1970, Eden, Eden, Eden censuré pendant plus de dix ans, nous proposait dans son ultime ouvrage couronné du prix Médicis un édifiant retour sur existence ! Une famille mortifiée pour actes de Résistance, une jeunesse errante, une aversion envers la guerre d’Algérie qui l’a enrôlé, une rébellion contre les pouvoirs constitués, un goût prononcé à braver les interdits dans le réel autant que par la plume… Le parcours d’un écrivain atypique à l’écriture singulière, une œuvre littéraire saluée par ses pairs : du prix Nobel Claude Simon à Michel Foucault, de Philippe Sollers à Roland Barthes (Folio, 304 p., 8€50).
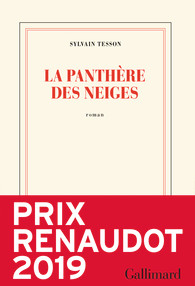 – La panthère des neiges : Le baroudeur des cimes, l’aventurier de la taïga, l’aviné des toits se révèle apaisé, aux aguets pour entrevoir « une ombre magique ». Qui est vraiment l’animal, la belle secrète du Tibet ou l’écrivain aux défis les plus improbables ? Après s’être refait une santé Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson traque l’apparition d’un animal mythique au sommet des cols enneigés d’Asie. D’anecdotes en déconvenues, jusqu’à la vision finale, un rafraîchissant récit, prix Renaudot 2019, qui interroge notre rapport à la nature entre l’indispensable et le superflu, les petits arrangements de la vie et la splendeur des grands espaces (Gallimard, 176 p., 18€).
– La panthère des neiges : Le baroudeur des cimes, l’aventurier de la taïga, l’aviné des toits se révèle apaisé, aux aguets pour entrevoir « une ombre magique ». Qui est vraiment l’animal, la belle secrète du Tibet ou l’écrivain aux défis les plus improbables ? Après s’être refait une santé Sur les chemins noirs, Sylvain Tesson traque l’apparition d’un animal mythique au sommet des cols enneigés d’Asie. D’anecdotes en déconvenues, jusqu’à la vision finale, un rafraîchissant récit, prix Renaudot 2019, qui interroge notre rapport à la nature entre l’indispensable et le superflu, les petits arrangements de la vie et la splendeur des grands espaces (Gallimard, 176 p., 18€).
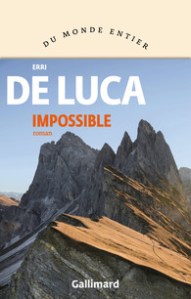 – Impossible : Erri de Luca, l’emblématique transalpin, ose un original détour sur son passé révolutionnaire. Mort accidentelle ou meurtre intentionnel ? Entre le jeune juge en charge du dossier et le suspect d’un âge avancé, un face à face qui se joue en haute montagne, un dialogue qui emprunte les chemins des plus hautes valeurs morales pour le militant sans rancœur ni esprit de vengeance. Un livre stimulant où la pensée, dans une langue vive et concrète, ouvre la voie à la conquête des sommets entre certitude et conviction, préjugé et liberté. À lire comme en écho, Le tour de l’oie précédemment publié : l’imaginaire rencontre entre l’auteur et un improbable fils (Gallimard, 174 p., 16€50).
– Impossible : Erri de Luca, l’emblématique transalpin, ose un original détour sur son passé révolutionnaire. Mort accidentelle ou meurtre intentionnel ? Entre le jeune juge en charge du dossier et le suspect d’un âge avancé, un face à face qui se joue en haute montagne, un dialogue qui emprunte les chemins des plus hautes valeurs morales pour le militant sans rancœur ni esprit de vengeance. Un livre stimulant où la pensée, dans une langue vive et concrète, ouvre la voie à la conquête des sommets entre certitude et conviction, préjugé et liberté. À lire comme en écho, Le tour de l’oie précédemment publié : l’imaginaire rencontre entre l’auteur et un improbable fils (Gallimard, 174 p., 16€50).
Roman :
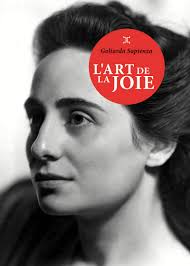 – L’art de la joie : D’un chapitre l’autre, un bonheur de lecture à savourer sans modération. Près de 800 pages qui se dégustent à petites gorgées pour que dure la musique des mots : la joie, tout un art ! Une histoire de femme écrite par une femme, Goliarda Sapienza… Un roman culte, un classique de la littérature italienne qui nous conte la vie aventureuse, et amoureuse, de Modesta la sicilienne, née pauvre mais insoumise, éprise de son destin que nul ne peut lui imposer. Une saga à multiples rebondissements, haletante et poignante, qui nous plonge avec talent dans les soubresauts de l’histoire, individuelle et collective : la femme et le peuple, libérés (Le Tripode, 798 p., 14€50).
– L’art de la joie : D’un chapitre l’autre, un bonheur de lecture à savourer sans modération. Près de 800 pages qui se dégustent à petites gorgées pour que dure la musique des mots : la joie, tout un art ! Une histoire de femme écrite par une femme, Goliarda Sapienza… Un roman culte, un classique de la littérature italienne qui nous conte la vie aventureuse, et amoureuse, de Modesta la sicilienne, née pauvre mais insoumise, éprise de son destin que nul ne peut lui imposer. Une saga à multiples rebondissements, haletante et poignante, qui nous plonge avec talent dans les soubresauts de l’histoire, individuelle et collective : la femme et le peuple, libérés (Le Tripode, 798 p., 14€50).
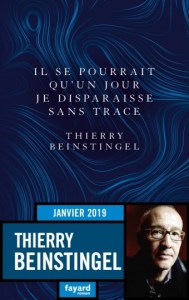 – Il se pourrait qu’un jour je disparaisse sans trace : Trois personnages aux destins contrariés : une prof d’allemand en mal d’existence, le gardien d’une station de pompage désaffectée, une lycéenne en quête d’un étrange petit boulot… À l’une comme l’autre, la vie ne fait pas de cadeau entre solitude, misère sociale, noirceur des immeubles comme des jours à venir. Jusqu’à découvrir encore plus pauvre que soi, migrants – paumés –malades, et oser goûter à nouveau aux mots dignité et fraternité. Signée Thierry Beinstingel, la peinture forte d’une société en totale déliquescence où trois êtres tentent pourtant de reconquérir leur humanité. Pour faire trace (Fayard, 286 p., 19€).
– Il se pourrait qu’un jour je disparaisse sans trace : Trois personnages aux destins contrariés : une prof d’allemand en mal d’existence, le gardien d’une station de pompage désaffectée, une lycéenne en quête d’un étrange petit boulot… À l’une comme l’autre, la vie ne fait pas de cadeau entre solitude, misère sociale, noirceur des immeubles comme des jours à venir. Jusqu’à découvrir encore plus pauvre que soi, migrants – paumés –malades, et oser goûter à nouveau aux mots dignité et fraternité. Signée Thierry Beinstingel, la peinture forte d’une société en totale déliquescence où trois êtres tentent pourtant de reconquérir leur humanité. Pour faire trace (Fayard, 286 p., 19€).
 – Un monde à portée de main : Pour parfaire son apprentissage dans les arts plastiques, Paula suit les cours d’un prestigieux institut bruxellois. L’objectif ? Maîtriser le trompe l’œil… Il lui faudra, non sans retouches et repentirs, comprendre ce qu’est l’apparence du vrai, intérioriser surtout ce que « copier » veut dire. Un roman de Maylis de Kerangal d’une rare beauté, sensuelle et poétique, où l’acte de création est sujet premier. De faux marbres aux peintures de Lascaux, autant que l’œil, la main invite à regarder l’autre et le monde autrement… Une lecture à prolonger avec À ce stade de la nuit, un petit opuscule bouleversant, un regard autre sur le monde des migrants (Folio, 336 p., 8€).
– Un monde à portée de main : Pour parfaire son apprentissage dans les arts plastiques, Paula suit les cours d’un prestigieux institut bruxellois. L’objectif ? Maîtriser le trompe l’œil… Il lui faudra, non sans retouches et repentirs, comprendre ce qu’est l’apparence du vrai, intérioriser surtout ce que « copier » veut dire. Un roman de Maylis de Kerangal d’une rare beauté, sensuelle et poétique, où l’acte de création est sujet premier. De faux marbres aux peintures de Lascaux, autant que l’œil, la main invite à regarder l’autre et le monde autrement… Une lecture à prolonger avec À ce stade de la nuit, un petit opuscule bouleversant, un regard autre sur le monde des migrants (Folio, 336 p., 8€).
Polar :
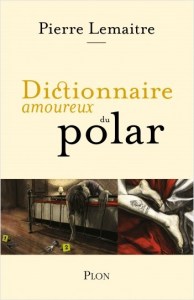 – Dictionnaire amoureux du polar : Prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, mais aussi auteur de romans noirs, Pierre Lemaitre le reconnaît, le lecteur lui en dressera procès-verbal, « il y a des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables » : tout ce qui fait le bonheur de cette collection de dictionnaires amoureux ! De Ackroyd (Roger) à Wolfe (Nero), le maître du polar commente ses coups de cœur (dont Jonquet, Indridason, Montalban et Padura pour les nôtres), égratignant quelques plumes reconnues, invitant à la découverte d’auteurs oubliés ou méconnus, partageant surtout ses goûts pour cette littérature de haute facture dénonçant « le monde tel qu’il va mal » (Plon, 816 p., 27€).
– Dictionnaire amoureux du polar : Prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut, mais aussi auteur de romans noirs, Pierre Lemaitre le reconnaît, le lecteur lui en dressera procès-verbal, « il y a des oublis impardonnables, des injustices criantes, des jugements contestables » : tout ce qui fait le bonheur de cette collection de dictionnaires amoureux ! De Ackroyd (Roger) à Wolfe (Nero), le maître du polar commente ses coups de cœur (dont Jonquet, Indridason, Montalban et Padura pour les nôtres), égratignant quelques plumes reconnues, invitant à la découverte d’auteurs oubliés ou méconnus, partageant surtout ses goûts pour cette littérature de haute facture dénonçant « le monde tel qu’il va mal » (Plon, 816 p., 27€).
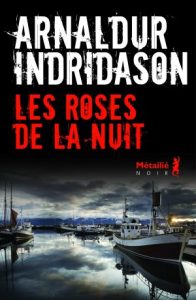 – Les roses de la nuit : Dans le cimetière, le cadavre d’une jeune femme sur la tombe d’un Père de la nation islandaise… Le climat social s’est dégradé à Reykjavik, la drogue fait des ravages, la concentration des quotas de pêche produit chômage et pauvreté. Plus qu’une banale enquête policière, toujours sous la conduite d’Erlendur son commissaire attitré, Arnaldur Indridason bouscule les clichés carte postale, immensités enneigées et sources d’eau chaude, pour nous plonger dans les réalités nauséabondes d’un pays en perte de sa culture ancestrale. Un auteur mondialement reconnu, traduit en 40 langues et couronné de nombreux prix littéraires, tant en France qu’à l’étranger (Métailié, 248 p., 21€).
– Les roses de la nuit : Dans le cimetière, le cadavre d’une jeune femme sur la tombe d’un Père de la nation islandaise… Le climat social s’est dégradé à Reykjavik, la drogue fait des ravages, la concentration des quotas de pêche produit chômage et pauvreté. Plus qu’une banale enquête policière, toujours sous la conduite d’Erlendur son commissaire attitré, Arnaldur Indridason bouscule les clichés carte postale, immensités enneigées et sources d’eau chaude, pour nous plonger dans les réalités nauséabondes d’un pays en perte de sa culture ancestrale. Un auteur mondialement reconnu, traduit en 40 langues et couronné de nombreux prix littéraires, tant en France qu’à l’étranger (Métailié, 248 p., 21€).
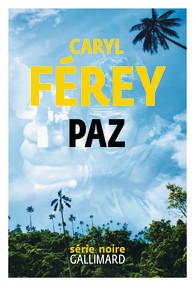 – Paz : Infiltré chez les narcotrafiquants, dans la moiteur de la forêt colombienne, un homme risque sa vie au quotidien. Entre corruption au plus haut de l’État et règlements de compte à profusion, un roman haletant, à multiples rebondissements. Le sens de l’intrigue, une écriture sèche et incisive, une documentation au-dessus de tout soupçon : après Zulu qui l’avait révélé au grand public, Mapuche et Utu, Caryl Férey s’impose comme une grande plume de la littérature. « Chacun de ses livres est un réquisitoire contre ce qu’il nomme le fascisme ordinaire, et le néolibéralisme auquel il est intimement lié », commente Lemaitre le maître, « si vous lisez un roman de Caryl Férey, vous les dévorerez tous » (Série noire, 536 p., 22€).
– Paz : Infiltré chez les narcotrafiquants, dans la moiteur de la forêt colombienne, un homme risque sa vie au quotidien. Entre corruption au plus haut de l’État et règlements de compte à profusion, un roman haletant, à multiples rebondissements. Le sens de l’intrigue, une écriture sèche et incisive, une documentation au-dessus de tout soupçon : après Zulu qui l’avait révélé au grand public, Mapuche et Utu, Caryl Férey s’impose comme une grande plume de la littérature. « Chacun de ses livres est un réquisitoire contre ce qu’il nomme le fascisme ordinaire, et le néolibéralisme auquel il est intimement lié », commente Lemaitre le maître, « si vous lisez un roman de Caryl Férey, vous les dévorerez tous » (Série noire, 536 p., 22€).
Avec deux chroniques de Jean-Pierre Burdin, au fil de l’eau :
 – Le pont de Bezons : Personne ne s’avisait de marcher le long de la seine. Les gens sont raisonnables. Cela n’a pas de sens de marcher le long de la Seine. Après il faut revenir. On est bien avancé. Cet exergue d’Aragon, tiré d’Aurélien, ouvre le carnet du cheminement que tient Jean Rolin. Va-et-vient erratique dans les méandres de la Seine dans ces territoires mal aimés, pas regardés, à l’abandon entre Melun et Mantes. En sautant Paris pieds joints, l’auteur va quêter et trouver du sens. Sous ses pas, le sens lève, à l’image de l’envol des oiseaux qui, comme les laissés pour compte de notre urbanité, s’abritent dans les plis d’un terrain. Vague seulement pour qui ne les traverse pas en piéton… On pense à un autre texte d’Aragon tiré du Con d’Irène : je parle d’un langage de décombre où voisinent les soleils et les plâtres. Les soleils se lèvent pont de Bezons (P.O.L., 230 p., 19€).
– Le pont de Bezons : Personne ne s’avisait de marcher le long de la seine. Les gens sont raisonnables. Cela n’a pas de sens de marcher le long de la Seine. Après il faut revenir. On est bien avancé. Cet exergue d’Aragon, tiré d’Aurélien, ouvre le carnet du cheminement que tient Jean Rolin. Va-et-vient erratique dans les méandres de la Seine dans ces territoires mal aimés, pas regardés, à l’abandon entre Melun et Mantes. En sautant Paris pieds joints, l’auteur va quêter et trouver du sens. Sous ses pas, le sens lève, à l’image de l’envol des oiseaux qui, comme les laissés pour compte de notre urbanité, s’abritent dans les plis d’un terrain. Vague seulement pour qui ne les traverse pas en piéton… On pense à un autre texte d’Aragon tiré du Con d’Irène : je parle d’un langage de décombre où voisinent les soleils et les plâtres. Les soleils se lèvent pont de Bezons (P.O.L., 230 p., 19€).
 – L’or du temps : C’est à un tout autre voyage le long de la Seine que nous convie François Sureau. D’une toute autre intention, d’une autre écriture encore. Cette descente de la Seine nous plonge dans l’écoulement du temps. Pas pour nous en livrer l’histoire mais pour découvrir des galets d’or laissés là, polis par les eaux. On peut penser à la Muse endormie de Brancusi que toutefois Sureau n’évoque pas. Il y avait à craindre une sorte de galerie de portraits édifiants ou d’inventaires de monuments. L’écriture forte, dense de François Sureau nous ouvre un libre album où l’on découvre des lieux à deux pas de chez soi, insolites, oubliés… ou encore des personnages souvent inconnus et toujours méconnus. Le point commun entre tous ? N’avoir jamais cédé sur leur désir et leur destin. On apprend beaucoup (Gallimard, 848 p., 27€50).
– L’or du temps : C’est à un tout autre voyage le long de la Seine que nous convie François Sureau. D’une toute autre intention, d’une autre écriture encore. Cette descente de la Seine nous plonge dans l’écoulement du temps. Pas pour nous en livrer l’histoire mais pour découvrir des galets d’or laissés là, polis par les eaux. On peut penser à la Muse endormie de Brancusi que toutefois Sureau n’évoque pas. Il y avait à craindre une sorte de galerie de portraits édifiants ou d’inventaires de monuments. L’écriture forte, dense de François Sureau nous ouvre un libre album où l’on découvre des lieux à deux pas de chez soi, insolites, oubliés… ou encore des personnages souvent inconnus et toujours méconnus. Le point commun entre tous ? N’avoir jamais cédé sur leur désir et leur destin. On apprend beaucoup (Gallimard, 848 p., 27€50).
 sous le parapluie des théories théâtrales – que cependant il connaît – mais se réclame avant tout de la poésie, qu’il fréquente assidûment ; Rimbaud et Artaud à son chevet. La poésie lui est, en somme, un gage de vérité pratique.
sous le parapluie des théories théâtrales – que cependant il connaît – mais se réclame avant tout de la poésie, qu’il fréquente assidûment ; Rimbaud et Artaud à son chevet. La poésie lui est, en somme, un gage de vérité pratique. entendu réciter Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, le poème de Mallarmé, en jonglant avec des quilles !
entendu réciter Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, le poème de Mallarmé, en jonglant avec des quilles !