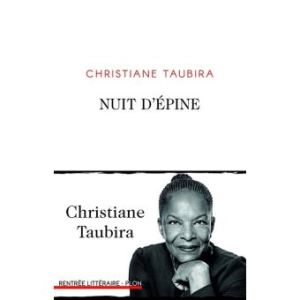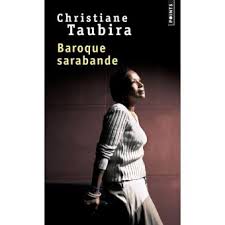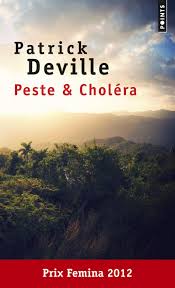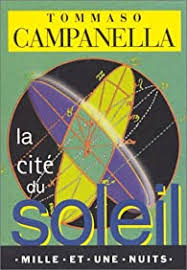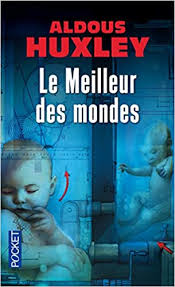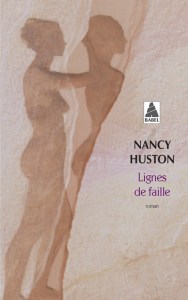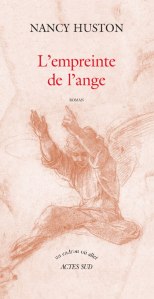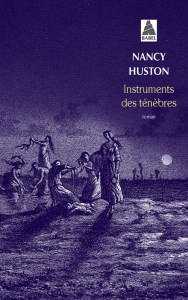Vague et sans ambition pour l’avenir, le « plan culture » d’Emmanuel Macron inquiète autant les intermittents du spectacle que le silence qui l’a précédé. Comme d’autres salariés et privés d’emploi, ils refusent d’être précarisés. État des lieux
Qu’auraient été nos jours confinés en l’absence des artistes ? Sans l’Orchestre de Radio France « à la maison », le ballet des danseurs de l’Opéra de Paris en visioconférence ou bien encore les très virales Goguettes… Et sans France.tv qui a renoué pour l’occasion avec la culture : documentaires, théâtre, cinéma… Las ! Pendant tout ce temps, les tournages étaient à l’arrêt, les salles de répétition et de spectacle fermées, les festivals annulés, des projets abandonnés… En raison du risque sanitaire, le spectacle fut l’un des premiers secteurs mis à l’arrêt, il comptera parmi les derniers à retrouver des conditions d’activité normales. D’où l’inquiétude à propos de la reprise puisque – et c’est une  lapalissade –, afin de créer, tout artiste doit pouvoir vivre.
lapalissade –, afin de créer, tout artiste doit pouvoir vivre.
Depuis que les salles furent contraintes de fermer leurs portes début mars, les syndicats, en particulier la CGT spectacle, n’ont cessé d’alerter sur la situation précaire des auteurs et des intermittents, des techniciens et des artistes. Outre la tenue régulière de manifestations, ils ont contribué à la signature d’une pétition par plus de 200 000 personnes, ils ont participé à l’écriture de « propositions pour la continuité des droits à l’assurance-chômage des artistes et techniciens intermittents du spectacle ». Celles-ci ont été transmises à l’Élysée, faute de réponse du ministère de la Culture. Ajoutant leurs voix à celle de la CGT, des collectifs ont été créés, des tribunes publiées, la colère du comédien Samuel Churin – une figure historique de la lutte des intermittents – diffusée sur YouTube… Mais, tel qu’en lui-même, Emmanuel Macron, président de la République, ne sortira du bois que lorsque les stars s’en mêleront.
Droits sociaux incertains pour la reprise
« Aux artistes qui se sont exprimés, je veux dire que je les entends. L’État continuera de les accompagner, protégera les plus fragiles, soutiendra la création», twitte le chef de l’État le 2 mai suite à la tribune publiée dans Le Monde signée par près de trois cents personnalités : Jeanne Balibar et Catherine Deneuve, Jean Dujardin et Omar Sy… : « Comment feront les intermittents pour pouvoir continuer à acheter à manger après la prolongation [de la durée des droits à l’allocation chômage jusqu’au 30 juin 2020, ndlr] qui a été décidée ? Comment feront les auteurs qui ne bénéficient même pas de ce système ? » Dédaignant une fois de plus la place des syndicats, Emmanuel Macron s’entretient le 6 mai avec douze artistes avant de dévoiler son « plan pour la culture ». Il annonce que les droits des intermittents du spectacle seront « prolongés  d’une année » au-delà des six mois où leur activité aura été « impossible ou très dégradée », soit jusqu’à fin août 2021.
d’une année » au-delà des six mois où leur activité aura été « impossible ou très dégradée », soit jusqu’à fin août 2021.
Ce qui introduit incertitudes et oublis : vu le contexte, peu d’intermittents parviendront à travailler les 507 heures requises sur douze mois pour obtenir l’assurance-chômage (ARE). D’où la revendication CGT d’un report d’un an de toutes les dates anniversaires qui interviendraient avant la date butoir du 31 août 2021. Par exemple, quelqu’un qui a ses droits à l’assurance-chômage ouverts jusqu’en janvier 2021 pourrait les voir prolonger jusqu’en janvier 2022. Si le projet de texte élaboré début juin par le gouvernement semble répondre à cette demande, il oublie encore du monde : les femmes de retour de congé maternité, les nouveaux entrants dans le régime de l’intermittence, ceux qui sont en rupture de droits… « Je redoute qu’il ne leur soit proposé qu’une indemnité forfaitaire de 1000 euros », s’inquiète Denis Gravouil, le secrétaire général de la CGT Spectacle, « c’est le cas pour les auteurs, une aumône ! ».
Du chômage et des luttes
Dès le mois de mars, le syndicat a bataillé pour que les intermittents bénéficient de l’activité partielle comme leurs collègues permanents. De grandes entreprises privées, tel Disney, ont ainsi fini par s’y résoudre quand, en dépit de la demande du gouvernement, des institutions subventionnées comme l’Opéra de Bordeaux ont refusé. « De toute façon, même si on obtient des avancées sur l’assurance-chômage pour les intermittents », précise le syndicaliste, « dans les métiers de la culture, des tas de gens ne sont pas à ce régime ». Ce sont les CDD et ils n’ont pas eu droit à l’activité partielle. « Nous mènerons des luttes pour que tous ceux qui  devaient bosser sur les festivals en bénéficient », prévient-il.
devaient bosser sur les festivals en bénéficient », prévient-il.
La mise à l’arrêt du spectacle impacte aussi les activités connexes. « Comment feront tous ceux dont l’emploi est, comme le nôtre, discontinu : travailleurs engagés en extra (restauration, hôtellerie, nettoyage, commerce), tous les secteurs d’activité qui se déploient autour des événements culturels ? », interrogeait aussi la tribune des personnalités. En cas de maintien de la « réforme » de l’assurance-chômage, le durcissement des règles d’indemnisation les mènera au RSA. Alors, en amont des discussions avec le ministère du Travail, la CGT « fait monter la pression ». Fédérations du commerce et du spectacle, union des syndicats de l’intérim, comité des privés d’emploi et précaires, à l’instar de divers collectifs, dont celui des saisonniers CGT, ont multiplié les initiatives, telle la pétition pour l’abandon de la réforme ou l’organisation de manifestations inopinées…
Relance… Quelle relance ?
Les intermittents du spectacle sont au croisement de deux sujets, l’assurance-chômage avec leur régime spécifique et la culture puisqu’ils la font vivre au quotidien. Selon le site du ministère, le secteur contribue pour 2,2% au PIB du pays. Pourtant, bien que celui-ci soit probablement sinistré pour longtemps, les annonces présidentielles concernant sa relance se révèlent pingres, vagues et sans ambitions. Les intermittents sont ainsi incités à mener des actions dans les écoles. « Une tartufferie ! », s’agace Denis Gravouil. « Les artistes et techniciens le font déjà, une augmentation de leurs interventions ne fera pas la maille en volume d’emplois ». Autre chose serait une politique sur le  long terme visant à développer l’éducation artistique et culturelle avec des enseignants spécialisés.
long terme visant à développer l’éducation artistique et culturelle avec des enseignants spécialisés.
Le cinéma va bénéficier d’un fonds d’indemnisation temporaire pour les séries et tournages annulés, le nouveau Centre national de la musique d’une dotation de 50 millions d’euros. Un grand programme de commandes publiques est aussi prévu pour les plasticiens, le spectacle vivant, les métiers d’art… sans précision quant à l’enveloppe allouée. « Du saupoudrage quand il faudrait des milliards, un budget triennal et une loi de programmation pour relancer le secteur », juge le syndicaliste. La crise sanitaire pourrait accentuer en effet le phénomène de concentration qui, depuis une dizaine d’années, mine la diversité du tissu culturel et l’emploi (Fimalac pour les Zénith, Live Nation pour la production de festivals, de concerts ou d’artistes…) en raison de l’amoindrissement des politiques publiques.
Autre point important : la mise à contribution des Google, Amazon et autres Netflix. « La transposition de la directive européenne sur les droits d’auteur s’impose comme une priorité », souligne Denis Gravouil. Ce serait une première avancée concrète : de la valeur créée par la diffusion des œuvres sur Internet, la directive en prévoit le partage avec les auteurs et les artistes. Christine Morel
Roselyne Bachelot, rue de Valois
La main sur le cœur, Roselyne Bachelot l’avait promis et juré sur toutes les ondes et les écrans : la politique, plus jamais ! La native de Nevers, ancienne ministre de la santé de Nicolas Sarkosy et fringante égérie des Grosses têtes, prend donc la direction de la « maudite » rue de Valois, comme la qualifie le  quotidien Le Monde : depuis 1995, la douzième locataire du ministère de la Culture !
quotidien Le Monde : depuis 1995, la douzième locataire du ministère de la Culture !
À l’annonce de sa nomination, la férue d’opéra et coqueluche des média confie qu’elle sera « la ministre des artistes et des territoires ». Une déclaration qui réjouira le chef du gouvernement, ajoutant vouloir « approfondir les liens avec les élus locaux, les acteurs économiques » et « décloisonner le public et le privé ». Des propos qui ont plu à Jean-Marc Dumontet, l’influent producteur et ami des époux Macron, propriétaire de six théâtres à Paris et en province ! « Le théâtre est une nourriture aussi indispensable que le pain et le vin… », déclarait Jean Vilar quelques décennies plus tôt, « le théâtre est donc, au premier chef, un service public, tout comme le gaz, l’eau, l’électricité ». Yonnel Liégeois