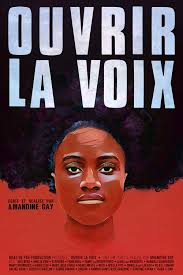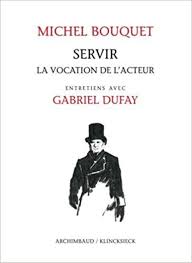Suite à de récentes fermetures de services ou d’activités, de nombreux usagers de l’A.V.H. (Association Valentin Haüy, destinée aux non et mal-voyants) s’inquiètent de l’évolution de la structure. Parmi eux, Yves Martin, bénévole en outre au GIPAA (Groupement pour une information progressiste des aveugles et des amblyopes) a choisi l’écriture, et le parti de l’imagination et de l’humour, pour dénoncer les décisions de la direction de l’association. Une nouvelle pour résister.
Avec son accord, nous nous félicitons de publier la nouvelle d’Yves Martin pour inaugurer l’année 2018. D’autant que Chantiers de culture a déjà rendu compte des initiatives culturelles du GIPAA… Voyants ou non, handicapés ou pas, tous frères en humanité, tous engagés dans la construction d’un monde plus juste et solidaire : ce sont les vœux que Chantiers de culture adresse chaleureusement à tous ses lecteurs et abonnés. Yonnel Liégeois
Je suis mort. Depuis cinq ans déjà, comme le temps passe… Bof, j’étais vieux et il était raisonnable que je m’arrête. J’ai bien vécu. Je continue malgré tout d’avoir un œil sur les affaires du monde. Enfin, de mon monde à moi, de celui que j’ai quitté sans tout à fait le quitter. J’aimais la vie. Je le dis sans regret. Je me fiche de l’avenir, ici ce n’est pas mon souci. Entre nous, on palabre, on rigole, on voit les choses autrement si je puis dire. Avec plus de recul, plus de hauteur, oui mes chers… On a intérêt à bien s’entendre, parce que ça risque de durer une éternité ! On ne dit pas que c’était mieux avant. Avant, c’était avant et c’est du passé dépassé. Nous sommes au-dessus de cela, n’est-ce pas ?
Depuis que je suis là, j’ai l’occasion de côtoyer tout le monde. On est tous arrivés par la même gare. Chacun a pris un train différent, on peut se raconter le voyage. De quoi parlons-nous entre colocs ? De tout. Par exemple, tantôt, je leur ai raconté l’histoire d’Ophélie. Voulez-vous que je vous la narre à vous aussi ? Oui, vraiment ?

Yves Martin, un homme qui voit loin
Bon, c’est parce que vous insistez.
Il était une fois une jeune fille très, très jolie. Même si elle avait été moche, ça n’aurait d’ailleurs rien changé et puis, à chacun ses repères. Elle s’appelle Ophélie. La société du monde a fixé des normes et, pour être admise, Ophélie ne rentre pas dans ces normes. Oui, j’ai bien dit pour être admise… Elle pense, crée, aime, elle touche, respire, entend, mais elle ne voit pas. Pour la société, c’est terrible, Ophélie est inadmissible : elle a des yeux qui ne voient pas ! Les autres étaient gênés, ils la rejetèrent comme « non conforme au standard de qualité ». Elle ne pouvait être certifiée totalement humaine. Ça me fendait le cœur. C’était si injuste, tellement idiot, si méchant. On la repoussait tout simplement parce qu’elle était « anormale », juste un peu hors norme. Oh, ça remonte à loin dans l’histoire, peut-être même depuis que la société humaine existe. Alors… Alors quoi ? Ce n’est pas une raison. La société veut se voir et se reconnaître dans l’image que le miroir lui renvoie. Si la « tête de l’autre » ne lui revient pas, elle refuse de se reconnaître en lui et le rejette. Ça peut aller loin, très loin. Du coup d’œil méprisant jusqu’aux extrêmes de l’extermination.
Certains de mes colocs refusaient la violence de mes paroles, d’autres les entendaient. Je me souviens de l’histoire d’un groupe d’aveugles qu’on avait exhibé un jour de foire sur la place de la Concorde. Des espèces de maquereaux les avaient déguisés en faux musiciens pour amuser le public et lui soutirer une aumône. C’est alors qu’un homme, un lettré, un sage passa par là. Écœuré par le spectacle dégradant, il décida de sortir ces hommes et ces femmes du mépris. Ce fut le premier instituteur des aveugles, il s’appelait Valentin Haüy ! Il chercha des moyens pour apprendre à lire, à écrire à des enfants qui ne voyaient pas. Il fonda un institut. Il leur apporta, avec les moyens de l’époque et de sa condition, la culture, un métier, une dignité. Plus tard, c’est dans cette école qu’un jeune élève aveugle, Louis Braille, inventa une écriture totalement nouvelle, adaptée au toucher. Ce ne fut pas sans difficultés. Comment un aveugle pouvait-il inventer une écriture pour les autres aveugles ? C’était le monde à l’envers.  La règle voulait que ce soit les normaux qui agissent pour le bien des aveugles…
La règle voulait que ce soit les normaux qui agissent pour le bien des aveugles…
On bâtit ensuite une école, entourée de hauts murs. Les aveugles avaient maintenant le droit d’apprendre, mais il ne fallait pas trop qu’on les voie. C’était bien ainsi. Les fidèles de l’église pouvaient exercer leur devoir de charité. Les riches qui avaient, on le sait, des problèmes pour accéder au paradis trouvaient là une occasion de gagner des points en s’adonnant aux « bonnes œuvres ». Certains patrons « paternalistes » pouvaient aussi acquérir une bonne conscience à bas coût. Maurice de la Sizeranne, aveugle lui-même, perfectionna l’œuvre de Louis Braille en rendant son écriture plus légère. En 1889, il fonda une association qu’il nomma du nom du premier instituteur des aveugles, Valentin Haüy ! Mais la démocratie, un homme-une voix, se cassa les dents contre les murs qui entouraient l’association : on faisait « pour le bien des aveugles », la société et l’État s’en lavaient les mains, Marianne regardait ailleurs. Les dons privés des uns, les legs des autres, apportaient du carburant à l’association et ça fonctionnait vaille que vaille.
Lorsque j’ai fait la connaissance d’Ophélie, elle était une jeune et pimpante étudiante en kinésithérapie. Je lui faisais de la lecture, elle se plaisait énormément dans cette association. C’était un peu sa famille, sa maison. Elle avait aussi des amis, un petit ami. Elle sortait, elle faisait des projets. L’existence de l’association lui apportait des possibilités qu’elle ne trouvait pas dans la vie ordinaire : étudier, aller à la piscine, faire du yoga, voyager… Évoluer dans un milieu adapté lui évitait un maximum de pièges ! Elle m’en parlait avec enthousiasme, avec la passion qu’ont les jeunes qui s’emballent comme des chevaux fous. C’est alors que je décidais de soutenir cette association qui faisait tant de bien à Ophélie. Moi-même, je n’avais pas d’enfant. Un jour, j’entrais dans une étude de notaire. Je dis au Maître « je veux léguer ma maison et quelques sous pour qu’Ophélie et les autres aveugles puissent accéder à une vie libre, digne, pleinement humaine ». Le Maître eut une esquisse de sourire, ce qui fut dit fut fait. Oui, il faut une association qui permette l’accès adapté au handicap dans une société non adaptée ! Certains pourront s’en  passer, c’est tant mieux pour eux, d’autres vivront plus confortablement dans une société qui prend soin d’eux et qui les respecte.
passer, c’est tant mieux pour eux, d’autres vivront plus confortablement dans une société qui prend soin d’eux et qui les respecte.
C’est que nous vivons, plus exactement nous vivions -décidément, j’ai du mal à m’y faire- dans un monde où l’image domine. Justement, il faut adapter cette société du tout pour l’image et compenser ce qui pèse aux personnes qui en sont privées. Puisque la société s’en bat l’œil, cela regarde l’association d’Ophélie. Ici, je les fais rire avec mes jeux de mots un peu nazes. Ils sont tous MDR ! Je me souviens, Ophélie me disait cependant que tout n’était pas nickel chrome dans le petit monde de Valentin Haüy ! Un exemple ? Ophélie était appelée « bénéficiaire » de l’association. Le terme « bénéficiaire » signifiait qu’on continuait à la considérer comme mineure, assistée, irresponsable. Jamais, on ne lui avait demandé son avis quant au fonctionnement, ni aux objectifs. Et puis quoi encore ? Pendant une période, la société et l’association se sont modernisées. Les technologies nouvelles sont parvenues à secouer la poussière accumulée sur les préjugés. La tolérance progressait face à la différence. Le handicap faisait un peu moins peur, on avait moins honte, on le connaissait mieux, ce n’était presque plus un sujet tabou.
Peu de temps après mon arrivée ici, j’appris une nouvelle qui me glaça le dos, je n’étais déjà pas chaud… Des gens venaient de faire main basse sur le patrimoine de l’association d’Ophélie ! Non pour le voler, pour l’enfermer dans un coffre-fort… J’étais scandalisé. Ma maison, mes sous, faisaient partie du lot. Je ressentais cela comme une véritable tromperie.
« Faut vous dire, Monsieur
Que chez ces gens-là
On n´cause pas, Monsieur
On n´cause pas, on compte »
Ils gardaient tout, enfermaient tout et affamaient l’association. Pauvre Ophélie ! Je faillis perdre mon sang froid. Après tout, ça ne me regardait plus mais je n’étais pas le seul cocu… Ces financiers justifiaient leur façon de faire par l’argument traditionnel, « c’est pour le bien des aveugles », ben voyons ! Personne n’avait jugé utile de consulter Ophélie. Du haut de ses dix-huit ans, elle pouvait maintenant voter pour choisir le Président de son pays, mais pas celui de son association. Le principe « une personne-une voix » n’était pas pratiqué ici. Trop risqué. Oui, mais Ophélie ne l’entendait pas de cette oreille. On était en train de tuer son association. Elle pouvait  de moins en moins compter sur ses services.
de moins en moins compter sur ses services.
J’en fus extrêmement malheureux. C’était scandaleux. Il n’y avait donc plus d’espoir ? Tous mes camarades qui avaient fait un don à l’association se sentirent violés dans leur conscience. Mais que peut faire un mort ? Dans la tombe, mes vieux os se retournaient. Je n’y pouvais rien. De fait, j’étais handicapé à 100% et ils le savaient bien… Je serrais les dents. Pourtant, il faut sauver Ophélie. Dans la vie des hommes, il n’y a plus qu’une seule valeur : l’argent. Même les associations sans but lucratif y succombent. Les individus qui ont, en quelque sorte, commis ce « détournement de dons », n’étaient pas foncièrement mauvais. Eux-mêmes étaient victimes de ce moulage de la société. Ils avaient été éduqués pour ça, avaient vécu pour ça et voulaient continuer « pour le bien de qui vous savez ». Alors, j’aurais donné tout ce que j’avais pour engrosser un coffre-fort ? C’était trop fort !
Un beau jour, peut-être une nuit, c’était Halloween, nous eûmes l’idée avec ma troupe de monter une pièce gore. Nous avions revêtu des suaires, très à la mode chez les fantômes. Vous savez, ce n’est pas parce qu’ils sont ici que mes colocs sont tous des petits saints. Nous allions dans les chambres et faisions des bruits de chaînes. « Hou, hou ! »… Comme le veut la tradition, nous nous amusions à aller tirer les orteils des gens qui bidouillaient avec les sous des autres au lieu d’en faire profiter Ophélie. Ça ne plaisait pas à Ophélie, elle nous trouvait trop gamins. Il ne suffit pas de les taquiner.
Avec ses copains de l’association, ils entrèrent je ne sais comment, peut-être par un œil, dans le crâne d’un de ces individus qui savaient ce qui était bien pour elle. Ils le perturbèrent dans son sommeil. Lui crut que ce n’était qu’un cauchemar. Ophélie cherchait le trésor en balayant partout avec sa canne blanche. Quel fatras là-dedans ! Elle farfouillait partout. C’était encombré de tableaux comptables, d’objets du culte à Sainte Rentabilité. Elle espérait trouver quelque chose, qui peut-être n’existait pas ici… « On ne sait jamais », murmurait-elle, s’il y avait là-dedans, ne serait-ce qu’une once d’humanité ». « Tu perds ton temps à chercher dans la poussière », disaient ses complices. Elle était jeune et naïve… Et puis elle trouva, bien camouflé, un coffre. Elle l’ouvrit. C’était un grand coffre rempli de relevés bancaires, de contrats d’assurance-vie, de titres de propriété. Elle vida le tout. Au fond,  miracle, recroquevillée, étouffée, il y avait une toute petite humanité. Ils s’en saisirent et la restituèrent à leur association.
miracle, recroquevillée, étouffée, il y avait une toute petite humanité. Ils s’en saisirent et la restituèrent à leur association.
Les effrontés interpellèrent l’emblématique Marianne. « Ohé, s’il vous plait, on existe, on est là. Selon vous, le sort des aveugles doit-il continuer à être tributaire de la charité ? Ne devriez-vous pas, vous Madame Marianne, faire jouer la solidarité ? » En attendant la réponse, Ophélie et tous les autres associés discutent de la route, appuient sur les manettes de la direction qu’ils ont choisie de suivre. Ils sont libres, respectés, responsables, comme l’avait voulu en son temps Valentin Haüy !
Elle vous a plu mon histoire, réalité ou fiction ? De toute façon, je suis mort, alors… Yves Martin
 qui se confond avec l’histoire contemporaine. Né le 16 mars 1927 d’un père cheminot et d’une mère lingère, Georges Séguy fut aux premières loges des bouleversements politiques, économiques, sociaux, que connut la France à partir du Front populaire. La guerre de 39-45, la décolonisation, mai 1968, l’arrivée de la gauche au pouvoir, la chute du bloc soviétique, l’ancien secrétaire général de la CGT (1967-1982) revient sur tous ces évènements, livrant son analyse avec un souci constant d’honnêteté intellectuelle. Court, deux cents pages, le livre n’en est pas moins dense.
qui se confond avec l’histoire contemporaine. Né le 16 mars 1927 d’un père cheminot et d’une mère lingère, Georges Séguy fut aux premières loges des bouleversements politiques, économiques, sociaux, que connut la France à partir du Front populaire. La guerre de 39-45, la décolonisation, mai 1968, l’arrivée de la gauche au pouvoir, la chute du bloc soviétique, l’ancien secrétaire général de la CGT (1967-1982) revient sur tous ces évènements, livrant son analyse avec un souci constant d’honnêteté intellectuelle. Court, deux cents pages, le livre n’en est pas moins dense. mouvement syndical : une vraie grève générale, 9 millions de grévistes. Avec des travailleurs qui géraient eux-mêmes leur lutte en bas, sans mot d’ordre d’état-major de sommet pour savoir ce qu’ils avaient à faire ». Un mouvement qui a valeur d’enseignement, dit-il. Car trop souvent, domine « l’idée que plus on est d’accord politiquement, moins les choses sont difficiles, et plus l’on trouve les solutions qui conviennent. Sans se soucier toujours de savoir si ça correspondait bien à la manière dont les masses des travailleurs appelés à participer à des luttes, adhéraient ou non à tout cela ». Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013, l’affirme dans sa préface. « Georges dit avoir changé au fil des rencontres. Non pas qu’il soit revenu sur ses valeurs ni sur sa soif de combattre pour la justice sociale, mais il a su, au contraire, évoluer au contact d’autres intelligences, d’autres parcours ».
mouvement syndical : une vraie grève générale, 9 millions de grévistes. Avec des travailleurs qui géraient eux-mêmes leur lutte en bas, sans mot d’ordre d’état-major de sommet pour savoir ce qu’ils avaient à faire ». Un mouvement qui a valeur d’enseignement, dit-il. Car trop souvent, domine « l’idée que plus on est d’accord politiquement, moins les choses sont difficiles, et plus l’on trouve les solutions qui conviennent. Sans se soucier toujours de savoir si ça correspondait bien à la manière dont les masses des travailleurs appelés à participer à des luttes, adhéraient ou non à tout cela ». Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT de 1999 à 2013, l’affirme dans sa préface. « Georges dit avoir changé au fil des rencontres. Non pas qu’il soit revenu sur ses valeurs ni sur sa soif de combattre pour la justice sociale, mais il a su, au contraire, évoluer au contact d’autres intelligences, d’autres parcours ».