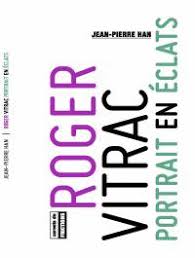Né en 1983, six ans avant la mort de Bernard-Marie Koltès (1948-1989), Arnaud Maïsetti enseigne les études théâtrales à l’université Aix-Marseille. Aux Éditions de Minuit, celles de Koltès depuis le début, il publie sur l’écrivain une monographie consistante composée avec ferveur. Avec, en pied d’article, une sélection de l’actualité théâtrale.
Ainsi s’étoffe, avec cette nouvelle publication et après les ouvrages de Brigitte Salino, Anne-Françoise Benhamou, Christophe Bident et François Bon, la bibliothèque vouée à celui dont Patrice Chéreau, qui l’imposa depuis le théâtre Nanterre-Les Amandiers avec Combat de nègre et de chiens, affirmait qu’« il transportait une morale du monde ». C’est ce que prouve l’auteur, après la consultation assidue d’archives, la collecte de témoignages et la lecture de l’abondante correspondance de Koltès, épistolier infatigable (lettres à sa mère, à son frère François, à Hubert Gignoux, à Lucien Attoun, aux amies…). Pour Arnaud Maïsetti, Koltès, convaincu très jeune de devoir être l’auteur de  sa vie, « ne possédait qu’une morale : celle de la beauté. Et qu’une loi : le désir ».
sa vie, « ne possédait qu’une morale : celle de la beauté. Et qu’une loi : le désir ».
De Koltès, autre « passant considérable » suivant le calque rimbaldien, éternel jeune homme timide, ombrageux, voyageur hors tourisme cherchant le danger non sans peur, ne pouvant écrire qu’au terme d’expériences des limites risquées, Maïsetti parvient donc sur un long parcours à brosser un portrait fortement rythmé. C’est qu’il ne néglige pas, de son modèle, les hantises et les héros secrets, James Dean, Bob Marley, Bruce Lee, lesquels ont fait bon ménage, dans son panthéon imaginaire, avec Dostoïevski et Faulkner. D’où une écriture violemment physique, sensible, charnelle, née d’expériences âpres et lumineuses dans des recoins sombres, en Afrique, en Amérique latine, loin de l’Occident honni. C’est là sans doute la proximité avec Genet et ce qui fit adhérer au Parti communiste, dans les années 1970, ce rejeton de famille bourgeoise provinciale qui s’adonna au métier d’écrire avec fureur. À mes yeux, les plus belles pages de ce livre, dont la précision dans l’analyse n’exclut pas une sorte d’élégant lyrisme, ont trait au combat pour écrire de Koltès avec lui-même. Belle leçon. Ce n’est pas facile. Les difficultés matérielles ne le rebutent pas et plus tard, quand l’argent vient avec le succès, le sida s’annonce. Ce tragique-là, Bernard-Marie Koltès, fidèle à sa rigueur d’être, ne l’a pas non plus surjoué.
Le court chapitre final, « Do We ? », est à cet égard d’un laconisme factuel exemplaire. Ce livre, un peu à l’écart de l’université, est d’abord d’amitié. Jean-Pierre Léonardini

Co Victor Tonelli
À voir actuellement :
– « Quai Ouest » de Bernard-Marie Koltès, dans une mise en scène de Philippe Baronnet au Théâtre de La Tempête, jusqu’au 15/04. Violence, misère et solitude : dans une noirceur et une lenteur presque exaspérantes, le choc de mondes irréconciliables, le tableau de vies brisées et déchiquetées à l’image du texte de Koltès hâché en moult séquences. Déchirants monologues, superbe interprétation.
– « Un métier idéal » et « Le méridien » avec Nicolas Bouchaud, dans une mise en scène d’Eric Didry au Théâtre du Rond-Point, jusqu’au 14/04. Sur les textes de John Berger et de Paul Celan, dans deux superbes « seul en scène » nourris de tact et de sensibilité, Bouchaud le magnifique nous interpelle sur le sens de la vie, ce qui nous fait respirer et marcher, vibrer  et créer. Du grand art à l’état brut.
et créer. Du grand art à l’état brut.
– « Mille francs de récompense » de Victor Hugo, dans une mise en scène de Kheireddine Lardjam au Théâtre de l’Aquarium, jusqu’au 08/04. Entre drame et comédie, une mise en scène virevoltante où, déjà, l’appât de l’argent et l’arrogance des possédants sont mis au banc des accusés. Le texte d’Hugo est toujours aussi porteur de verdeur et d’acidité à l’encontre des puissants face aux petites gens.
– « Le garçon du dernier rang » de Juan Mayorga, dans une mise en scène de Paul Desveaux, les 16 et 17/04 au Tangram d’Evreux-Louviers. Entre le professeur et son élève, un exercice littéraire pas vraiment innocent qui dérape dans le morbide  et le tragique. Une mise en scène finement ciselée de chaque côté de la baie vitrée, où le spectateur se demande en permanence qui manipule l’autre.
et le tragique. Une mise en scène finement ciselée de chaque côté de la baie vitrée, où le spectateur se demande en permanence qui manipule l’autre.
– « Lettres à Élise » de Jean-François Viot, dans une mise en scène d’Yves Beaunesne au Théâtre de l’Atalante, jusqu’au 14/04. À travers leurs lettres échangées, l’évocation d’un jeune couple pris dans la tourmente de la grande boucherie de 14-18. Lui au front, elle dans l’école où elle supplée son absence, entre cris d’amour et de détresse, un message final : plus jamais çà, plus jamais la guerre !
– « Opéraporno » écrit et mis en scène par Pierre Guillois au Théâtre du Rond-Point, jusqu’au 22/04. Le grotesque porté à l’extrême, des dialogues à hauteur de la fosse septique, une parodie du cul fort (dé)culottée… Un spectacle où l’absence de  finesse assumée le dispute au degré d’humour partagé, Jean-Paul Muel hilarant dans le rôle de la grand-mère violée par son petit-fils.
finesse assumée le dispute au degré d’humour partagé, Jean-Paul Muel hilarant dans le rôle de la grand-mère violée par son petit-fils.
– « La révolte » d’Augustin de Villiers de L’Isle-Adam, dans une mise en scène de Charles Tordjman au Théâtre de Poche-Montparnasse. L’ancien directeur de La Manufacture, CDN de Nancy-Lorraine, fait merveille dans sa direction d’acteurs. Face à un époux dépassé et impuissant face aux événements, la beauté révoltée d’une femme en quête de liberté. De l’émancipation, déjà en 1870 ! Yonnel Liégeois
 À voir prochainement :
À voir prochainement :
– « Parfois le vide » écrit et mis en scène par Jean-Luc Raharimanana au Théâtre Antoine-Vitez d’Ivry les 29-30 et 31/03, au Studio-Théâtre d’Alfortville les 20 et 21/04. Un voyageur, qu’on nomme « migrant », converse avec son double noyé. Un poème épique contre la violence des frontières, qui renoue avec la tradition malgache : s’emparer en voix et musique du récit du monde.
– « Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz » de Mohamed Kacimi, dans une mise en scène de Marjorie Nakache au Studio-Théâtre de Stains, du 29/03 au 13/04. Dans une maison d’arrêt, des codétenues répètent une scène de « On ne badine pas avec l’amour » de Musset. Dans l’écrin de Stains, la violence de la religion et le pouvoir des hommes dénoncés  face à l’idéal d’amour des femmes.
face à l’idéal d’amour des femmes.
– Le festival « Les Transversales » au Théâtre Jean-Vilar de Vitry, du 03 au 14/04. Pour en finir avec les frontières, oser un espace des possibles : après l’accueil de la Tunisie et du Maroc, focus sur l’Algérie et le Liban ! La troisième édition d’un festival qui se propose d’ouvrir des perspectives, d’offrir des écritures artistiques empreintes de réel et de partager d’autres points de vue.
– « La magie lente » de Denis Lachaud, dans une mise en scène de Pierre Notte au Théâtre de Belleville, du 04 au 15/04. Diagnostiqué schizophrène à tort, un homme va progressivement découvrir qui il est et pouvoir se réconcilier avec lui-même. Une quête de vérité pour exorciser  un passé traumatisant et conquérir sa liberté, se remettre en marche avec sa propre histoire.
un passé traumatisant et conquérir sa liberté, se remettre en marche avec sa propre histoire.
– « Sang négrier » de Laurent Gaudé, dans une mise en scène de Khadija El Mahdi au Théâtre de la Croisée des chemins, chaque jeudi jusqu’au 19/04. L’ancien commandant d’un navire négrier se raconte : sa plongée dans la folie lorsque cinq esclaves, échappés de la cale, sont traqués à mort dans le port de Saint-Malo. Une histoire terrifiante, un vibrant plaidoyer pour la dignité humaine. Y.L.
 que notre République répressive connaît encore quelques ostentatoires poches critiques ».
que notre République répressive connaît encore quelques ostentatoires poches critiques ».