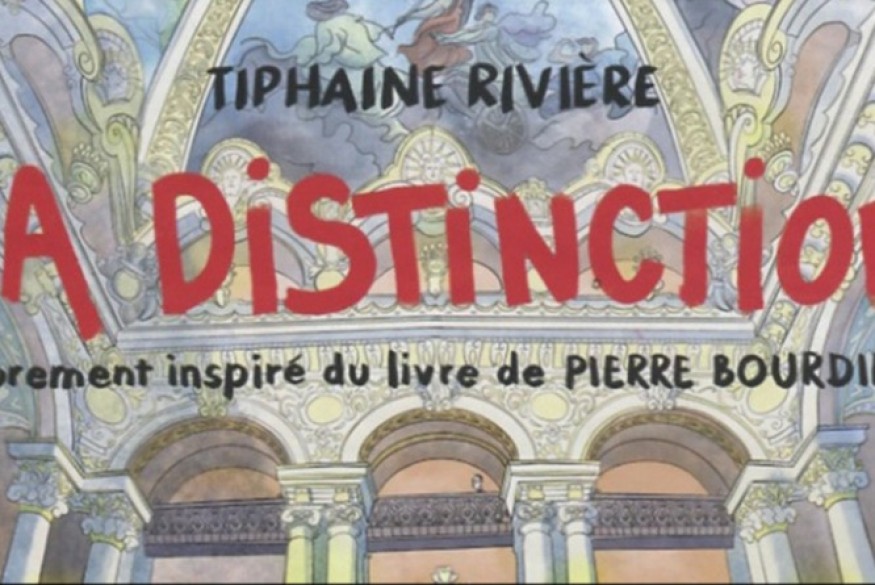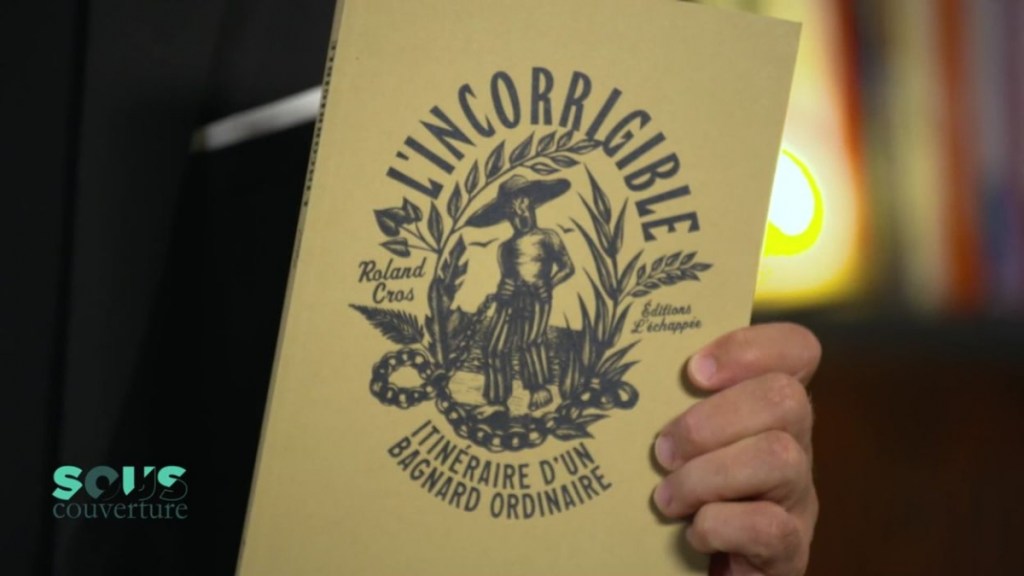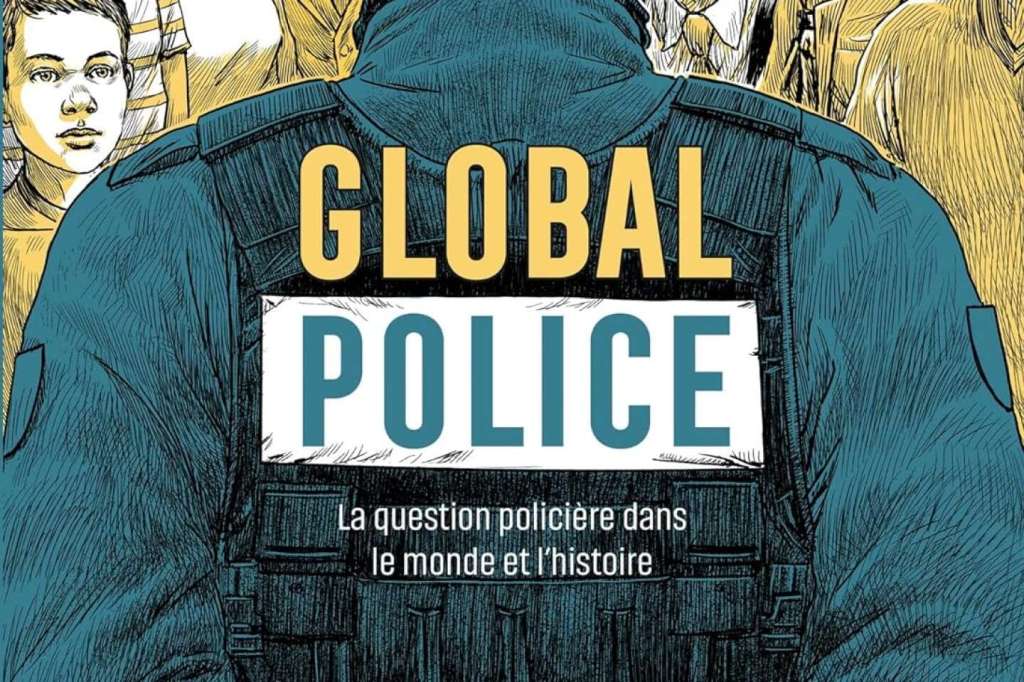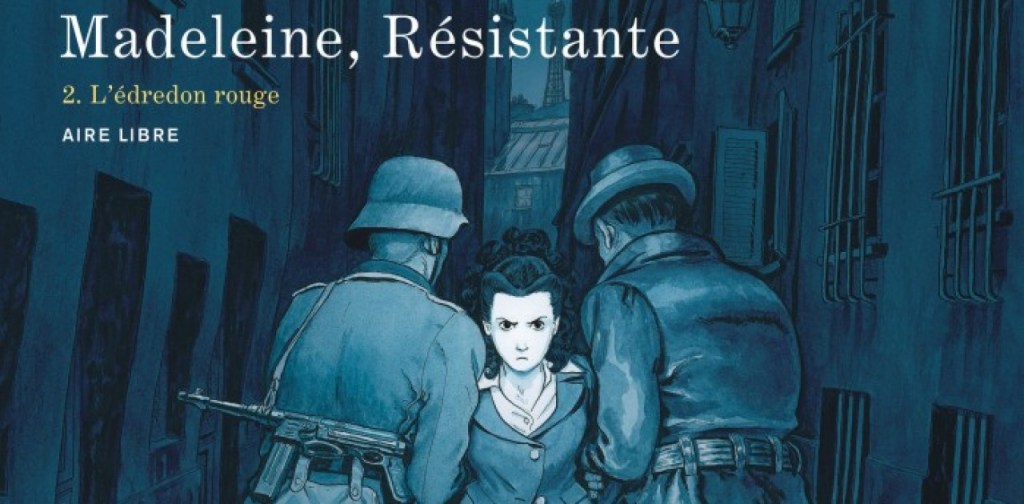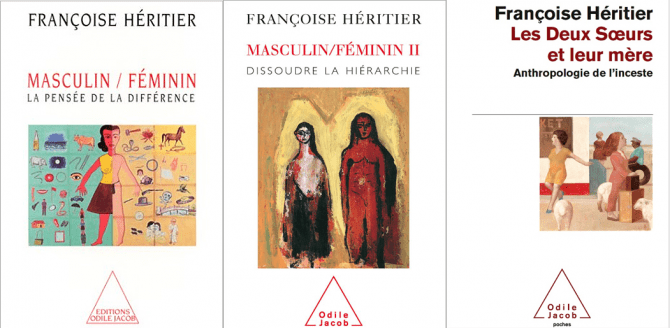Mathématicienne, écrivaine, Michèle Audin est décédée le 14 novembre, à 71 ans. Elle était la fille de Josette et Maurice Audin, assassiné en 1957 par l’armée française en Algérie. Membre de l’Oulipo, elle se fit historienne, passionnée par la Commune de Paris. Paru dans le quotidien L’Humanité, un article d’Aurélien Soucheyre.

Il y a les littéraires. Il y a les matheux. Et puis il y avait Michèle Audin, qui savait jouer avec brio de ces deux langues. Mêler les chiffres et les lettres, inventer des structures alliant rigueur, poésie et travail mémoriel était devenu son terrain d’art et d’expérimentation. Dans son équation personnelle, il y avait d’abord eu un gros manque, un moins l’infini même : son père, le mathématicien et militant communiste Maurice Audin, torturé et assassiné par l’armée française pendant la guerre d’Algérie, en 1957. Elle avait seulement trois ans. Il avait eu le temps de lui apprendre à lire, à écrire, et à compter, un peu.

Ce sont les chiffres qu’elle explore d’abord, brillante mathématicienne et spécialiste de la géométrie symplectique et professeure à l’Institut de recherche mathématique avancée de Strasbourg à partir de 1987. Pour sa « contribution à la recherche fondamentale en mathématique et à la popularisation de cette discipline », le président de la République Nicolas Sarkozy lui propose en 2008 la Légion d’honneur. Michèle Audin la refuse aussi sec. La raison ? Un an auparavant, sa mère Josette Audin avait écrit à l’Élysée, demandant que vérité soit faite sur le meurtre de Maurice Audin, dont le corps et les assassins n’ont jamais été retrouvés. Le chef de l’État n’avait même pas daigné répondre. Il faudra attendre 2018 pour qu’Emmanuel Macron reconnaisse enfin la responsabilité de l’État et de l’armée française dans ce crime colonial. Une victoire à l’issue de la si longue quête de la famille Audin pour la justice, même si bien des zones d’ombre demeurent.
Membre de l’Oulipo
Plus tôt, en 2013, Michèle Audin avait écrit Une vie brève (Gallimard – Collection l’Arbalète), récit pudique consacré à ce père assassiné à 25 ans, et ce qu’il reste de lui tel qu’il était. « Ni le martyr, ni sa mort, ni sa disparition ne sont le sujet de ce livre. C’est au contraire de la vie, de sa vie, dont toutes les traces n’ont pas disparu, que j’entends vous parler ici », racontait-elle.. Mais c’est son tout premier récit, sur Sofia Kovalevskaïa, grande mathématicienne victime de sexisme, qui lui vaut immédiatement d’être repérée par l’Oulipo, l’ouvroir de littérature potentielle fondé par Queneau, où elle est élue en 2009.

Dès lors, Michèle Audin s’autorise toutes les audaces, en croisant prose et arithmétique, en inventant la très géométrique contrainte littéraire de Pascal et en usant d’onzine et de sixtine, jusqu’au roman La formule de Stokes (Cassini, 2016), où l’héroïne est carrément une formule mathématique ! À l’entrelacement des disciplines, va très vite s’ajouter celui des époques. Passé, présent et futur sont des temps métissés. Michèle Audin, prise de passion par la Commune de Paris, y consacre à la fois des romans, des travaux d’historienne, et un blog passionnant, d’une érudition phénoménale, reprenant le fil de la révolution de 1871 en la racontant au jour le jour pour le cent-cinquantenaire de la Commune, en 2021. Une entreprise titanesque, qui avait trouvé écho sur le site de l’Humanité, avec une chronique quotidienne.
Avec le peuple de 1871
D’où lui venait cet intérêt ? D’elle-même, Michèle Audin faisait le lien avec ses parents et l’Algérie. « J’ai été élevée dans une famille communiste. Une certaine idée de la Commune de Paris faisait partie de la culture ! », nous lançait-elle en 2021. Ou encore : « Comme l’a dit l’homme responsable du massacre des communards : » Le sol de Paris est jonché de leurs cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon, il faut l’espérer, aux insurgés qui osaient se déclarer partisans de la Commune. « Il s’agissait de terroriser la population, pour interdire d’autres insurrections. C’est analogue, par exemple, aux massacres menés en Algérie, eux aussi par l’armée française, à Sétif et Guelma en mai 1945. »

C’est aussi le peuple révolutionnaire de 1871, son ambition démocratique et sociale qui happe Michèle Audin, ce peuple en mouvement du roman Comme une rivière bleue (Gallimard, 2017). Ce peuple vaincu qui se cache après la défaite dans Josée Meunier, 19 rue des Juifs (Gallimard, 2021), où l’écrivaine, à la manière de Georges Perec, « épuise » la litanie méticuleuse d’une perquisition, et décortique la vie d’un immeuble, d’un appartement à l’autre, et d’une révolution à l’autre : 1830, 1848, 1871… Ici, elle invente une histoire d’amour au sujet d’un personnage réel, Albert Theisz, délégué à la poste de la Commune de Paris, et témoin de mariage entre Charles Longuet et Jenny Marx.
Historienne de la Semaine sanglante
Sa rigueur toute mathématique la pousse parallèlement à devenir pleinement et très efficacement historienne. Michèle Audin avait déjà édité des textes d’Eugène Varlin, publiés en intégralité pour la première fois grâce à elle (Libertalia 2019). Elle avait aussi exhumé les lettres d’Alix Payen, ambulancière de la Commune (2020). Mais en 2021, elle se lance, avec l’ouvrage La semaine sanglante, dans un décompte précis des victimes. « Bizarrement, personne n’a fait cette histoire depuis Du Camp et Pelletan (1879-1880). À part une revitalisation des comptes de Du Camp par Tombs aussi tardivement qu’en 2010 », s’étonnait-elle alors.

La voilà plongée dans les archives, les registres de chaque cimetière, les documents des pompes funèbres. « On s’aperçoit vite qu’il n’est pas possible d’arrêter de « compter les morts » le 30 mai, comme l’ont fait Du Camp, puis Tombs. Par exemple, rien qu’au cimetière Montmartre, arrivent, le 31 mai, 492 nouveaux corps d’inconnus », signale-t-elle, avant de calculer, registres à l’appui, que 10 000 personnes ont été inhumées « pendant et après » la Semaine sanglante. À la fin, Michèle Audin est formelle : « il y a eu certainement 15 000 morts » lors de la répression versaillaise. Tout chiffre en dessous n’est pas sérieux.
Elle était la fois discrète, respectueuse et directe, sans filtre quand elle avait quelque chose à dire. Michèle Audin avait publié une belle géographie des luttes avec Paris, Boulevard Voltaire (Gallimard, L’arbalète) et s’était penchée sur le quotidien de Strasbourg sous l’Occupation, avec La maison hantée (Les éditions de minuit). Une capitale alsacienne qu’elle connaissait bien et où elle est morte. Elle avait 71 ans, 71 comme l’année de la Commune. Aurélien Soucheyre
À lire, paru dans L’Humanité, un autre article d’Aurélien Soucheyre : « Michèle Audin, l’une des plus justes continuatrices de Perec, l’hommage de son éditeur Thomas Simonnet ».
Lors de la publication d’une série d’articles sur La Commune de Paris ( du 22/03 au 31/05/2021), Chantiers de culture avait interrogé Michèle Audin sur les références et la pertinence de certains livres parus à l’occasion du 150ème anniversaire de l’événement. Elle avait répondu au courriel, le 16/04/21, avec le ton naturel et direct qui la caractérisait si bien : « Merci pour votre appréciation sur mon blog… Si vous n’avez rien trouvé sur ces livres, c’est simplement qu’il n’y a rien : je ne mentionne que les livres que j’ai utilisés dans tel ou tel article, et je n’utilise que des livres que j’ai lus. Mais je n’utilise pas tout ce que j’ai lu. Et, bien entendu, je n’ai pas tout lu ! Merci, en tout cas, pour les indications que vous me communiquez. Salut & égalité, Michèle Audin ». Une belle et grande figure des sciences et des lettres nous a quitté, une remarquable mathématicienne et flamboyante écrivaine, une plume à l’écoute de l’Histoire et pétrie d’humanisme. Yonnel Liégeois