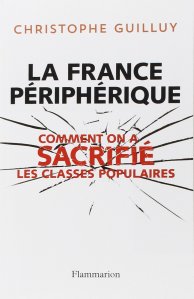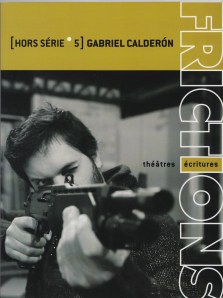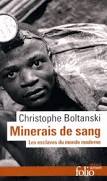Feuilles volantes ? Idées, impressions flottantes, subjectives, éphémères, jetées à la dérive pour faire venir le poème en nous… Comment l’esprit d’un lieu, un bruit, une image, des musiques, un texte, un travail, un film, un parfum-même, nous atteignent dans notre quotidien, nous altèrent et nous désaltèrent, nous invitent à renouveler notre présence au monde.
Depuis longtemps je ne suis pas venu ici, au Havre, dans cette ville, ce port que j’aime tant. Départ un samedi matin. Bien que novembre soit presque en son milieu, le jour émerge d’un ciel ouaté, assourdi dans des vêtements de soies légères. Assurance que l’azur n’est pas loin. Miroitements de silice de la lumière mouillée, perlés de grenelés roses. A l’horizon, la visite de l’exposition Nicolas de Staël au musée André Malraux.
 Nous sommes invités à des noces radieuses et simples. On pense cela à cause du ciel, de la campagne verte un peu acide, caressée des couleurs douces encore pâles du jour, mais aussi parce que nous avons à notre horizon la visite de l’exposition Nicolas de Staël au musée André Malraux. Et que celui-ci est allé au bout, sans transiger sur l’acte de peindre, de l’intérieur, en nous, ces rencontres. Il s’y est appliqué, méthodiquement, lutte à mort.
Nous sommes invités à des noces radieuses et simples. On pense cela à cause du ciel, de la campagne verte un peu acide, caressée des couleurs douces encore pâles du jour, mais aussi parce que nous avons à notre horizon la visite de l’exposition Nicolas de Staël au musée André Malraux. Et que celui-ci est allé au bout, sans transiger sur l’acte de peindre, de l’intérieur, en nous, ces rencontres. Il s’y est appliqué, méthodiquement, lutte à mort.
Ce trajet que l’on fait pour aller là-bas, on aurait aimé l’effectuer par le train, puisque justement ils ne sont pas trop rapides ceux qui, de Saint-Lazare, mènent au Havre. On en trouve qui font le trajet en deux heures mais c’est la semaine, pour le travail ! Le week-end, c’est changement obligé à Rouen, voire Amiens… Pas moins de quatre heures. Là, ça lambine trop, tout de même, alors on y renonce ! Le train, pourtant, lorsqu’il ne file pas à trop d’allure, lorsqu’on entend encore la cadence des bruits d’acier sur les rails, et pas seulement au passage des aiguillages ou à l’approche des gares, fait mieux vivre sensiblement la temporalité du transport au-delà du seul calcul minuté de la durée. Ce roulis brinquebalant nous rend au temps et au parcours.
Le voyage n’est pas que destination. Le train c’est aussi les gares, les heures et salles d’attentes, l’errance et les bousculades, les cafés, les valises, les retards et, du coup, l’exactitude. L’effervescence effrénée monde et la somnolence de la solitude. Le bavardage avec l’éphémère et inconnu compagnon de voyage. La crainte qu’il soit ennuyeux ou encore qu’il mange salement, pire qu’il soit envahissant et prive de la lecture mêlée à l’observation des paysages et des ciels entraperçus. La fille sera-t-elle avenante et vive ? Le train c’est encore la traversée des villes, l’arrivée par la trachée entre leurs poumons serrés en leur plein cœur. Le TGV n’est déjà plus le train. Avec lui, nous traversons des régions rendues virtuelles. Le paysage est un trait, un paraphe, celui que notre pensée imprime sur une abstraction, qui peut être belle d’ailleurs mais trop animée, mangée par la vitesse, qui n’a pas d’instant pour interroger. Là, les rares gares traversées n’ont plus de nom. Un territoire de nulle part. Autre chose. On aura toutes ces réflexions en tête en visitant de Staël.
 Toutefois, la voiture, c’est pas mal non plus. D’abord, la route épouse le paysage, l’histoire du paysage. Traces labourées de parcelles décousues et strates économiques, géologiques, géographiques, sociales, politiques en leurs désordres qui font que le paysage est histoire de pensées et d’activités humaines, de guerre et de paix, sans cesse revue et relue. Recherche toujours de cohérence dans le chaos.
Toutefois, la voiture, c’est pas mal non plus. D’abord, la route épouse le paysage, l’histoire du paysage. Traces labourées de parcelles décousues et strates économiques, géologiques, géographiques, sociales, politiques en leurs désordres qui font que le paysage est histoire de pensées et d’activités humaines, de guerre et de paix, sans cesse revue et relue. Recherche toujours de cohérence dans le chaos.
Ensuite, c’est l’autoroute. Quand ça roule bien, elle a également son charme ! L’autoroute, les routes modernes à très grande circulation, semblent toujours être un ruban posé au dessus de tout, niant avec arrogance et surplomb ce que la route, elle, raconte modestement des siècles passés. Peu d’auteurs encore aujourd’hui disent l’autoroute et la voient familière au paysage. Peu disent les féeries de l’autoroute comme Annie Ernaux nous parle, elle, des surprises de son supermarché dans les lumières de la ville. Tout l’humain doit d’abord être aimé si l’on veut porter la critique juste. Pour transformer il faut d’abord voir, entendre. Poésie. La route de notre enfance était le prolongement du chemin. Sa « forme » est encore celle-là. Pas loin d’ici, certaines ont encore le visage de l’ancien chemin creux qu’elles furent. Je vois cela, clairement, en écoutant Mozart joué par Maria-João Pires qui, justement maintenant, m’enchante à la radio. Le simple délice du bavardage. Métaphore musicale du chemin. L’art de la conversation et de la promenade.
Avec l’autoroute, nous sommes dans l’idée de trajectoire. Je n’ai jamais pu vraiment mettre la musique là-dessus ou alors le soir lorsque le crépuscule est déjà bien avancé et que, roulant à tombeau ouvert, les lumières de la terre et celles du ciel constellé d’éclats viennent, telles des lucioles, peupler l’unique espace drapé de velours noir qui leur sert d’écrin. Pas besoin de compact, c’est le violoncelle de Bach qui monte en tête. Depuis qu’on l’a réentendu, rendu avec son grain, comme neuf à l’oreille, dans « Le Paradis » d’Alain Cavalier, tout aussi bien, là, on se laissera porter par le saxo de Lester Young dans Stardust.
 En arrivant par le pont de Normandie, c’est une vision d’avion que l’on a, on ressent la vibration lente, régulière de la respiration portuaire. A l’entrée en ville, d’emblée le sentiment que Le Havre a changé, imperceptiblement. Il est aujourd’hui classé Patrimoine de l’Unesco. D’aucun s’en étonnent. Moi, je me demande pourquoi c’est venu si tard ! Cette reconnaissance a donné force et confiance. Le Havre a du traverser de nombreuses épreuves. La guerre, la destruction, la fin des transatlantiques… Peut-être de là d’ailleurs, mon attachement lointain à cette ville lorsque gosses, de notre banlieue, on allait à Saint-Lazare pour saluer de notre curiosité heureuse l’arrivée des vapeurs acheminant par trains entiers à Paris les voyageurs des transatlantiques nord, ayant transité au Havre. Il y avait aussi les excursions dominicales en famille pour visiter des paquebots. Je me souviens d’avoir visité ainsi le Liberté. Tout cela nourrit l’imaginaire.
En arrivant par le pont de Normandie, c’est une vision d’avion que l’on a, on ressent la vibration lente, régulière de la respiration portuaire. A l’entrée en ville, d’emblée le sentiment que Le Havre a changé, imperceptiblement. Il est aujourd’hui classé Patrimoine de l’Unesco. D’aucun s’en étonnent. Moi, je me demande pourquoi c’est venu si tard ! Cette reconnaissance a donné force et confiance. Le Havre a du traverser de nombreuses épreuves. La guerre, la destruction, la fin des transatlantiques… Peut-être de là d’ailleurs, mon attachement lointain à cette ville lorsque gosses, de notre banlieue, on allait à Saint-Lazare pour saluer de notre curiosité heureuse l’arrivée des vapeurs acheminant par trains entiers à Paris les voyageurs des transatlantiques nord, ayant transité au Havre. Il y avait aussi les excursions dominicales en famille pour visiter des paquebots. Je me souviens d’avoir visité ainsi le Liberté. Tout cela nourrit l’imaginaire.
Et puis il y aussi l’histoire ouvrière, portuaire et industrielle qui, dans cette ville fait culture. L’aventure du Salon des peintres ouvriers, celle de la Maison de la culture, la forte implication, notamment des travailleurs des entreprises de la chimie, dans la rencontre artistique… A l’hôtel où nous sommes, notre fenêtre ouvre justement sur  l’œuvre d’Oscar Niemeyer en réfection. Le chantier en exhume les entrailles. Alors qu’habituellement, et surtout d’ici, vu de haut, on pense les cônes blancs du Volcan comme négligemment posés sur le sable, tels des seaux d’enfants abandonnés sur une plage, donjon et tour du château, on les découvre au centre de la cour carrée enceinte des immeubles d’Auguste Perret. On voit là, dans les caves ouvertes, les viscères et conduits d’alimentation en fluides. Vision quasi archéologique qui rappelle celle des fouilles. Véritable métaphore de ce que serait penser. Nous sommes samedi, un silence profond règne sur le chantier et son excavation.
l’œuvre d’Oscar Niemeyer en réfection. Le chantier en exhume les entrailles. Alors qu’habituellement, et surtout d’ici, vu de haut, on pense les cônes blancs du Volcan comme négligemment posés sur le sable, tels des seaux d’enfants abandonnés sur une plage, donjon et tour du château, on les découvre au centre de la cour carrée enceinte des immeubles d’Auguste Perret. On voit là, dans les caves ouvertes, les viscères et conduits d’alimentation en fluides. Vision quasi archéologique qui rappelle celle des fouilles. Véritable métaphore de ce que serait penser. Nous sommes samedi, un silence profond règne sur le chantier et son excavation.
Plus loin, dans la zone portuaire, du côté des bassins Vauban et Vatine, la résurgence ici de cette rencontre si singulière des approches artistiques et des pratiques populaires et ouvrières. Là, cinq grands murs des docks entièrement couverts d’affiches, placardées bord à bord, et du même format. Imposants et grands portraits noirs et blancs, très certainement de dockers, ainsi côte à côte et de face, visages aux yeux écarquillés, formant d’imposants tableaux. Sur l’un d’eux, vraisemblablement le portrait d’un homme aujourd’hui décédé, des graffitis, forme d’ex-voto signés par les camarades et la famille à la mémoire de celui trop vite disparu. Au pied, restes de rameaux, aujourd’hui desséchés, déposés sans doute ici en hommage. Cérémonie.
 Ailleurs, marouflés sur les piliers d’un autre bâtiment, des peintures papier très colorées et qui tiennent encore, bien qu’elles soient face aux intempéries. Collée sur le coin de mur d’un entrepôt, l’image d’une petite sirène, par sa gracilité et par la pirouette qu’elle esquisse et qu’accompagne le décollement du papier entamé sous l’effet du vent, me réconforte par sa naïveté. Presque comme une fresque des catacombes romaines, triomphe de la fragilité sur le temps.
Ailleurs, marouflés sur les piliers d’un autre bâtiment, des peintures papier très colorées et qui tiennent encore, bien qu’elles soient face aux intempéries. Collée sur le coin de mur d’un entrepôt, l’image d’une petite sirène, par sa gracilité et par la pirouette qu’elle esquisse et qu’accompagne le décollement du papier entamé sous l’effet du vent, me réconforte par sa naïveté. Presque comme une fresque des catacombes romaines, triomphe de la fragilité sur le temps.
Le Havre, la ville, c’est une architecture généreuse, soignée, parfaitement dessinée, née de sa reconstruction conçue par Auguste Perret. Alvar Aalto, un autre architecte, finlandais lui, a eu cette phrase : « l’architecture ne peut pas sauver le monde, mais elle peut lui donner le bon exemple ». Peut-être ici juste l’essai, l’image, l’idée de ce que cela pourrait vouloir dire. Reconstruction difficile, avec des moyens chiches, des matériaux de peu de qualités (ciments, sables). Pourtant aucune mesquinerie. Souvent l’impression d’aisance dans les surfaces et lieux de circulation publics. De vastes espaces parfois, mais jamais « lâchés », toujours signifiant leur nécessité. Pas de dalles. Pas d’immeubles vraiment isolés. Une rue de Paris, qui ne reproduit pas les arcades de la rue de Rivoli, mais s’inspire de son esprit. Et comme dans beaucoup d’autres villes de maintenant, le tram qui vient fluidifier les mouvements de la circulation urbaine, mais ici avec beaucoup de discrétion. Il y a bien du monumental, mais jamais de l’imposant, du grandiloquent. Hôtel de ville, église Saint Joseph.
On vient ici avec en tête deux romans , celui de Julia Deck « Le triangle d’hiver », celui très différent de Linda Lé « Œuvres vives ». Deux films aussi, « 38 témoins » de Lucas Belvaux (2012) et « Le Havre » d’Aki Kaurismäki (2011), coulissent avec eux dans les tiroirs de mon imagination. Je retrouve cela.
L’architecture de Perret ne recopie pas l’ancien urbanisme et les anciennes architectures du Havre, il en reprend subtilement les codes pour en faire l’outillage de base d’une vraie modernité. Chacun peut le voir, chacun peut aussi le savoir en allant chercher. C’est ce rapport au passé et à l’aujourd’hui, que l’on sent si fort, qui fait le bon exemple. Un glissement sensible. Sans doute la vieille église, cathédrale depuis 1974, un des rares bâtiments ayant échappé aux bombardements alliés mais qui en porte les stigmates, relie aussi au passé. Nous aimons qu’elle soit petite et belle et que la ville se reçoive, de nuit, sur ce coussin dentelé calcaire et doré.

Face au Havre,1952. Huile sur carton Collection privée, J.L. Losi – Adagp, Paris, 2014
Le Havre c’est aussi le musée Malraux, construit en front de mer et voulu par celui qui en porte le nom. Ouvert au plein vent et aux lumières si changeantes, il a pris la belle patine des maisons de bord de mer. Fort carré, balayé par les embruns, il a maintenant un ton délavé tirant vers l’amande clair. Il y a gagné dans son osmose avec la mer. Il a un peu perdu d’une certaine sacralité. Ainsi, il est probablement moins intimidant. Il a gagné en familiarité.
Ici Nicolas de Staël est en son lieu. On y exposait « Lumières du Nord – Lumières du sud ». A part Antibes, au musée Picasso où se prolonge jusqu’en janvier 2015 l’exposition « La figure à nu », je n’imagine pas de lieu pouvant accueillir avec un tel bonheur Nicolas de Staël. Les salles du musée, séparées d’avec la mer juste par de seuls rideaux translucides qui toujours permettent de l’entrevoir et de s’y perdre, quand l’émotion est trop forte, et n’autorisent pas la confrontation immédiate à une autre toile. Il faut laisser la pensée se refaire avant de passer à une autre. Toutes les œuvres accrochées forment ici un immense tableau en trois dimensions. Les toiles de Nicolas de Staël n’ont pas d’horizon. L’espace muséal non plus, ou alors c’est celui de la mer. On s’égare dans l’ensemble de ce tableau comme dans chaque détail qu’en constitue chacune des œuvres, en cherchant la bonne distance si difficile à trouver. On laisse venir le tableau à soi, tout simplement. On circule aisément. Comme dans la ville, c’est dense mais fluide. Étonnant silence. Le travail de l’attention en chacun. 100 000 visiteurs sont venus là, depuis juin, à l’écoute. « Il y a parfois une montagne d’esprit dans une parcelle de matière », soutenait Nicolas de Staël.
Dépassée par l’évènement, la petite librairie du musée n’offre pas à la vente les « Lettres de Nicolas de Staël, 1926-1955« . Regrets, le catalogue de l’exposition est épuisé. Jean-Pierre Burdin
 qui menace en lieu et place de la stagflation. Mais comme il y a trente ans, le discours économique fort d’une supposée scientificité prétend qu’il n’y a aucune alternative. Et le politique, hier encore synonyme de puissance, abdique devant l’intendance. C’est ce que Jean-Pierre Dupuy, dans un petit livre acerbe titré « L’avenir de l’économie », appelle « l’économystification du politique ».
qui menace en lieu et place de la stagflation. Mais comme il y a trente ans, le discours économique fort d’une supposée scientificité prétend qu’il n’y a aucune alternative. Et le politique, hier encore synonyme de puissance, abdique devant l’intendance. C’est ce que Jean-Pierre Dupuy, dans un petit livre acerbe titré « L’avenir de l’économie », appelle « l’économystification du politique ».