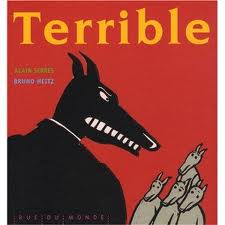Du 29 avril au 7 mai, se déroule dans sept villes et villages cévenols le Festival international du documentaire. Né en 2001 dans le village de Lasalle, au cœur de la vallée de la Salindrenque, il a progressivement pris son essor. Pour sa quinzième édition, il chausse des bottes de « sept lieues » et fourmille de surprises. Sur une thématique : les temps modernes.
Depuis plusieurs jours, des affichettes bleu et jaune apparaissent dans les villages cévenols et jusque sur les murettes bordant l’antique chemin de Régordane, l’actuelle départementale 906 qui d’Alès monte en lacets vers le Nord, à l’assaut du Mont Lozère. Elles annoncent Doc-Cévennes, le 15e festival international  du documentaire en Cévennes, consacré cette année aux Temps modernes. Des temps cruels, où le drame des réfugiés le dispute au tragique de la condition des salariés, chair d’ajustement aux besoins de rentabilité d’un capital aveugle, et aux dommages mortels infligés par les hommes à leur écosystème, dont la programmation du festival porte l’empreinte.
du documentaire en Cévennes, consacré cette année aux Temps modernes. Des temps cruels, où le drame des réfugiés le dispute au tragique de la condition des salariés, chair d’ajustement aux besoins de rentabilité d’un capital aveugle, et aux dommages mortels infligés par les hommes à leur écosystème, dont la programmation du festival porte l’empreinte.
Le festival est né et a grandi à Lasalle, localité de 1200 habitants, dans l’écrin d’émeraude de la vallée de la Salindrenque, sous l’égide de l’association Champ Contrechamp. L’impulsion initiale, il la doit à la passion d’un homme : Henri de Latour, cinéaste et documentariste (1), natif de Lasalle dont il est devenu maire. « Lasalle est un microclimat propice à l’éclosion d’une telle initiative : terre protestante, puis terre de résistance, de refuge et de liberté », souligne Guilhem Brouillet, délégué général du festival. Il y a deux ans, le festival a affirmé plus nettement sa dimension internationale et pris l’essor local qu’il connaît aujourd’hui. Outre Lasalle, six villes et villages cévenols, Florac-Le Vigan-Valleraugue-Ganges-Pont de Montvert-Vialas, accueillent cette année vingt-deux séances. « Au total, les documentaires choisis sont proposés dans dix salles de projection, dont quatre à Lasalle », expose Guilhem Brouillet. « Chaque projection ouvre à un débat avec des protagonistes du film, son réalisateur ou un membre de l’équipe de tournage. Aucun film n’est « orphelin », même s’il vient du bout du monde. Si personne ne peut se déplacer physiquement, le débat a lieu en direct avec les spectateurs sur Skype. Par exemple, deux directs sont prévus avec l’Afghanistan. C’est ce qui fait la force de notre festival ». Et de poursuivre « ici, pas de tapis rouge, pas de carré VIP, pas de badges. Dans les rues des villages, sur les places, aux terrasses des cafés, des spectateurs, des réalisateurs, parfois célèbres, se croisent et échangent en toute égalité ».
Guilhem Brouillet a accompagné pas à pas le développement du festival. Spectateur lors de sa deuxième édition, il y consacre ses soins assidus et enthousiastes. En tant que bénévole d’abord puis comme assistant de programmation, tout en préparant un doctorat à l’université de Montpellier où il était chargé de cours. Aujourd’hui, il se démène avec la même vigueur qu’au premier jour, dans la jungle des droits ou des formats de films, allant jusqu’à faire traduire et sous-titrer certains des plus beaux fleurons de sa programmation éclairée. Avec un fil rouge : l’ambition qu’affiche ce festival hors des sentiers battus. « Nous présentons des documentaires de création, qui rompent avec l’uniformisation de l’information. Nous donnons la parole à d’authentiques réalisateurs dont la vision personnelle bouscule, questionne, instruit, donne à penser ». Il insiste sur l’exigence qui préside à la programmation : « Un documentaire prend le monde comme objet et questionne le monde. C’est ainsi qu’il suscite l’esprit critique. La rigueur documentaire doit s’allier à la rigueur artistique. Le documentaire est une œuvre de création au même titre qu’un film de fiction. Bref, c’est du cinéma ». C’est un autre point fort du festival.
Vialas, petit village d’à peine 500 âmes accroché aux pentes du Mont Lozère s’est inscrit dans le festival l’an dernier, pour sa quatorzième édition. Le petit dernier des  villages engagés dans l’aventure. Les «Mesdames Cinéma » de la localité sont deux conseillères municipales, Mireille Rousseau et Isabelle Mercier. En s’appuyant sur l’association Cinéco, dont l’objectif est d’offrir une ouverture culturelle par le biais de l’accès au septième art aux habitants du Gard et de la Lozère éloignés des villes, elles se sont employées à développer une programmation régulière sur l’année dans une salle conventionnée, validée par le CNC (Centre national du Cinéma), à la Maison du temps libre. « Auparavant, des séances ponctuelles étaient organisées, surtout l’été, proposant essentiellement des films grand public », relate Mireille Rousseau. Désormais, aux séances mensuelles s’ajoutent des événements comme Doc en Cévennes en mai et le Mois du documentaire en novembre où chaque projection est suivie d’un débat ». Elles réunissent quarante à cinquante personnes chaque fois. « L’idée force, c’est de créer des moments de rencontres et de discussions sur des sujets universels », poursuit Isabelle Mercier, « de faire découvrir un travail artistique souvent en phase avec des questions d’actualité, tel le printemps arabe l’an passé, les lois touchant l’organisation du travail cette année ».
villages engagés dans l’aventure. Les «Mesdames Cinéma » de la localité sont deux conseillères municipales, Mireille Rousseau et Isabelle Mercier. En s’appuyant sur l’association Cinéco, dont l’objectif est d’offrir une ouverture culturelle par le biais de l’accès au septième art aux habitants du Gard et de la Lozère éloignés des villes, elles se sont employées à développer une programmation régulière sur l’année dans une salle conventionnée, validée par le CNC (Centre national du Cinéma), à la Maison du temps libre. « Auparavant, des séances ponctuelles étaient organisées, surtout l’été, proposant essentiellement des films grand public », relate Mireille Rousseau. Désormais, aux séances mensuelles s’ajoutent des événements comme Doc en Cévennes en mai et le Mois du documentaire en novembre où chaque projection est suivie d’un débat ». Elles réunissent quarante à cinquante personnes chaque fois. « L’idée force, c’est de créer des moments de rencontres et de discussions sur des sujets universels », poursuit Isabelle Mercier, « de faire découvrir un travail artistique souvent en phase avec des questions d’actualité, tel le printemps arabe l’an passé, les lois touchant l’organisation du travail cette année ».
C’est fort de cette expérience que Vialas a souhaité s’inscrire dans le festival Doc-Cévennes. Le 5 mai, deux films sont au programme à partir de 18 heures. « Pipelines, pouvoir et démocratie » d’Olivier Asselin, où sera présente Alyssa Symons-Bélanger (protagoniste du film), retrace la lutte de quatre individus face à la pollution causée par l’exploitation des sables bitumineux au Canada. « Comme des lions » de Françoise Davisse, qui sera projeté en présence de Philippe Julien, ouvrier de PSA, évoque les quatre mois de grève des salariés de PSA contre la fermeture du site d’Aulnay-sous-Bois. « Ces deux films ont une résonance  particulière pour notre territoire. D’une part le passé industriel de nos vallées, notamment les mines, est encore très présent dans les paysages comme dans les mémoires, d’autre part les Cévenols sont très sensibles aux problématiques environnementales», explique Mireille Rousseau. « Faire venir le documentaire à Vialas, le rendre accessible à tous, interpeller, c’est ce qui nous a guidées et nous motive à continuer ».
particulière pour notre territoire. D’une part le passé industriel de nos vallées, notamment les mines, est encore très présent dans les paysages comme dans les mémoires, d’autre part les Cévenols sont très sensibles aux problématiques environnementales», explique Mireille Rousseau. « Faire venir le documentaire à Vialas, le rendre accessible à tous, interpeller, c’est ce qui nous a guidées et nous motive à continuer ».
Tant de films sont annoncés qu’on ne sait plus où donner des yeux. Le mieux est de s’y plonger en ligne et de se laisser guider par l’intérêt que l’on porte à telle ou telle thématique ou simplement par la soif de découverte. De nombreux temps forts en émergent : un focus sur le cinéma danois permettra de découvrir le travail d’Anders Riis-Hansen, d’Andreas Johnsen ou de Camilia Nielsson. Le cinéma québécois est aussi mis à l’honneur cette année avec, entre autres, « Le Chant des étoiles » de Nadine Beaudet ou encore « Pipelines, pouvoir et démocratie » déjà cité. Le 6 mai, Lasalle passe à l’heure chilienne, l’espace d’une soirée, avec plusieurs documentaires signés Elvira Diaz, en présence de la cinéaste, « Victor Jara n°2547 » et « Y volveré ».
Cerise sur le gâteau, Nicolas Frize et Bill Drummond, compositeurs hors norme dont les films seront présentés au festival (2), se rencontreront le 5 mai à Lasalle pour échanger sur la composition musicale quand elle devient lien social : une autre manière de regarder la vie et d’entendre le son. « Nous avons aussi soutenu  la création d’un Master 2 « Documentaire de création », fruit d’un triple partenariat entre l’Université Paul-Valéry, la commune de Lasalle et les Ateliers Varan », informe Guilhem Brouillet. Ce cycle d’études, uniquement ouvert à la formation continue (salariés et demandeurs d’emploi), bénéficie du soutien financier de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. « Durant trois mois, en immersion totale, chacun des huit stagiaires de la première promotion a réalisé un documentaire tourné à Lasalle. Les stagiaires étaient invités à s’engager personnellement dans le choix de leur sujet et à montrer leur capacité à construire une relation avec les personnes ou les groupes qu’ils décident de filmer. Les huit films qu’ils ont réalisés seront présentés… Les spectateurs ont toutes les chances d’en croiser les protagonistes au hasard de leurs déambulations dans le village » !
la création d’un Master 2 « Documentaire de création », fruit d’un triple partenariat entre l’Université Paul-Valéry, la commune de Lasalle et les Ateliers Varan », informe Guilhem Brouillet. Ce cycle d’études, uniquement ouvert à la formation continue (salariés et demandeurs d’emploi), bénéficie du soutien financier de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. « Durant trois mois, en immersion totale, chacun des huit stagiaires de la première promotion a réalisé un documentaire tourné à Lasalle. Les stagiaires étaient invités à s’engager personnellement dans le choix de leur sujet et à montrer leur capacité à construire une relation avec les personnes ou les groupes qu’ils décident de filmer. Les huit films qu’ils ont réalisés seront présentés… Les spectateurs ont toutes les chances d’en croiser les protagonistes au hasard de leurs déambulations dans le village » !
« Un pays sans documentaire, c’est comme une famille sans photo ». L’affirmation en forme de devise sert d’exergue et de fil rouge à ce festival en Cévennes où, durant sept jours et sept soirées, vont résonner des voix d’ici et d’ailleurs, s’entremêler des images étranges ou familières. De quoi, peut-être, ébaucher un monde meilleur. Marie-Claire Lamoure
(1) En 2013, il a réalisé « Bien de chez nous », un film participatif et citoyen tourné à Lasalle, dans lequel les habitants du village incarnent les protagonistes. Disponible en DVD.
(2)Nicolas Frize, « Au temps ». Bill Drummond, « Imagine waking up tomorrow and all music has disappeared ».

















 Girandole
Girandole