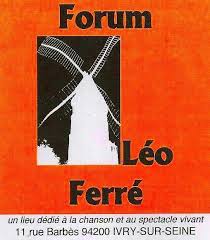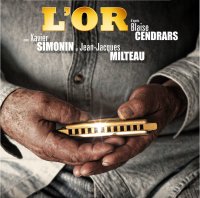Comment donner à voir et à entendre la réalité du travail, sans didactisme ni prise de tête ? Avec plus ou moins de bonheur, auteurs et metteurs en scène s’y emploient. Proposant leur regard décalé, poétique ou réaliste, ludique ou dramatique, pour rendre compte du quotidien des hommes et femmes d’aujourd’hui. Tour d’horizon.
 Pour tout décor et accessoire, au milieu de la scène une échelle double, rouge… Autour, virevoltent et dansent, dessus dessous, en équilibre instable ou précaire, quelques personnages haut en couleurs. Qui dissertent surtout, au sens propre du terme, sur Marx et Spinoza, deux philosophes d’un siècle révolu mais aux propos qui se révèlent d’une actualité brûlante ! Prise de tête, lourdeur du verbe ? Que nenni, justement… « Bienvenue dans l’angle Alpha » ? Un spectacle de haute teneur, où les concepts philosophiques certes des plus ardus ou hardis volent d’une bouche à l’autre, avec humour et poésie, pour le plus grand bonheur du public qui se laisse emporter dans ce tourbillon métaphysique fort osé !
Pour tout décor et accessoire, au milieu de la scène une échelle double, rouge… Autour, virevoltent et dansent, dessus dessous, en équilibre instable ou précaire, quelques personnages haut en couleurs. Qui dissertent surtout, au sens propre du terme, sur Marx et Spinoza, deux philosophes d’un siècle révolu mais aux propos qui se révèlent d’une actualité brûlante ! Prise de tête, lourdeur du verbe ? Que nenni, justement… « Bienvenue dans l’angle Alpha » ? Un spectacle de haute teneur, où les concepts philosophiques certes des plus ardus ou hardis volent d’une bouche à l’autre, avec humour et poésie, pour le plus grand bonheur du public qui se laisse emporter dans ce tourbillon métaphysique fort osé !
Le pari réussi de la metteure en scène Judith Bernard, et de sa compagnie ADA ? Oser adapter pour le théâtre Capitalisme, désir et servitude de l’économiste Frédéric Lordon (Éditions La Fabrique). Une réflexion philosophique fort sérieuse, ni plus ni moins que l’analyse comparative et finement instruite de deux concepts, la servitude chez Marx et le désir chez Spinoza : le travail aliène l’homme et subvertit la moindre de nos émotions, dit le premier, il terrasse irrémédiablement notre puissance d’agir, notre « conatus », affirme le second ! Pour conclure selon Lordon, en un langage propre à notre troisième millénaire : capitalisme et finance internationale ont fait main basse et commerce à leur seul avantage de la totalité de nos passions, réduisant à néant nos moindres désirs et goûts du plaisir !
Incroyable, impensable : loin d’être ennuyeux ou rébarbatif, le propos s’éclaire par le jeu de la troupe, quoi qu’exigeant il devient limpide et d’une incomparable force humoristique : sous les mots, avancent démasqués le capitalisme et son lot de méfaits. Face au travail aliénant, la troupe nous souhaite donc la « Bienvenue dans l’angle Alpha », celui-là même qui nous rend notre pleine dimension créatrice lorsqu’il est grandement ouvert… Sous la houlette de Judith Bernard, les comédiens nous entraînent avec délectation dans ce concert de mots et de pensées complexes mais pourtant accessibles ! Une prouesse scénique, quand la philosophie et l’économie se dégustent dans un flot d’humour et de fantaisie pour rendre sa plénitude à la réalité du travail réel : libérateur, intelligent, cultivé et signifiant pour celui qui le produit. Il est vrai que Lordon et Bernard sont des récidivistes… « D’un retournement l’autre » (Éditions du Seuil) est le titre d’un autre livre du premier (voir ci-dessous), « une comédie sérieuse sur la crise financière, en quatre actes et en alexandrins » proprement jubilatoire, que la seconde avait déjà mise en scène !

Co Jean-Louis Fernandez
Et le capitalisme financier, Arnaud Meunier, le jeune directeur de la Comédie de Saint-Étienne, s’en empare aussi avec jubilation et dextérité ! Sans manichéisme, nous donnant juste à voir l’extraordinaire histoire des frères Lehman, de 1844 à 2008… La saga de jeunes immigrés, juifs allemands, qui s’installent dans le sud des Etats-Unis pour ouvrir une maigre boutique de tissus. Au pays des esclaves et des champs de coton, que faire d’autre ? « Une histoire savoureuse et fascinante », commente le metteur en scène, « l’histoire de trois hommes qui s’usent à la tâche et au travail, qui s’échinent comme des baudets pour faire fructifier leur petite entreprise »… Au fil du temps et de l’actualité, la guerre de sécession – la construction du chemin de fer – le crash de 1929, le petit commerce devient un véritable empire : s’écrivent alors les « Chapitres de la chute, saga des Lehman Brothers » !
Un spectacle de quatre heures où le spectateur ne s’ennuie pas un seul instant, grâce aux talents conjugués de la troupe et de son mentor : montrer plus que démontrer, démonter sous le couvert de personnages bien réels la construction lente et patiente de ce qui devient au final le capitalisme financier. « J’apprécie beaucoup l’écriture de Stefano Massini », confesse Arnaud Meunier, « à l’image de Michel Vinaver, il propose un théâtre qui ne juge pas, il parvient à humaniser une histoire souvent virtuelle. Entre petite et grande histoire, celle d’une famille d’immigrés et celle du capitalisme international, il nous rend proche un domaine bien souvent présenté comme trop complexe et réservé aux économistes patentés ». De fait, pas de leçon de morale sur le plateau, juste la dissection au fil du temps, à petit feu et à petits pas, du processus qui conduit à l’émergence et à l’explosion de l’économie boursière en 2008, à l’heure de la chute de la quatrième banque des Etats-Unis et de l’effondrement des bourses mondiales…
Une saga théâtrale qui éclaire admirablement le trajet de l’économie des hommes et des peuples, lorsqu’elle passe du réel au virtuel, lorsque la finance se nourrit et se reproduit jusqu’à saturation et indigestion de son propre produit, l’argent ! Avec son corollaire : le travail n’est plus là pour satisfaire les besoins de l’humanité, il est juste une matière ajustable pour le bonheur des marchés financiers. Et pas seulement les gestes du travail, « le travailleur lui-même dans ce contexte devient aussi une denrée virtuelle », souligne Arnaud Meunier, « qui compte juste pour ce qu’il rapporte, non pour ce qu’il produit ». Et de poursuivre : « Le spectacle ne dénonce pas le capitalisme, il le raconte et en ce sens il peut faire œuvre d’émancipation. Dans ce monde complexe qu’est devenu le nôtre, je crois que le théâtre a charge et capacité d’ébranler les consciences, il permet de réinterroger l’humain que nous sommes et de nous mettre face à nos responsabilités. De remettre, en final, de l’humain dans les rouages des rapports sociaux ». Un pari encore une fois réussi et gagné par la troupe : en dépit de la longueur des « Chapitres de la chute », le spectateur est rivé à l’écoute de cette histoire familiale, puis entrepreneuriale et mondiale, contée sur un mode ludique pour mieux lui faire comprendre les dessous et les rouages d’un système financier et économique complexe. Du grand art !
 Las, en dépit des intentions proclamées, la réussite n’est pas toujours au rendez-vous sur le plateau ! Ainsi en va-t-il pour « À demain » au Théâtre de l’Aquarium, un texte et une mise en scène de Pascale Henry. Un homme, retenu contre son gré, doit répondre à une série de questions avant que d’aucuns décident de son avenir. Une interlocutrice qui, elle-même, est soumise aux interrogations de sa supérieure hiérarchique pressée de boucler le dossier qui, elle-aussi, subit la pression d’encore plus haut… À mots couverts, sans indication particulière mais pressé de trouver une issue, le spectateur, censé se trouver face aux nouvelles méthodes managériales qui provoquent souffrances et douleurs chez nombre de salariés dans moult entreprises, éprouve lui-même quelque peine à affronter tel traitement de choc. Espérons que la rencontre – débat ( avec Nicolas Aubert, sociologue et psychologue, Jean-Pierre Burdin, consultant « Artravail(s) » et Dominique Méda, philosophe et sociologue) initiée au final de la représentation du 07/02, « La dictature de l’urgence au travail : peut-on arrêter la machine ? », apportera les éclaircissements indispensables… A trop vouloir l’étreindre, on étouffe son sujet. Un spectacle au propos désincarné, au jeu pesant et caricatural, qui obscurcit plus qu’il ne clarifie la question.
Las, en dépit des intentions proclamées, la réussite n’est pas toujours au rendez-vous sur le plateau ! Ainsi en va-t-il pour « À demain » au Théâtre de l’Aquarium, un texte et une mise en scène de Pascale Henry. Un homme, retenu contre son gré, doit répondre à une série de questions avant que d’aucuns décident de son avenir. Une interlocutrice qui, elle-même, est soumise aux interrogations de sa supérieure hiérarchique pressée de boucler le dossier qui, elle-aussi, subit la pression d’encore plus haut… À mots couverts, sans indication particulière mais pressé de trouver une issue, le spectateur, censé se trouver face aux nouvelles méthodes managériales qui provoquent souffrances et douleurs chez nombre de salariés dans moult entreprises, éprouve lui-même quelque peine à affronter tel traitement de choc. Espérons que la rencontre – débat ( avec Nicolas Aubert, sociologue et psychologue, Jean-Pierre Burdin, consultant « Artravail(s) » et Dominique Méda, philosophe et sociologue) initiée au final de la représentation du 07/02, « La dictature de l’urgence au travail : peut-on arrêter la machine ? », apportera les éclaircissements indispensables… A trop vouloir l’étreindre, on étouffe son sujet. Un spectacle au propos désincarné, au jeu pesant et caricatural, qui obscurcit plus qu’il ne clarifie la question.
Plus tôt dans la saison au Théâtre du Rond – Point, « Élisabeth ou l’Équité » ratait lui-aussi sa cible. Mis en scène par Frédéric Fisback, le texte d’Eric Reinhardt ne décolle pas d’un réalisme aux tirades convenues. Certes, le délégué syndical CGT occupe les planches pour la première fois peut-être dans l’histoire du théâtre, mais ce seul fait inédit n’assure en rien la qualité de la pièce, tant elle manque d’inspiration, de souffle et d’émotion. Pourtant, le sujet méritait traitement sous les projecteurs : le combat d’une petite entreprise pour sa survie, humaine et industrielle, contre le projet de fermeture concocté par un puissant fonds de pension américain… En réalité, sans surprise ni suspens, nous est surtout donnée à voir la bluette naissante entre le « rouge » de service et la charmante D.R.H. en butte à la vindicte de ses grands patrons ! Dans la mise en espace de l’univers du travail, n’est pas Vinaner qui veut…
 Autrement convaincant, dans une forme plus modeste et épurée, ce que nous propose la comédienne et metteur en scène Stella Serfaty avec son spectacle « J’ai trop trimé » : un regard plus intimiste sur les ravages que provoque justement ce système économique, sur les femmes au travail plus précisément. Des témoignages recueillis par la sociologue Nadine Jasmin. Cinq portraits de femmes, de l’ouvrière à la patronne d’une petite entreprise qui, chacune à leur façon, démontent les mécanismes sociaux et blocages qu’elles ont subi au travail… Des paroles brutes, fortes et émouvantes où l’une dénonce le pouvoir hégémonique de la hiérarchie masculine et l’autre le manque de prise en compte des revendications spécifiques aux femmes dans les organisations syndicales : ici, on est loin de la langue de bois, du discours convenu !
Autrement convaincant, dans une forme plus modeste et épurée, ce que nous propose la comédienne et metteur en scène Stella Serfaty avec son spectacle « J’ai trop trimé » : un regard plus intimiste sur les ravages que provoque justement ce système économique, sur les femmes au travail plus précisément. Des témoignages recueillis par la sociologue Nadine Jasmin. Cinq portraits de femmes, de l’ouvrière à la patronne d’une petite entreprise qui, chacune à leur façon, démontent les mécanismes sociaux et blocages qu’elles ont subi au travail… Des paroles brutes, fortes et émouvantes où l’une dénonce le pouvoir hégémonique de la hiérarchie masculine et l’autre le manque de prise en compte des revendications spécifiques aux femmes dans les organisations syndicales : ici, on est loin de la langue de bois, du discours convenu !
Il en est de même avec « Entre-temps, j’ai continué à vivre », de Jacques Hadjaje : sur un terreau commun, dans l’est de la France où l’on vient de fermer le dernier puits de mine, cinq hommes et femmes tentent de s’inventer un avenir ! Une tâche ardue, lorsque le travail a déserté le quotidien des jours ou se révèle simple occupation, où il faut apprendre à retisser des liens sociaux ou bien, tout bonnement, réapprendre à vivre, autrement… « La mine n’est pas le sujet d’« Entre-temps… », commente l’auteur et metteur en scène, « pourtant elle est le seul personnage récurrent du texte. Elle témoigne d’un « avant », elle symbolise les rêves floués. Les personnages ont la volonté de s’en sortir mais à chaque pas le sol menace de se dérober : c’est plein de trous, plein de galeries là-dessous, un vrai gruyère ! ». Alors, avec ou sans travail, un seul objectif : se battre pour la vie, l’avenir, contre toutes les morts annoncées…

Co Elisabeth Carecchio
Avec « La grande et fabuleuse histoire du commerce », Joël Pommerat porte certes un regard aiguisé sur une profession bien spécifique, les démarcheurs à domicile, mais il en profite surtout pour dénoncer la société de consommation dans laquelle nous vivons. Là encore, ils sont cinq, cinq hommes qui passent leurs journées à sonner aux portes pour vendre leur marchandise. Peu importe sa nature, une arme à feu, une encyclopédie, une chose qui ne sert à rien… Et dans la solitude de leur chambre d’hôtel, les vendeurs de se retrouver pour faire le bilan de la journée, annoncer aux autres « combien ils en ont placé », avec quels stratagèmes entre mensonge et vérité : qu’il soit stagiaire ou aguerri, novice ou expert du porte à porte, chacun est rivé à sa performance, salaire et avenir professionnel en dépendent !
Dans le clair-obscur des projecteurs, réussite ou fiasco d’une journée de vente s’entrechoquent ! Des hommes éreintés de fatigue, désespérés de n’avoir atteint leur objectif, usés d’abuser de ce petit jeu de la vérité et du mensonge pour flouer le client : un spectacle fort, poignant, la mise en abîme d’une société à la dérive. « Avec ce spectacle, je voulais montrer comment ces ouvriers du commerce sont partie prenante et victime du système économique dans lequel ils vivent », souligne Joël Pommerat, « en choisissant de représenter deux groupes de vendeurs à deux périodes historiques éloignées de trente ans, je voulais montrer également comment le système avait évolué, devenant plus sensible et plus humain en apparence dans la période moderne mais encore plus violent en réalité et déshumanisant ». Et de dénoncer « une société imprégnée de logique commerciale et commerçante, dans laquelle vendre et acheter sont aussi naturels que marcher, manger, respirer… ».
Où tout s’achète et se vend, est-il loisible d’ajouter : la force de travail, la valeur du travail, la beauté du travail. Pour n’en retenir que son poids marchand pour l’un, sa marge de profit pour l’autre… Aussi, quand la scène interpelle aussi fortement l’univers du travail et ses acteurs sociaux, un seul mot d’ordre : pousser la porte du théâtre ! Yonnel Liégeois
La finance en alexandrins !
Étrange ouvrage que celui de Frédéric Lordon, économiste patenté et philosophe ! D’un retournement l’autre se veut une « comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes, et en alexandrins »… Non, vous ne rêvez pas : il s’agit bien de cette forme ancienne d’écriture, le vers à douze pieds, qui nous donne à lire la crise de la finance mondiale. En scène le Président de la République et ses conseillers, banquiers et traders, gouverneur de la banque de France et journaliste : tous les acteurs sont en place, la comédie peut commencer ! Un texte où les répliques fusent d’un acte à l’autre, derrière le rire, l’horreur d’un système financier décortiqué sans complaisance. Mieux ou aussi bien qu’un volumineux traité de sciences économiques, sous couvert de la farce ou de la pochade, un ouvrage qui permet au lecteur de pénétrer plus avant dans les arcanes mentales et les raisonnements machiavéliques des cyniques maîtres de la finance.
 Une telle longévité pose toutefois question. Grâce à Internet et à l’essor de l’informatique, l’ouverture sur le monde est sans limite. Des sources d’informations, autrefois inatteignables, sont devenues accessibles. « L’oreille gauche » correspond-elle encore aux modes de vie d’aujourd’hui ? Les animateurs de l’association n’en doutent pas. D’abord parce que tout le monde ne possède pas un ordinateur et nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas Internet, ensuite l’exercice est bien plus compliqué pour les non-voyants et la consultation de documents est parfois payante. Enfin, et surtout, les responsables du GIPAA sont convaincus que la bataille des idées est plus que jamais d’actualité, aussi il ne peut être question de laisser les aveugles et amblyopes seuls dans leur coin.
Une telle longévité pose toutefois question. Grâce à Internet et à l’essor de l’informatique, l’ouverture sur le monde est sans limite. Des sources d’informations, autrefois inatteignables, sont devenues accessibles. « L’oreille gauche » correspond-elle encore aux modes de vie d’aujourd’hui ? Les animateurs de l’association n’en doutent pas. D’abord parce que tout le monde ne possède pas un ordinateur et nombreux sont ceux qui ne maîtrisent pas Internet, ensuite l’exercice est bien plus compliqué pour les non-voyants et la consultation de documents est parfois payante. Enfin, et surtout, les responsables du GIPAA sont convaincus que la bataille des idées est plus que jamais d’actualité, aussi il ne peut être question de laisser les aveugles et amblyopes seuls dans leur coin. Accompagnés de guides bénévoles ou de conférenciers professionnels, les non -voyants entreprennent des visites d’usines comme celle de Renault Cléon. Certaines initiatives peuvent même paraître improbables. La descente de nuit dans le métro parisien en a constitué le plus bel exemple, les organisateurs ont été stupéfaits par le succès rencontré ! Plus récemment, les Halles de Rungis ont accueilli des groupes de visiteurs du GIPAA. En juin prochain, le centre de tri postal de Wissous, le plus grand d’Europe, est au programme. Preuve qu’une organisation en adéquation avec le handicap permet l’accès à la plupart des loisirs : visites de musée, projections de film, représentations théâtrales… Pas d’exclusive non plus, en ce qui concerne les voyages : des adhérents se sont rendus à Cuba, au Vietnam. Ils ont rencontré des associations de non-voyants mais ils ont également visité des écoles, des crèches, des usines. Des contacts placés résolument sous le signe de l’échange, puisque stylos, papier, blouses d’infirmière mais aussi matériel informatique étaient dans les bagages des touristes. Histoire de se sentir utile, en d’autres termes : être actif ! Une posture défendue par le GIPAA, y compris en ce qui concerne la culture. Le défi n’est pas simple à relever à une époque où le citoyen est avant tout considéré comme un consommateur.
Accompagnés de guides bénévoles ou de conférenciers professionnels, les non -voyants entreprennent des visites d’usines comme celle de Renault Cléon. Certaines initiatives peuvent même paraître improbables. La descente de nuit dans le métro parisien en a constitué le plus bel exemple, les organisateurs ont été stupéfaits par le succès rencontré ! Plus récemment, les Halles de Rungis ont accueilli des groupes de visiteurs du GIPAA. En juin prochain, le centre de tri postal de Wissous, le plus grand d’Europe, est au programme. Preuve qu’une organisation en adéquation avec le handicap permet l’accès à la plupart des loisirs : visites de musée, projections de film, représentations théâtrales… Pas d’exclusive non plus, en ce qui concerne les voyages : des adhérents se sont rendus à Cuba, au Vietnam. Ils ont rencontré des associations de non-voyants mais ils ont également visité des écoles, des crèches, des usines. Des contacts placés résolument sous le signe de l’échange, puisque stylos, papier, blouses d’infirmière mais aussi matériel informatique étaient dans les bagages des touristes. Histoire de se sentir utile, en d’autres termes : être actif ! Une posture défendue par le GIPAA, y compris en ce qui concerne la culture. Le défi n’est pas simple à relever à une époque où le citoyen est avant tout considéré comme un consommateur.



 Un étonnant voyage aujourd’hui dans le paysage urbain de la ville de Sevran (93), hier de surprenants paysages industriels colorés ou de fantomatiques hommes en fuite vers un ailleurs, Michel Séméniako transfigure la réalité au moyen de ses multiples faisceaux lumineux projetés sur tel ou tel élément, au gré de ses torches graphiques et de son imaginaire. Tel un peintre réinventant et découpant le réel pour donner à voir son expérience du monde où les temps de pose se comptent parfois en heures… « Mon travail se veut invitation à nous réapproprier notre propre regard, loin de ceux-là programmés et standardisés qui nous privent de l’expérience du monde et en abolissent même le désir. Pour que chacun puisse se dire : moi-aussi, j’ai pouvoir de repeindre le monde en couleurs ! » Yonnel Liégeois
Un étonnant voyage aujourd’hui dans le paysage urbain de la ville de Sevran (93), hier de surprenants paysages industriels colorés ou de fantomatiques hommes en fuite vers un ailleurs, Michel Séméniako transfigure la réalité au moyen de ses multiples faisceaux lumineux projetés sur tel ou tel élément, au gré de ses torches graphiques et de son imaginaire. Tel un peintre réinventant et découpant le réel pour donner à voir son expérience du monde où les temps de pose se comptent parfois en heures… « Mon travail se veut invitation à nous réapproprier notre propre regard, loin de ceux-là programmés et standardisés qui nous privent de l’expérience du monde et en abolissent même le désir. Pour que chacun puisse se dire : moi-aussi, j’ai pouvoir de repeindre le monde en couleurs ! » Yonnel Liégeois