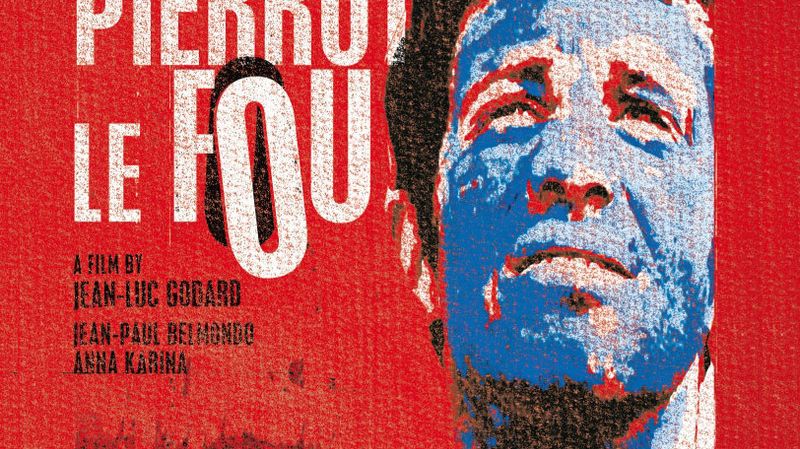Homme de radio au métier sûr, critique dramatique, Lucien Attoun est mort à Paris le 28 avril. Les deux grandes passions de sa vie ? La radio avec France Culture et la création de Théâtre Ouvert avec son épouse Micheline. Le théâtre de service public lui doit beaucoup.
Lucien Attoun vient de s’éteindre à l’âge de 88 ans, le 28 avril à Paris. J’en éprouve du chagrin. Lucien, je l’ai connu, fréquenté, apprécié depuis un demi-siècle au bas mot. Le théâtre de service public lui doit une fière chandelle et France Culture, en la matière, se devrait, en bonne logique, d’afficher à son égard une gratitude éperdue.

L’amour du théâtre, il le tient de son père, comédien et chanteur populaire en Tunisie, où Lucien naît en 1935 à la Goulette, au nord de Tunis. Il débarque en France en 1947, avec sa sœur cadette et sa mère. A 12 ans, pensionnaire au lycée Maimonide de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), il y croise Micheline Malignac, qui n’a qu’un an de moins que lui. Ils ignorent alors qu’ils se marieront en 1963 et qu’on leur devra cette magnifique aventure vécue en commun, Théâtre Ouvert, qui fera tant pour l’écriture dramatique dans notre pays, mais n’anticipons pas.
Lucien a 16 ans quand meurt sa mère. Elle lui avait dit : « Veille sur ta sœur ». Jeune homme de devoir, il cumule les « petits boulots » sans perdre de vue le champ culturel. En 1958, il fait partie du Groupe de théâtre antique de la Sorbonne. La même année, il devient secrétaire général puis président du cercle international de la jeune critique, fondé sous l’égide du fameux Théâtre des Nations. Il enseigne dix ans dans un collège de Lyon, est nommé adjoint au directeur chargé de l’animation culturelle à HEC, de 1956 à 1969. Critique dramatique, il publie dans la revue Europe, puis aux Nouvelles littéraires, à Témoignage chrétien, à la Quinzaine littéraire…

Son exceptionnelle carrière d’homme de radio s’ouvre en 1967, lorsqu’il est embauché à France Culture, en qualité de chroniqueur, dans la Matinée du théâtre, rebaptisée la Matinée des arts du spectacle. Il est producteur des Heures de culture française, plus tard devenues les Chemins de la connaissance, et d’Une Semaine à Paris. De 1969 à 2002, Lucien Attoun crée et produit, toujours sur France Culture, le Nouveau répertoire dramatique, une série d’émissions d’une importance capitale (la première pièce de Koltès, l’Héritage et l’Ignorant et le fou, de Thomas Bernhard, entre autres, y sont diffusées). A son actif encore, les collections Radiodrame et Cycle de fiction. Son activité de production sur les ondes ne laisse pas d’être impressionnante. Récapitulons : On commence (1965-1997), Mégaphonie (1984-1997), Profession spectateur (1997-2002) et Passage du témoin (2002-2004). Il a été conseiller artistique de Giorgio Strehler, quand celui-ci dirigeait l’Odéon-Théâtre de l’Europe.

La grande affaire de la vie de Micheline et Lucien Attoun, ce sera l’invention de Théâtre Ouvert, à la suite naturelle, pour ainsi dire, de leur vif intérêt pour les auteurs vivants. En 1970, Lucien crée chez Stock la collection Théâtre Ouvert, justement. L’été 1971 à Avignon, peu avant la disparition de Vilar, Lucien lui fait remarquer que la création contemporaine n’a pas droit de cité au festival. Vilar met alors Lucien au défi de joindre le geste à la parole. C’est d’emblée le succès dans la Chapelle des Pénitents-Blancs, haut-lieu soudain de « mises en espace » (douze jours de répétition) et du »gueuloir« où se profèrent des textes neufs.
En 1981, Théâtre Ouvert s’installe au Jardin d’Hiver, passage Véron, à côté du Moulin Rouge, dans le XVIIIe arrondissement de Paris, dans un immeuble hanté par les souvenirs poétiques de Valentin-le Désossé, Jacques Prévert et Boris Vian. En 1988, Théâtre Ouvert, ayant à la boutonnière la révélation d’une multitude de pièces d’auteurs vivants (les moindres n’étant pas Koltès et Lagarce), obtient le statut, ô combien mérité, de Centre dramatique national de création. Jean-Pierre Léonardini