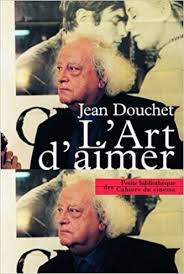Formé à l’école du spectacle, ancien régisseur, Hervé Audibert est un homme illuminé à bien des égards ! Créateur de son métier, il se déclare architecte des lumières. Qui éclaire, jusqu’au 29/12 sur la scène du Rond-Point (75), Perdre le nord, le spectacle de Marie Payen.
Cheveux grisonnants, sourire accueillant, l’homme s’épanche avec gourmandise. Fort de ses convictions, exigeant envers lui-même, Hervé Audibert rêve tout haut le beau et le juste, croit en une humanité solidaire et éclairée. Une utopie en actes qu’il fait sienne, n’hésitant point à déménager sa petite entreprise, de banlieue à Paris, pour faciliter la vie au quotidien de ses salariés…

« Un homme des lumières », aurait-on pu dire de lui au XVIIIème siècle !
Le Centquatre à Paris, le front de mer de Marseille, le pavillon de la France à la Biennale de Venise, le Musée national d’Estonie, les théâtres de Saint-Nazaire et de Sénart… De l’hexagone en terre étrangère, nombreuses et prestigieuses sont les créations architecturales qui scintillent sous les feux de l’atelier Audibert. L’homme n’en a point perdu pour autant sa modestie naturelle, préférant jouer le jeu de l’équipe plutôt que la mise en avant de la consécration individuelle. Un poète à sa façon qui, par ses jeux de lumière, invite le public, visiteur ou spectateur, à libérer son imagination, à laisser libre cours à son œil et à son intelligence, à devenir à son tour créateur de son espace. Sur le site Chroniques

Le musée national d’Estonie
d’architecture, Christophe Leray tire un joli portrait du personnage.
Durant trente ans, Hervé Audibert a bourlingué de scène en scène, d’Avignon en théâtres de province, de Paris à d’autres capitales européennes. En compagnie de quelques grands, André Engel, Jean-Pierre Vincent ou Patrice Chéreau… Le jeune homme réussit en 1976 le concours d’entrée à l’École supérieure d’art dramatique du TNS, le Théâtre national de Strasbourg, section régisseur, « la pantoufle de l’acteur » selon le bon mot de Louis Jouvet. « Une formation très large et éclectique, en rapport avec tous les métiers de la scène (couture, décor, lumière, son), chaque trimestre la promo montait un spectacle », se souvient Hervé. Pour ensuite mettre en œuvre sa formation au côté d’André Diot, aussi chef-opérateur cinéma. Et de stagiaire devenir son assistant, découvrir véritablement le travail d’éclairagiste plateau… Son souvenir le plus marquant ? Un Prométhée porte-feu dans une mise en scène d’André Engel d’après Eschyle, donné une seule fois au cours du Festival de Nancy dans un carreau de mine désaffecté. « J’ai alors fait une plongée extraordinaire dans le monde culturel, c’est à ce moment-là aussi que j’ai vraiment eu envie de faire de la lumière », se rappelle-t-il. Avec en tête l’expérience et les convictions de maître Chéreau, considérant la lumière comme un moyen d’expression au même titre qu’un décor, qu’un acteur… Pas simple pourtant en ces années-là de s’imposer dans cette voie, de

Le théâtre de Sénart
faire sa place en tant que créateur à part entière face aux « ego » des planches ! Progressivement, il y parvient.
Une reconversion qu’il réussit aussi, en 1996, dans le monde de l’architecture. Lassé des tournées théâtrales, usé et fatigué, il jette le gant au pied du rideau rouge. Pour se lancer un nouveau défi, inventeur et initiateur d’un nouveau métier, architecte des lumières… Pas simple encore une fois, l’esprit de troupe qui régit l’aventure théâtrale n’existe pas ou peu dans le monde de l’architecture. Le maître d’œuvre se considère souvent seul à bord, les autres corps de métier n’ont qu’à suivre ou s’adapter à ses desiderata : pas vraiment la manière de voir et de penser du sieur Audibert ! Qui se vit et se veut créateur de plein droit, en étroite collaboration avec le concepteur. Ses premiers pas en pleine lumière, il les fera en compagnie de l’architecte du Théâtre de La Colline, Alberto Cattagni. Qui lui confie la lumière du cinéma UGC Saint-Eustache, près des Halles parisiennes. Un bleu d’une intense poésie, la lumière perçue comme un art, non un banal éclairage. Suivront de multiples créations, aussi expressives et lumineuses les unes que les autres, dont les photographies qui illustrent cet article tentent d’exposer la quintessence. Des bâtiments, des espaces qui parlent et font parler, qui deviennent objets poétiques et ravissent l’œil du contemplateur pour l’ouvrir à d’autres horizons… Un travail artistique couronné en 2004 du Goncourt de l’architecture, la prestigieuse Équerre

Le centre national de la danse, Pantin
d’argent pour la mise en lumières du Centre national de la danse de Pantin !
La lumière ? Pas cet obscur objet du désir, et pourtant une recherche, un pas de côté à la Buñuel pour Hervé Audibert… Pour lui, il ne s’agit pas seulement d’habiller l’œuvre de l’architecte de moult leeds et projecteurs plus sophistiqués les uns que les autres, il importe avant tout de lui donner vie autrement, de faire sens. De donner à voir par un regard décalé ce qu’elle recèle encore d’étrange, de mystérieux dans ou hors ses entrailles. Par son travail, « rendre la frontière entre extérieur et intérieur, entre la scène et l’urbain, de plus en plus floue et ténue », commente notre confrère Christophe Leray. Et Audibert l’illuminé d’ajouter, « nous sommes parfois sollicités par des gens très dirigistes, qui ont des idées très précises sur ce qu’ils veulent. Dans cette relation, nous apportons un savoir-faire, une approche de la lumière qui n’est pas forcément en rapport avec l’idée qu’ils s’en font. D’un autre côté, il faut comprendre le désir de l’architecte – c’est lui le metteur en scène – et à partir de là apporter des idées supplémentaires, complémentaires, et établir un dialogue. L’abstraction architecturale permet l’expression de la lumière et les

La cité de la mer, Cherbourg
architectes qui m’attirent sont ceux où je vois dans les projets une place possible pour la lumière ».
L’homme n’en abandonne pas pour autant ses amours premières. Qui éclaire toujours, au gré de ses envies et désirs, lieux et scènes. L’exposition David Bowie à la Philharmonie de Paris, celle sur les Dogons au Musée du Quai Branly… Des spectacles aussi, à l’opéra de Bordeaux ou de Lausanne, au Théâtre des Amandiers et de La Colline, aujourd’hui Marie Payen qui « perd le nord » au Théâtre du Rond-Point. Une danse solitaire et poétique, émouvante et tragique. Boulevard de la Chapelle, à Paris, la comédienne a rencontré des déclassés, des exilés, hommes-femmes-enfants. Elle a fait siens leurs mots pour faire entendre les paroles qui l’ont bouleversée. Un projet artistique qui touche au cœur Hervé Audibert. Lui qui, avec sa compagne, soutient les migrants sous de multiples formes. Une vie de citoyen, là-aussi, joliment éclairée par un esprit de solidarité sans faille. Une conscience atterrée par l’à-venir de notre planète où ressources et êtres humains sont sacrifiés sur l’autel de la rentabilité, une conscience pourtant lumineuse qui ose encore croire en de possibles lendemains qui brillent. Yonnel Liégeois
Marie Payen, à corps perdu
La presse est unanime. Avec Perdre le nord, jusqu’au 29/12 sur les planches du Rond-Point, Marie Payen fait plus qu’œuvre spectaculaire, telle la tragédie antique une authentique « épopée du dire » où les mots prennent corps sur la scène. Un voile plastique qui enrubanne la comédienne, trois cercles lumineux au sol pour distiller une hypothétique éclaircie au cœur de ces cris de détresse,  un original et dramatique « objet théâtral non identifiable » selon le propos d’Hervé Audibert…
un original et dramatique « objet théâtral non identifiable » selon le propos d’Hervé Audibert…
« Faire entendre l’odyssée des réfugiés en tournant le dos au réalisme et en gagnant les hauteurs du mythe », écrit Gérard Naly dans La Vie, sur les planches « résonnent la voix du Nord et la voix du Sud avec la force du poème, un moment juste et rare ». Et Jean-Pierre Thibaudat de préciser sur le site de Mediapart, « quand s’est constitué dans le nord de Paris le premier campement d’émigrés, de réfugiés, Marie Payen y est allée. Elle a rencontré des êtres venus d’Afghanistan, de l’Érythrée, d’autres pays. Elle s’est faufilée dans leurs langues, des bribes de mots qui sonnent loin, tressées d’ailleurs, nouées d’exil que son corps enveloppe et fait danser ». En compagnie et sur la musique de Jean-Damien Ratel. « La voici, surgissant dans une invraisemblable robe de mariée en plastique transparent, prête à perdre le nord pour rencontrer ces exilés du sud fuyant guerre, horreur et misère », souligne Thierry Voisin dans Télérama, « Ils s’appellent Abdou, Fawad, Haben et Mouheydin, vivent dans la rue ou dans des camps de fortune. Marie Payen a recueilli leurs récits, qu’elle porte aujourd’hui comme une seconde peau. Et les restitue chaque soir de manière différente. « Rien n’est écrit », dit-elle. Tout est spontané, comme une offrande, un tribut à tous ces recalés de l’Europe ». À voir absolument, à ne vraiment pas manquer. Y.L.
 que notre République répressive connaît encore quelques ostentatoires poches critiques ».
que notre République répressive connaît encore quelques ostentatoires poches critiques ».