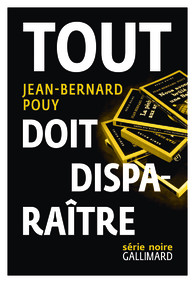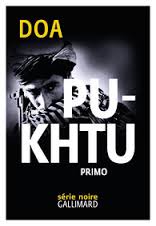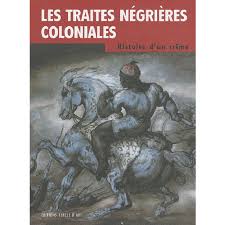Au cœur du Paris populaire du 18ème arrondissement, en 2011 Lucia Iraci a créé « Joséphine », le premier salon de coiffure solidaire. Son combat ? Prendre soin bénévolement des femmes démunies, les aider à retrouver l’estime de soi et le chemin de l’emploi.
Ne nous y trompons pas, l’association « Joséphine pour la beauté des femmes » créée par Lucia Iraci est tout, sauf une entreprise futile ! Il s’agit bien au contraire d’enrayer le mécanisme d’exclusion qui les guette toutes : les femmes sans indemnité et en recherche d’emploi, celles qui sont à la tête d’une famille monoparentale mais écrasées par la charge éducative et les soucis financiers, celles encore qui sont victimes de violences conjugales. Dans une telle situation de précarité, et souvent de solitude, la coquetterie n’est plus à l’ordre du jour. Les séances de coiffeur ou de shopping sont de lointains souvenirs. Pour des raisons financières évidemment, mais pas seulement…
« Je n’ai pas de travail ? A quoi bon me maquiller le matin… Je suis seule avec mes enfants et ne sors jamais ? A quoi bon faire un effort vestimentaire »… Et soudain, le reflet dans la glace interpelle : qui voudrait t’embaucher avec une tête pareille ? Comment veux-tu plaire à un homme, ainsi accoutrée ? Le cercle vicieux de la dévalorisation de soi est enclenché, il est bien difficile d’en sortir seule.  C’est précisément là qu’interviennent les professionnels bénévoles du salon Joséphine en redonnant à ces femmes l’envie de prendre soin d’elles. Pour retrouver une image positive d’elles-mêmes, mieux affronter ainsi les difficultés de tous ordres.
C’est précisément là qu’interviennent les professionnels bénévoles du salon Joséphine en redonnant à ces femmes l’envie de prendre soin d’elles. Pour retrouver une image positive d’elles-mêmes, mieux affronter ainsi les difficultés de tous ordres.
L’investissement social de la belle Lucia est le fruit de toute une histoire. Elle quitte à quinze ans sa Sicile natale pour retrouver sa famille à Paris, apprend la coiffure sur les traces de sa sœur aînée prénommée…Joséphine ! Talentueuse, elle est vite remarquée et collabore pendant vingt ans avec des photographes et couturiers célèbres (Yves Saint-Laurent, Bettina Reims, Peter Lindbergh, etc…). Elle ouvre son propre salon en l’an 2000, crée sa ligne de soins mais en dépit du succès, elle s’avoue insatisfaite, « il manquait une dimension à ma vie ». Partant du constat que 80 % des pauvres sont des femmes, que l’apparence physique et la confiance en soi sont primordiales pour trouver un emploi, elle veut offrir aux plus démunies le moyen de cette reconquête. En 2006, Elle crée l’association « Joséphine pour la beauté des femmes », elle intervient bénévolement dans diverses structures avec le secret désir d’ouvrir un salon social associatif. Las, en butte à de nombreuses difficultés, elle abandonne provisoirement ce projet et décide d’ouvrir son propre salon un lundi par mois aux femmes en grande précarité. Pour son action, elle se voit honorée de la Légion d’honneur en 2009.
Deux ans plus tard, avec l’aide de partenaires et de sponsors, se matérialise le projet qui lui tient à cœur : en mars 2011, au cœur du quartier parisien de la Goutte d’Or, s’ouvre le premier salon de beauté social ! La plupart des femmes qui franchissent la porte sont envoyées par des associations partenaires, environ 70 % d’entre elles bénéficient du RSA. Une participation symbolique, 3 €, leur est demandée pour coiffure et maquillage, afin qu’elles se sentent aidées et non pas assistées. Elles peuvent aussi avoir accès à des soins de manucure et d’épilation, ainsi qu’à des séances de sophrologie et de yoga pour celles qui sont dans des situations de stress ou d’angoisse. Leur sont également prodigués des conseils de santé.  Chaque cliente est reçue individuellement, en entretien privé et confidentiel, pour évaluer ses besoins prioritaires. Les premières années, ce fut Koura, belle jeune femme souriante qui y veillait, forte de son expérience comme coordinatrice de centre d’urgence du Samu social. C’est lors d’un projet pour les femmes de la rue, cherchant une coiffeuse bénévole, qu’elle croisa le chemin de Lucia… Depuis, d’autres ont pris le relais du sourire. En revanche Mehdi, qui participa à l’aventure dès le début, est toujours à ses ciseaux, prêt à rendre belles celles qui arrivent le visage chiffonné par la vie. Son CAP en poche, il a travaillé comme coiffeur-maquilleur de studio, chez Alexandre également, avant de mettre ses compétences au service du projet « Joséphine ». D’abord bénévole, il est aujourd’hui salarié.
Chaque cliente est reçue individuellement, en entretien privé et confidentiel, pour évaluer ses besoins prioritaires. Les premières années, ce fut Koura, belle jeune femme souriante qui y veillait, forte de son expérience comme coordinatrice de centre d’urgence du Samu social. C’est lors d’un projet pour les femmes de la rue, cherchant une coiffeuse bénévole, qu’elle croisa le chemin de Lucia… Depuis, d’autres ont pris le relais du sourire. En revanche Mehdi, qui participa à l’aventure dès le début, est toujours à ses ciseaux, prêt à rendre belles celles qui arrivent le visage chiffonné par la vie. Son CAP en poche, il a travaillé comme coiffeur-maquilleur de studio, chez Alexandre également, avant de mettre ses compétences au service du projet « Joséphine ». D’abord bénévole, il est aujourd’hui salarié.
La qualité de l’accueil est le point fort de l’initiative, sans doute la clef de son succès. Tous les témoignages recueillis sur place évoquent l’écoute bienveillante, la douceur des professionnels, salariés ou bénévoles, qui assurent les soins dans une ambiance chaleureuse où le rire est monnaie courante. Il n’en faut pas plus, parfois, pour redonner confiance à des femmes qui n’osaient plus se regarder dans le miroir depuis longtemps. « C’est comme si je me retrouvais vingt ans en arrière ! », confie l’une d’elles tandis qu’une autre, victime de harcèlement, l’affirme clairement, « c’est un retour à la dignité pour moi ». Lucia le constate, par les confidences de son équipe, certaines n’osent pas se rendre à un entretien d’embauche parce qu’elles n’ont aucune tenue décente à se mettre, tout simplement. Qu’à cela ne tienne, activant son réseau de partenaires, elle met en place un système de prêt de vêtements, sacs et chaussures. Une sorte de formule « Dress for Success »… !  Tout est proposé pour tenter de faire barrage à l’implacable mécanique de l’exclusion. Les résultats sont là : de janvier à décembre 2012, le Salon Joséphine a reçu 1531 femmes, plus de 300 d’entre elles ont retrouvé un emploi.
Tout est proposé pour tenter de faire barrage à l’implacable mécanique de l’exclusion. Les résultats sont là : de janvier à décembre 2012, le Salon Joséphine a reçu 1531 femmes, plus de 300 d’entre elles ont retrouvé un emploi.
Il n’en fallait pas plus pour doper l’optimisme de l’infatigable Lucia. Qui ouvre un deuxième salon à Tours, son rêve étant d’étendre le projet à l’échelon national… Pour satisfaire cette ambition, il faut des bras et surtout des compétences, non seulement techniques dans le domaine de la coiffure mais aussi psychologiques à l’écoute et au décryptage des besoins de chaque femme fragilisée par la vie. Lucia veut toujours offrir le meilleur et ne jamais courir le risque d’un service « au rabais », sous prétexte qu’il s’adresse à une population défavorisée.
Elle crée l’École française de coiffure sociale en janvier 2015 à Tours, où elle enseigne elle-même deux jours par semaine. Il s’agit d’apporter aux professionnels, déjà titulaires d’un diplôme de coiffure (CAP ou BP), une formation certifiante théorique et pratique. Y sont abordés différents domaines : psychologie, sociologie et médecine (dermatologie, cancérologie et psychiatrie). En ligne de mire, la reconnaissance du titre de coiffeur social au Répertoire national des certifications professionnelles afin que les diplômés puissent également intégrer à terme les équipes pluridisciplinaires des maisons de retraites ou des hôpitaux, là où les besoins sont considérables.
La dernière idée folle, et follement généreuse de l’association, qui confirme sa vocation solidaire, les « Perruques de Joséphine » ! Il s’agit de collecter des perruques auprès de femmes qui ont surmonté leur cancer. L’objectif ? En faire bénéficier d’autres qui n’ont pas les moyens d’en acquérir. Il est sûr que nous entendrons encore longtemps parler de « Lucia, coiffeuse du cœur ». Chantal Langeard