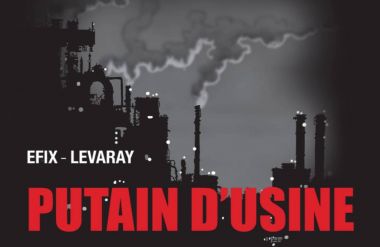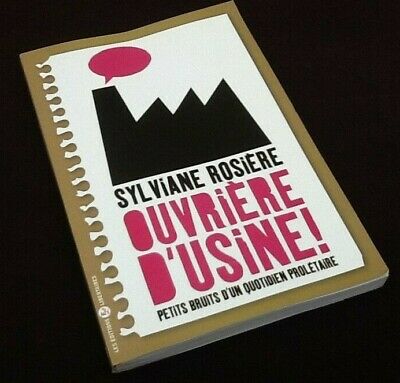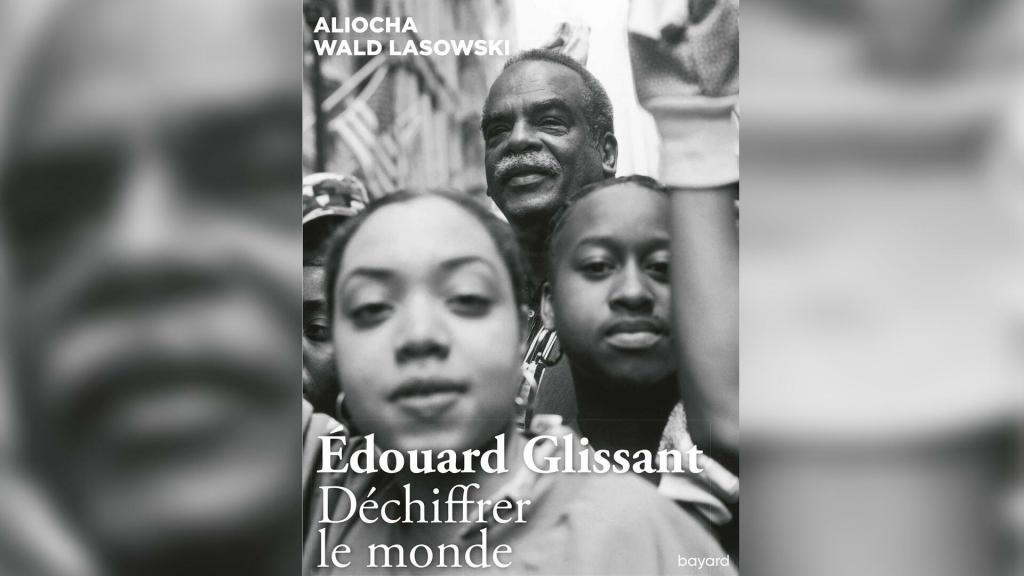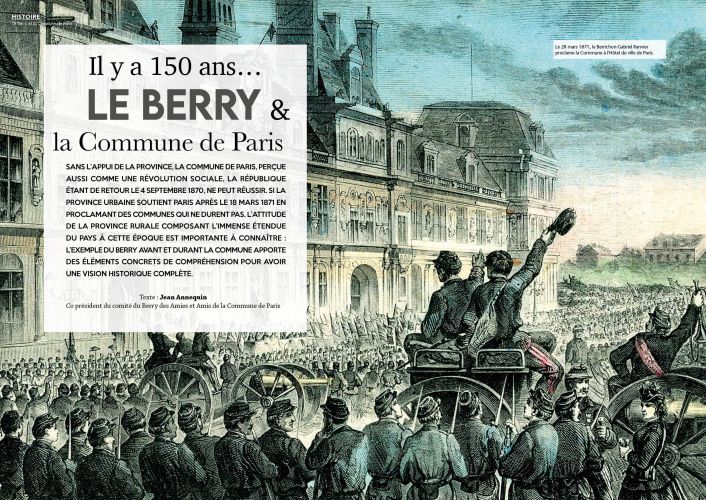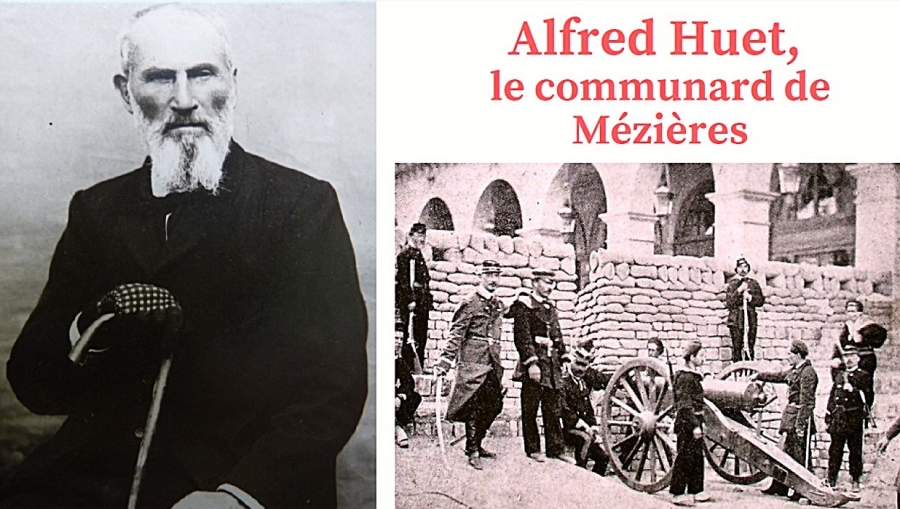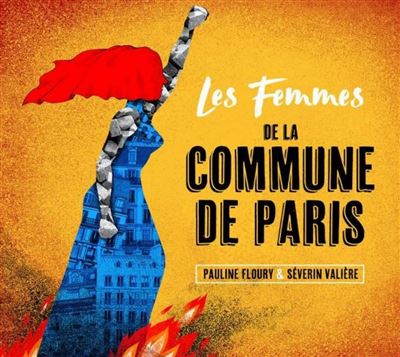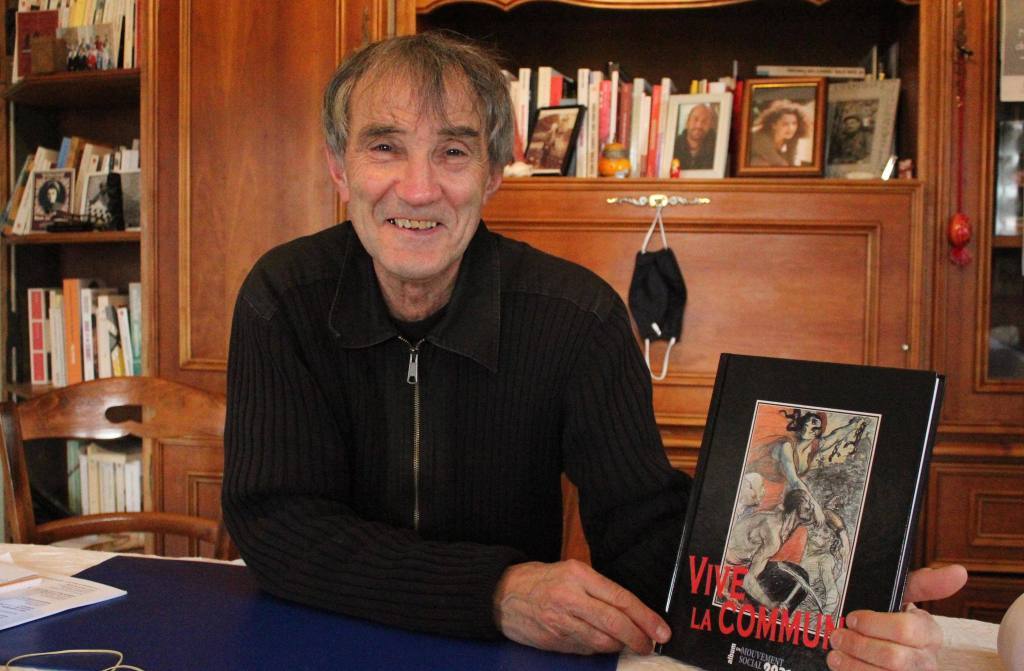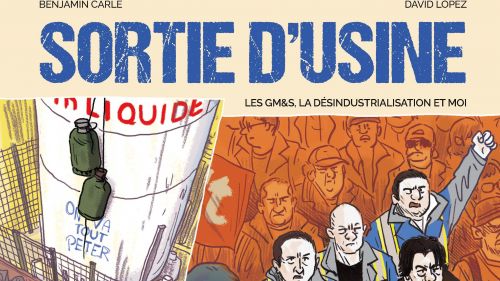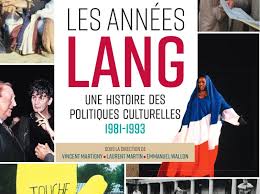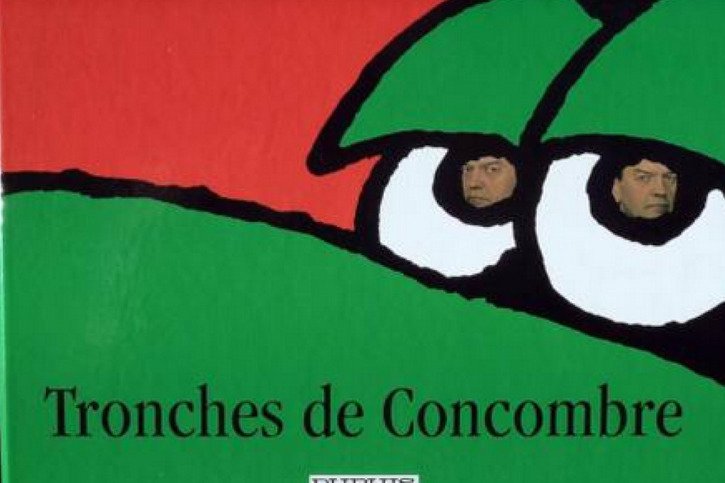Membre de la Société française de neurologie et de l’Académie des sciences de New York, Pierre Lemarquis a publié Les Pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes. Depuis trente ans, le neurologue travaille sur les relations entre cerveau et musique.

Régis Frutier – Vous êtes connu pour votre livre Sérénade pour un cerveau musicien. Pouvez-vous nous décrire votre parcours et vos travaux ?
Pierre Lemarquis – Au départ, j’étais organiste, pianiste et je m’amusais à collectionner, en tant que médecin puis neurologue, des articles qui traitaient du cerveau et de la musique. Il y a trente ans de cela, ce champ de recherche était embryonnaire. J’ai eu la chance de rencontrer Boris Cyrulnik qui m’a cédé ses activités en clinique à l’hôpital de Toulon. Lorsqu’il a monté son diplôme d’éthologie, il m’a recruté pour faire musique, résilience et vieillissement : à cette époque, on ne savait pas que la musique faisait du bien aux gens qui vieillissent et à ceux qui souffrent d’Alzheimer.

R.F. – Et c’est donc allé au-delà de la musique…
P.L. – Si ça marchait bien avec la musique, alors pourquoi pas avec les peintures ? C’est comme cela que j’ai écrit mon premier livre Sérénade pour un cerveau musicien. Après, il y a eu le Portrait du cerveau en artiste qui concerne les arts visuels. J’y développe la notion d’empathie esthétique : comment on peut entrer dans une œuvre d’art et comment elle entre en nous. C’est l’idée que notre cerveau, lorsqu’il est face à une œuvre d’art, se comporte comme s’il était face à quelqu’un de vivant. Devant la Joconde, notre cerveau fonctionne comme si nous étions devant Mona Lisa. Lorsque vous écoutez une musique, vous activez les neurones qui cherchent le sens de ce qu’elle veut vous dire. Ce sont des artéfacts, mais vécus comme du biologique par notre cerveau. C’est une merveille pour notre vie. Une musique peut nous faire autant de bien qu’une rencontre.

R.F. – Médecin, vous vous êtes intéressé à la musique dans les soins…
P.L. – Au début du confinement, les éditions Hazan m’ont demandé d’écrire un livre sur les œuvres d’art ayant un lien avec le soin. Ce fut L’Art qui guérit, de l’homme préhistorique à nos jours ! Dans le même temps, l’O.M.S. a sorti une énorme étude qui regroupe 900 articles médicaux démontrant que l’art fait du bien à la santé : la santé au sens de l’OMS, être bien et heureux et pas seulement exempt de maladie. En même temps, j’ai eu la chance d’être contacté par une psychologue sur Lyon, Laure Mayoud, qui a réussi à faire mettre des tableaux et des photographies dans des services de médecine interne. Il y a là des personnes très malades pour des temps longs. Si elles le souhaitaient, on accrochait l’œuvre d’art qui leur plaisait dans leur chambre. Le changement fut évident : au lieu de parler de leurs perfusions ou de leurs douleurs, elles parlaient de l’œuvre d’art et ce fut bien aussi pour le personnel qui pouvait parler d’autre chose que strictement du soin ! Ces patients, qui ne seraient jamais allés au musée autrement, pensaient que l’art était réservé à une élite et qu’ils en étaient exclus.

R.F. – Dans vos écrits, vous analysez particulièrement sur les effets de la musique sur le cerveau des enfants…
P.L. – Lors des assises de la maternelle, il y a quelques années, Boris Cyrulnik m’avait demandé de m’intéresser à comment les enfants apprennent à parler grâce à la musique. Si vous allez dans un pays dont vous ne connaissez pas la langue, vous allez repérer qu’il y a un rythme, une mélodie. Et petit à petit, vous arrivez au sens. Vous partez du son au sens. Comme nous l’avions fait chez les personnes âgées, ça pouvait être intéressant de voir ce que ça pouvait donner chez les enfants. Cela montre les effets sur la mémoire et la prise de décision, sur les émotions et sur le côté social. De telles expériences peuvent s’extrapoler à plein d’autres choses, telle l’expérience de Gustavo Dudamel, au Venezuela. Ce sont des enfants qui auraient pu sombrer dans la drogue, la violence et qui, grâce au Sistema*, s’en sont sortis. Nous avons eu la même chose en France avec la Philharmonie de Paris : on a donné des instruments à des enfants afin qu’ils puissent jouer et constater leurs progrès sur le plan social et personnel.

R.F. – Dans votre dernier ouvrage, qu’avez-vous voulu démontrer ?
P.L. – Les 200 articles que j’ai lus m’ont servi à constituer le fond scientifique, mais à chaque fois j’essaie de mettre des vignettes, des histoires. C’est comme cela que Claude Thomann** a inséré son beau texte, Louis XV, où il raconte ses débuts avec l’harmonica. Mon idée fondatrice, pour l’écriture des Pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes ? On dit toujours que la musique est en amont du langage. On chante, on danse avant de parler. Lorsque la pensée ruisselle dans notre esprit, c’est quelque chose qui a à voir avec le musical. Il n’y a pas un peuple au monde qui ne fasse pas de musique, ce qui faisait dire à Schopenhauer que nous sommes de la musique incarnée ! On emploie souvent des termes musicaux dans les relations ; on s’accorde, on est sur la même longueur d’onde… Je donne un autre exemple dans le livre, c’est celui des enfants de la DDASS accueillis dans des fermes de la Côte d’Opale, à Boulogne-sur-Mer. Partout il a été mis en place une activité artistique, notamment la musique. En fin d’année scolaire, ils organisent un spectacle musical. Un grand moment : ces enfants perdus, on leur ouvre l’esprit et c’est extraordinaire ! Propos recueillis par Régis Frutier
Les Pouvoirs de la musique sur le cerveau des enfants et des adultes, de Pierre Lemarquis (éd. Odile Jacob, 250 p., 22,90 €).
* El Sistema est une politique du ministère de la Culture du Venezuela qui permet à chaque enfant désireux de jouer de recevoir un instrument et de se voir affecter un tuteur. Pays de 22 millions d’habitants, le Venezuela compte ainsi 500 000 jeunes pratiquant la musique classique au sein de 126 orchestres, ainsi que 36 orchestres symphoniques professionnels, 15 000 professeurs de musique et 136 centres de formation et conservatoires.
** Il s’agit de Claude Thomann, ancien secrétaire de l’union locale CGT de Saint-Ouen (93), bien connu des militants de la Seine-Saint-Denis pour jouer de son harmonica sur les piquets de grève.