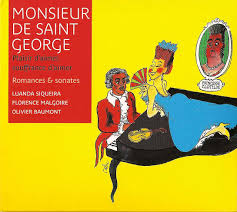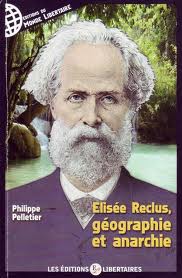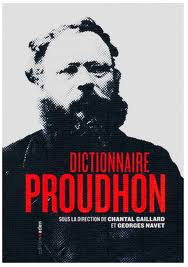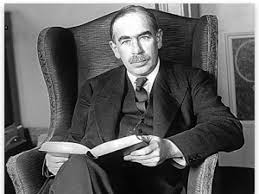Romancière, dramaturge, scénariste et réalisatrice de cinéma, Marguerite Duras n’aura en fait connu qu’une vie, celle de l’écriture. A l’occasion du centième anniversaire de sa naissance, retour sur une figure mythique de la littérature.
Écrire, reprendre, puis réécrire encore le même texte à intervalles réguliers, ou quelques décennies plus tard, sous forme de scénario de film ou de pièce de théâtre… Mieux même, presque renier « L’amant » au succès planétaire pour en proposer en quelque sorte une nouvelle version, « L’amant de la Chine du Nord » : ainsi va la vie pour Marguerite Duras, la vie est un roman, surtout pas un rêve comme elle s’en défendra en permanence, sa propre vie sans cesse revisitée sous sa plume devient elle-même un roman !
 1914 – 1984, deux dates qui ne sont pas seulement balises anodines pour de quelconques anniversaires : celui du centenaire de la naissance de Marguerite Duras, celui du trentenaire de la publication du fameux « Amant »… « Pour certains, ce n’est qu’un visage, pour d’autres ce n’est qu’une voix », écrit Gilles Philippe aux premières lignes de la préface qui ouvre l’édition complète des œuvres de l’auteur d’« Hiroshima mon amour » dans la célèbre collection de la Pléiade, « pour beaucoup ce n’est qu’un titre, « Un barrage contre le Pacifique », par exemple, ou encore « L’amant », presque aux extrémités d’un travail d’écriture qui semble fermer sa propre boucle »… Entre les deux, qu’ils soient dates de référence ou titres d’ouvrages, les faits communs et durablement marquants ? L’Indochine comme décor naturel et fondamental dans l’imaginaire de la future romancière, le poids de la figure de la mère dans l’inconscient de la petite Marguerite née de son vrai nom Donnadieu à Giadinh près de Saïgon, la place des hommes – amants ou amis, compagnons ou mari – autour ou au cœur de son œuvre littéraire, cinématographique ou théâtrale ! Dès sa plus tendre enfance, Marguerite Duras a l’amour des mots, de la nature, des odeurs et de la lumière, telle celle du soleil couchant sur les vagues du Pacifique. Tous ses livres et ses films en témoignent : descriptions concrètes, cadrages naturalistes… L’image ou le mot, chez elle, semblent toujours porteurs d’une matérialité affichée, d’une puissance physique notoire, « La vie matérielle », pour paraphraser le titre de l’un de ses livres, ne lui est assurément point étrangère : Marguerite adore mettre la main à la pâte, qu’il s’agisse de couture, de cuisine ou de composition florale !
1914 – 1984, deux dates qui ne sont pas seulement balises anodines pour de quelconques anniversaires : celui du centenaire de la naissance de Marguerite Duras, celui du trentenaire de la publication du fameux « Amant »… « Pour certains, ce n’est qu’un visage, pour d’autres ce n’est qu’une voix », écrit Gilles Philippe aux premières lignes de la préface qui ouvre l’édition complète des œuvres de l’auteur d’« Hiroshima mon amour » dans la célèbre collection de la Pléiade, « pour beaucoup ce n’est qu’un titre, « Un barrage contre le Pacifique », par exemple, ou encore « L’amant », presque aux extrémités d’un travail d’écriture qui semble fermer sa propre boucle »… Entre les deux, qu’ils soient dates de référence ou titres d’ouvrages, les faits communs et durablement marquants ? L’Indochine comme décor naturel et fondamental dans l’imaginaire de la future romancière, le poids de la figure de la mère dans l’inconscient de la petite Marguerite née de son vrai nom Donnadieu à Giadinh près de Saïgon, la place des hommes – amants ou amis, compagnons ou mari – autour ou au cœur de son œuvre littéraire, cinématographique ou théâtrale ! Dès sa plus tendre enfance, Marguerite Duras a l’amour des mots, de la nature, des odeurs et de la lumière, telle celle du soleil couchant sur les vagues du Pacifique. Tous ses livres et ses films en témoignent : descriptions concrètes, cadrages naturalistes… L’image ou le mot, chez elle, semblent toujours porteurs d’une matérialité affichée, d’une puissance physique notoire, « La vie matérielle », pour paraphraser le titre de l’un de ses livres, ne lui est assurément point étrangère : Marguerite adore mettre la main à la pâte, qu’il s’agisse de couture, de cuisine ou de composition florale !
 Mieux encore, l’enfant sait ce que veut dire une enfance pauvre, à défaut d’être misérable. En Indochine, la famille Donnadieu ne compte pas parmi l’aristocratie des colons, même si elle se doit de la fréquenter et de présenter bonne figure : le père est directeur d’école, la mère institutrice… La gamine n’a que sept ans, lorsque le chef de famille décède. La mère, outre son métier d’enseignante, achète une concession. Flouée par l’administration coloniale : il s’avère impossible d’y planter quoi que ce soit, l’océan balaie tout de sa puissance tumultueuse en dépit de la construction d’un hypothétique barrage, sans cesse rompu et rebâti jusqu’à la ruine de sa propriétaire… Pour survivre, le fameux amant rencontré sur le bac qui monnaie ses faveurs, avec le consentement de la mère et du grand frère malgré les insultes et les coups : fiction ou réalité ? « L’historien s’y perd. Le public un peu averti ne se fie à rien. Il apprécie. Ou pas », souligne Christiane Blot-Labarrère, l’auteure de l’album Duras nouvellement paru lui-aussi à la Pléiade et collaboratrice à l’édition des Œuvres Complètes, « sans trêve, l’écrivain réinvente ses routes. Pouvoir d’un style dans lequel ni l’émotion ni la folle du logis ne font défaut ». Souvenirs, souvenirs de ce pays natal, patrie d’eaux, « J’ai des souvenirs… ah ! Plus beaux que tout ce que je pourrai jamais écrire », confesse Marguerite Duras… De souvenir en souvenir, de livre en livre, de film en film, du « Barrage contre le Pacifique » qui ne scellera pas la réconciliation entre la mère et la fille à « L’amant » et son double, il en ira souvent ainsi : des écrits sans cesse revisités, remodelés, réinterprétés par la plume ou sous une autre forme, cinématographique ou théâtrale.
Mieux encore, l’enfant sait ce que veut dire une enfance pauvre, à défaut d’être misérable. En Indochine, la famille Donnadieu ne compte pas parmi l’aristocratie des colons, même si elle se doit de la fréquenter et de présenter bonne figure : le père est directeur d’école, la mère institutrice… La gamine n’a que sept ans, lorsque le chef de famille décède. La mère, outre son métier d’enseignante, achète une concession. Flouée par l’administration coloniale : il s’avère impossible d’y planter quoi que ce soit, l’océan balaie tout de sa puissance tumultueuse en dépit de la construction d’un hypothétique barrage, sans cesse rompu et rebâti jusqu’à la ruine de sa propriétaire… Pour survivre, le fameux amant rencontré sur le bac qui monnaie ses faveurs, avec le consentement de la mère et du grand frère malgré les insultes et les coups : fiction ou réalité ? « L’historien s’y perd. Le public un peu averti ne se fie à rien. Il apprécie. Ou pas », souligne Christiane Blot-Labarrère, l’auteure de l’album Duras nouvellement paru lui-aussi à la Pléiade et collaboratrice à l’édition des Œuvres Complètes, « sans trêve, l’écrivain réinvente ses routes. Pouvoir d’un style dans lequel ni l’émotion ni la folle du logis ne font défaut ». Souvenirs, souvenirs de ce pays natal, patrie d’eaux, « J’ai des souvenirs… ah ! Plus beaux que tout ce que je pourrai jamais écrire », confesse Marguerite Duras… De souvenir en souvenir, de livre en livre, de film en film, du « Barrage contre le Pacifique » qui ne scellera pas la réconciliation entre la mère et la fille à « L’amant » et son double, il en ira souvent ainsi : des écrits sans cesse revisités, remodelés, réinterprétés par la plume ou sous une autre forme, cinématographique ou théâtrale.
Au début des années 30, elle débarque à Paris, à Vanves plus précisément… Pour suivre des études de droit et décrocher en 1937 un diplôme d’études supérieures en économie politique ainsi qu’un autre en droit public ! La jeune femme n’en tire gloire en dépit de sa réussite dans un milieu universitaire essentiellement masculin, son rêve est ailleurs, même si elle a toujours eu le mot en horreur, – « Le mot dont j’ai le plus horreur dans la langue française et, je pense, dans toutes les langues, c’est le mot rêve… Parce que c’est le grand alibi, le rêve, de la pensée » -, son ambition plutôt : écrire ! L’opportunité lui en est offerte en 37, lorsqu’elle entre comme auxiliaire au Comité de propagande de la banane française dans le cabinet de Georges Mandel, alors ministre des Colonies. En 1940, sort chez Gallimard « L’empire colonial » coécrit par Philippe Roques et Marguerite Donnadieu. Un livre bien dans le ton de l’époque à la gloire de la Mère Patrie qui « a appliqué dans ses colonies tout ce qu’elle tenait à la disposition de l’humanité », le seul livre d’ailleurs signé de son patronyme. Tous les autres le seront de celui de Duras, le nom d’un gros bourg du Lot-et-Garonne près duquel s’est éteint son père. Un livre qu’elle reniera plus tard, il n’empêche, la plume est trempée, plus jamais elle ne s’asséchera… Dans la biographie que Laure Adler lui a consacrée, le lecteur découvre avec ravissement ses petits bonheurs et grands malheurs de néophyte en écriture, écartelée entre les avis littéraires contradictoires de son mari et de son amant qui lui reprochent un style copié sur les auteurs américains alors à la mode, Hemingway et consorts ! Deux hommes qui s’apprécient et qui compteront durablement tout au long de sa vie, Robert Antelme et Dionys Mascolo, même après son divorce d’avec le premier et sa rupture avec le second, père de son fils Jean… Elle intrigue, plaide sa cause auprès du cher Gaston, rien n’y fait et Gallimard refuse le manuscrit. Qu’importe, elle se satisfait de l’avis de Queneau alors grand ordonnateur chez le prestigieux éditeur, « écrivez, ne faîtes que ça », en 1943 paraît chez Plon le roman « Les impudents ».
 A la libération, c’est la consternation avec la découverte, concrète, des camps de la mort. Surtout avec le retour de Robert Antelme qui survécut à Dachau, un mort vivant… De son expérience, quelques années plus tard, il en fera un livre bouleversant, « L’espèce humaine », tragique et intense témoignage sur ce que fut la barbarie orchestrée par les nazis… L’un et l’autre étaient engagés dans la Résistance, membres du réseau de François Mitterrand, le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Un engagement qui scellera la complicité entre l’écrivain et le futur président de la République ! « En 1944, son sens de l’injustice sociale la pousse à adhérer au Parti communiste français », rappelle Christiane Blot-Labarrère. Membre de la cellule Saint-Germain-des-Prés, un joli quartier pour des « cocos » ( !), elle participe à toutes les réunions et manifestations, vend l’Huma au porte à porte, y entraîne mari et amant, et même… sa concierge d’immeuble, la seule prolo du quartier ! L’idylle ne fera pas long feu, du trio elle est la première à être exclue six ans plus tard, en 1950, en raison de sa manière de vivre et de désaccords politiques. L’amertume pointe, « quand ils m’ont exclue, c’était une tentative d’assassinat ». Pourtant, elle n’en démord pas, « je sais qu’il n’y a pas d’autre voie que le communisme », confesse-t-elle bien des décennies après l’événement. Et en 1960, elle sera toujours aussi combative contre la guerre d’Algérie, faisant partie des signataires du Manifeste des 121. A la barre du procès du réseau Janson, sa déposition est nette : « A combien de morts estimera-t-on que le peuple algérien a bien fait la preuve qu’il veut être libre ? ». Et l’on retrouvera Duras au rendez-vous de mai 68, à celui de mai 81…
A la libération, c’est la consternation avec la découverte, concrète, des camps de la mort. Surtout avec le retour de Robert Antelme qui survécut à Dachau, un mort vivant… De son expérience, quelques années plus tard, il en fera un livre bouleversant, « L’espèce humaine », tragique et intense témoignage sur ce que fut la barbarie orchestrée par les nazis… L’un et l’autre étaient engagés dans la Résistance, membres du réseau de François Mitterrand, le Mouvement national des prisonniers de guerre et déportés. Un engagement qui scellera la complicité entre l’écrivain et le futur président de la République ! « En 1944, son sens de l’injustice sociale la pousse à adhérer au Parti communiste français », rappelle Christiane Blot-Labarrère. Membre de la cellule Saint-Germain-des-Prés, un joli quartier pour des « cocos » ( !), elle participe à toutes les réunions et manifestations, vend l’Huma au porte à porte, y entraîne mari et amant, et même… sa concierge d’immeuble, la seule prolo du quartier ! L’idylle ne fera pas long feu, du trio elle est la première à être exclue six ans plus tard, en 1950, en raison de sa manière de vivre et de désaccords politiques. L’amertume pointe, « quand ils m’ont exclue, c’était une tentative d’assassinat ». Pourtant, elle n’en démord pas, « je sais qu’il n’y a pas d’autre voie que le communisme », confesse-t-elle bien des décennies après l’événement. Et en 1960, elle sera toujours aussi combative contre la guerre d’Algérie, faisant partie des signataires du Manifeste des 121. A la barre du procès du réseau Janson, sa déposition est nette : « A combien de morts estimera-t-on que le peuple algérien a bien fait la preuve qu’il veut être libre ? ». Et l’on retrouvera Duras au rendez-vous de mai 68, à celui de mai 81…
 Roman, roman, vous avez dit roman ? Peut-être pour « Les impudents » le premier, qu’elle jugera manqué et dont elle s’opposera à la réédition jusqu’en 1992, mais pour le reste de son œuvre ? Marguerite Duras a toujours violemment refusé qu’on l’affuble du vocable de romancière ! « C’est le mot d’« écrivain » que Marguerite Duras a le plus volontiers utilisé pour parler d’elle-même », souligne Gilles Philippe, enseignant de stylistique à la Sorbonne. Et de poursuivre : « Écrivain de romans, concédera-t-elle un jour. Mais qu’on ne s’y trompe pas : « écrivain » n’est pas pour Duras un mot ouvert. Il ne recouvre pas, de façon commode, toute une série d’activités : on n’écrit pas des livres comme on écrit pour le théâtre ou pour le cinéma, encore moins pour les journaux. Car être « écrivain » pour Duras, c’est bien écrire des « livres ». Et pas n’importe où, exclusivement à sa table de travail, aurait ajouté l’auteur d’« Hiroshima mon amour », le film réalisé par Alain Resnais et le premier scénario à être publié, et du « Square », une pièce de théâtre qui fut d’abord un livre… « Si « roman » figure sous le titre, c’est par étourderie de ma part, j’ai oublié de signaler qu’il fallait l’enlever », déclare Marguerite Duras dans un entretien à L’Express en 1956, « et puis des critiques ont dit qu’il s’agissait là de théâtre, qu’il ne fallait pas s’y tromper »… Naïveté feinte, cabotinage de gens de plume ? Non, à cette date, sincérité oblige, la notoriété n’a pas encore cédé la place à la célébrité, Duras n’est pas encore devenue la Duras qui parle d’elle-même à la troisième personne…
Roman, roman, vous avez dit roman ? Peut-être pour « Les impudents » le premier, qu’elle jugera manqué et dont elle s’opposera à la réédition jusqu’en 1992, mais pour le reste de son œuvre ? Marguerite Duras a toujours violemment refusé qu’on l’affuble du vocable de romancière ! « C’est le mot d’« écrivain » que Marguerite Duras a le plus volontiers utilisé pour parler d’elle-même », souligne Gilles Philippe, enseignant de stylistique à la Sorbonne. Et de poursuivre : « Écrivain de romans, concédera-t-elle un jour. Mais qu’on ne s’y trompe pas : « écrivain » n’est pas pour Duras un mot ouvert. Il ne recouvre pas, de façon commode, toute une série d’activités : on n’écrit pas des livres comme on écrit pour le théâtre ou pour le cinéma, encore moins pour les journaux. Car être « écrivain » pour Duras, c’est bien écrire des « livres ». Et pas n’importe où, exclusivement à sa table de travail, aurait ajouté l’auteur d’« Hiroshima mon amour », le film réalisé par Alain Resnais et le premier scénario à être publié, et du « Square », une pièce de théâtre qui fut d’abord un livre… « Si « roman » figure sous le titre, c’est par étourderie de ma part, j’ai oublié de signaler qu’il fallait l’enlever », déclare Marguerite Duras dans un entretien à L’Express en 1956, « et puis des critiques ont dit qu’il s’agissait là de théâtre, qu’il ne fallait pas s’y tromper »… Naïveté feinte, cabotinage de gens de plume ? Non, à cette date, sincérité oblige, la notoriété n’a pas encore cédé la place à la célébrité, Duras n’est pas encore devenue la Duras qui parle d’elle-même à la troisième personne…
Pour s’en convaincre, il suffit au lecteur de plonger dans « Le livre dit, entretiens de Duras filme » ! Rassemblés et présentés par Joëlle Pagès-Pindon, agrégée de lettres classiques et collaboratrice à l’édition de la Pléiade, des entretiens jubilatoires datant de 1981 et jusqu’alors inédits, où Duras s’exprime librement sur son travail, l’écriture, le théâtre, le cinéma… « Être écrivain, c’est une fonction comme… C’est aussi dangereux que d’être un promoteur immobilier, un député… je suis un écrivain parce que ça me plaît. Tout d’un coup, un matin, j’aime bien aller sur la plage, comme ça, sortir, tu vois – oui, aimer même tu vois. C’est ça, être un écrivain ». Et la spécialiste de commenter ces entretiens en des termes fort puissants et justes au fil de sa préface à l’ouvrage : « Péremptoire et fragile, provocante et attendrissante, séduisante et irritante, Marguerite Duras irradie d’intelligence, vouée toute entière à l’exigence qui la constitue : écrire – par le texte, par l’image, par la voix ».
 Les mots sont lâchés : texte, image voix ! Duras n’aura fait qu’une seule et même chose durant toute sa vie, qu’elle soit à la plume ou à la caméra : écrire, écrire encore et toujours… Tout le reste n’est qu’anecdote, parfois sulfureuse tel son article dans le journal Libération en 1985 à propos de l’affaire Villemin, tantôt narcissique pour le rejet de « L’amant », le livre comme le film de Jean-Jacques Annaud, qui lui valut pourtant le Prix Goncourt en 1984 et une reconnaissance internationale alors qu’elle l’avait raté de peu en 1950 pour « Un barrage contre le Pacifique » ! Yonnel Liégeois
Les mots sont lâchés : texte, image voix ! Duras n’aura fait qu’une seule et même chose durant toute sa vie, qu’elle soit à la plume ou à la caméra : écrire, écrire encore et toujours… Tout le reste n’est qu’anecdote, parfois sulfureuse tel son article dans le journal Libération en 1985 à propos de l’affaire Villemin, tantôt narcissique pour le rejet de « L’amant », le livre comme le film de Jean-Jacques Annaud, qui lui valut pourtant le Prix Goncourt en 1984 et une reconnaissance internationale alors qu’elle l’avait raté de peu en 1950 pour « Un barrage contre le Pacifique » ! Yonnel Liégeois
En savoir plus :
– « Marguerite Duras », par Laure Adler. Une magistrale et imposante biographie, Prix Femina Essai en 1998. Une somme écrite avec autant d’amour que de justesse (Folio Gallimard, 950 p., 12€30).
– « Marguerite Duras, l’écriture de la passion », par Laetitia Cénac. Un superbe album, entre texte et photos, qui dévoile l’écrivain engagé dans les combats de son temps (Ed. La Martinière, 224 p., 32€).
Duras en son théâtre
Un double événement au Théâtre de l’Atelier : à l’affiche chaque soir, deux des plus belles pièces de Marguerite Duras mises en scène par Didier Bezace, l’ancien directeur du Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, « Le square » et « Savannah Bay » !
 Deux duos, magnifiques de présence sur le plateau : Clotilde Chollet et Didier Bezace en personne pour la première, Anne Consigny et la sublime Emmanuelle Riva dans la seconde, aussi belle et émouvante qu’au temps d’« Hiroshima mon amour », le film écrit par Duras et réalisé par le grand et regretté Alain Resnais… Dans l’une et l’autre pièce, il y est question d’amour, de solitude, de blessures inavouées. Duras nous entraîne au cœur même de l’errance des sentiments dont elle fit si souvent l’expérience dans sa propre existence.
Deux duos, magnifiques de présence sur le plateau : Clotilde Chollet et Didier Bezace en personne pour la première, Anne Consigny et la sublime Emmanuelle Riva dans la seconde, aussi belle et émouvante qu’au temps d’« Hiroshima mon amour », le film écrit par Duras et réalisé par le grand et regretté Alain Resnais… Dans l’une et l’autre pièce, il y est question d’amour, de solitude, de blessures inavouées. Duras nous entraîne au cœur même de l’errance des sentiments dont elle fit si souvent l’expérience dans sa propre existence.
Un homme et une femme se rencontrent par hasard dans un « Square » : les silences et non-dits comptent autant que les dialogues échangés, fatuité des mots et pureté de la langue. Une grand-mère et sa petite fille apprennent à se connaître et se reconnaître, naître et renaître à l’autre au sens premier du terme, tentent de s’apprivoiser : magie de l’instant retrouvé, du temps partagé !
Une mise en scène épurée à l’extrême, où la langue habite la scène autant que les interprètes, tous exceptionnels : c’est beau, c’est fort, c’est poignant quand l’humour et le tragique se déclinent avec autant d’intelligence et de talent. A ne pas manquer !
Jusqu’au 05/07, à 19H et 21H, au Théâtre de l’Atelier (1 place Charles Dullin, 75018 Paris. Tél. : 01.46.06.49.24).
 dénoncer incuries et vicissitudes qui secouent l’Égypte. Depuis l’arrivée au pouvoir en 1981 d’Hosni Moubarak, au lendemain de l’assassinat du président Sadate, jusqu’à sa chute en 2011… « Depuis vingt ans, j’écris des livres dans ma tête en me posant toujours la même question : pourquoi écrire dans un pays qui s’enfonce doucement dans le sous-développement et la sous-culture ? », confesse avec humour le jeune écrivain. Un homme pourtant fier et amoureux du Caire, « ma ville, mes amis, mes amours », un homme qui n’admet pas de voir ce peuple au génie millénaire sombrer dans « la lourdeur psychologique et la laideur »… Parus respectivement en Égypte en 2007 et 2009, ces deux romans auguraient de manière prémonitoire le séisme politique et social qui allait faire trembler la terre des pharaons deux ans plus tard.
dénoncer incuries et vicissitudes qui secouent l’Égypte. Depuis l’arrivée au pouvoir en 1981 d’Hosni Moubarak, au lendemain de l’assassinat du président Sadate, jusqu’à sa chute en 2011… « Depuis vingt ans, j’écris des livres dans ma tête en me posant toujours la même question : pourquoi écrire dans un pays qui s’enfonce doucement dans le sous-développement et la sous-culture ? », confesse avec humour le jeune écrivain. Un homme pourtant fier et amoureux du Caire, « ma ville, mes amis, mes amours », un homme qui n’admet pas de voir ce peuple au génie millénaire sombrer dans « la lourdeur psychologique et la laideur »… Parus respectivement en Égypte en 2007 et 2009, ces deux romans auguraient de manière prémonitoire le séisme politique et social qui allait faire trembler la terre des pharaons deux ans plus tard. », des conversations qui lui permettent ainsi de libérer sa parole et sa plume alors que, embauché dans un grand quotidien de la capitale, le journaliste constate que ses papiers ne sont jamais publiés : une situation ubuesque pour le fringuant diplômé en sciences politiques de l’université du Caire, en relations internationales à celle de la Sorbonne ! « Moubarak, candidat à un cinquième mandat, vous imaginez ? Vingt-quatre ans au pouvoir, sans véritables avancées ni changements significatifs au quotidien pour la population ». Sous la plume de Khaled Al Khamissi, les bouches s’ouvrent, le petit peuple des rues du Caire prend la parole au grand jour ! Pour dénoncer l’incurie du régime, la corruption à tous les étages du pouvoir, le népotisme de l’administration et de la police, les difficultés de la vie au quotidien, les carences du système éducatif et l’absence d’ouvertures culturelles, le bradage de l’économie au capitalisme international… Et de récidiver avec « L’arche de Noé », livre-portrait de douze hommes et femmes, intellectuels ou fils du peuple dont les destins se sont croisés avant ou après avoir émigré – ou tenté de le faire – à la recherche d’un emploi.
», des conversations qui lui permettent ainsi de libérer sa parole et sa plume alors que, embauché dans un grand quotidien de la capitale, le journaliste constate que ses papiers ne sont jamais publiés : une situation ubuesque pour le fringuant diplômé en sciences politiques de l’université du Caire, en relations internationales à celle de la Sorbonne ! « Moubarak, candidat à un cinquième mandat, vous imaginez ? Vingt-quatre ans au pouvoir, sans véritables avancées ni changements significatifs au quotidien pour la population ». Sous la plume de Khaled Al Khamissi, les bouches s’ouvrent, le petit peuple des rues du Caire prend la parole au grand jour ! Pour dénoncer l’incurie du régime, la corruption à tous les étages du pouvoir, le népotisme de l’administration et de la police, les difficultés de la vie au quotidien, les carences du système éducatif et l’absence d’ouvertures culturelles, le bradage de l’économie au capitalisme international… Et de récidiver avec « L’arche de Noé », livre-portrait de douze hommes et femmes, intellectuels ou fils du peuple dont les destins se sont croisés avant ou après avoir émigré – ou tenté de le faire – à la recherche d’un emploi.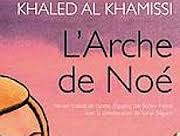 réels mais fortement retravaillés pour devenir des fictions où chaque « témoin » décrit avec force détails tragi-comiques son quotidien parsemé d’embûches. « Depuis des décennies, nous assistons à l’échec absolu des politiques en tout domaine, l’Égypte se retrouve dans une impasse. Pourtant je l’affirme, le peuple égyptien est un grand peuple, un peuple de génie, un peuple d’une grande sagesse. D’où ma foi en la rue, pas en l’intelligentsia ». Sous couvert d’histoires croisées d’apparence anodine ou cabotine, Khaled Al Khamissi offre un authentique brûlot politique, une peinture au vitriol d’un pays confisqué par une caste de nantis qui pillent sans vergogne les richesses et les attentes d’un peuple besogneux presque revenu au temps de l’esclavage !
réels mais fortement retravaillés pour devenir des fictions où chaque « témoin » décrit avec force détails tragi-comiques son quotidien parsemé d’embûches. « Depuis des décennies, nous assistons à l’échec absolu des politiques en tout domaine, l’Égypte se retrouve dans une impasse. Pourtant je l’affirme, le peuple égyptien est un grand peuple, un peuple de génie, un peuple d’une grande sagesse. D’où ma foi en la rue, pas en l’intelligentsia ». Sous couvert d’histoires croisées d’apparence anodine ou cabotine, Khaled Al Khamissi offre un authentique brûlot politique, une peinture au vitriol d’un pays confisqué par une caste de nantis qui pillent sans vergogne les richesses et les attentes d’un peuple besogneux presque revenu au temps de l’esclavage !