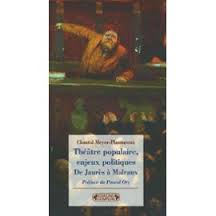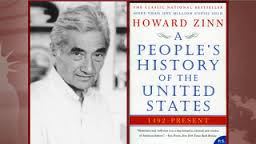Sociologue, directeur de recherches au CNRS, Jean Viard réfléchit de longue date sur la maîtrise du temps entre loisirs et travail. Des 40 H conquis en 1936 aux 35 H de 1997, rencontre avec un chercheur à la parole libre sur son analyse du temps libéré.
Sous le soleil printanier, dans le jardin attenant aux locaux du CNRS où siège le CEVIPOF, le Centre de recherches politiques de Sciences Po, l’homme libère son propos avec autant de sérieux que d’aisance, d’un ton aussi léger que la brise passagère. C’est que Jean Viard maîtrise son sujet “ temps libre et travail ”, un “ maître du temps ” au verbe convaincant.
“ 1936 ? C’est les congés payés, la découverte de la mer, un grand imaginaire de liberté au fond ”, affirme en préambule Jean Viard. Pour tempérer d’emblée son propos, “ dans tous les grands pays à la même époque, on a donné les congés payés quel que soit le système politique : en URSS, en Australie, dans les pays fascist es ”. Pourquoi de telles images alors accrochées à la seule bannière du Front populaire ? “ Dans notre récit collectif, les congés payés sont une grande aventure de gauche. Et c’est vrai, ce n’est pas seulement un récit, ils sont liés effectivement à un siècle de luttes sociales sur le temps ”. Le chercheur fonde son discours en distinguant trois étapes marquantes de l’histoire des sociétés. Il y a d’abord l’époque des sociétés agricoles où c’est la religion qui gère le temps, celui du climat comme de la vie au quotidien (la limite du temps de travail dans les plaines ou les montagnes, c’est la pluie ou la neige). Ensuite vient la révolution de 1789 qui supprime à l’atelier tous les jours fériés, y compris le dimanche pour inventer la décade (pour faire en sorte au final qu’il y ait le moins de jours de repos possible). C’est enfin le triomphe d’un temps industriel où l’on ne fait que travailler. D’où plus d’un siècle de luttes pour remettre du temps de non – travail dans le temps industriel, de 1841 avec l’interdiction du travail des enfants à 36 avec les congés payés, les conventions collectives et la semaine de cinq jours. “ 1936, c’est donc fondamentalement la réinvention d’un temps social, industriel, qui n’avait pas été pensé avant ”.
es ”. Pourquoi de telles images alors accrochées à la seule bannière du Front populaire ? “ Dans notre récit collectif, les congés payés sont une grande aventure de gauche. Et c’est vrai, ce n’est pas seulement un récit, ils sont liés effectivement à un siècle de luttes sociales sur le temps ”. Le chercheur fonde son discours en distinguant trois étapes marquantes de l’histoire des sociétés. Il y a d’abord l’époque des sociétés agricoles où c’est la religion qui gère le temps, celui du climat comme de la vie au quotidien (la limite du temps de travail dans les plaines ou les montagnes, c’est la pluie ou la neige). Ensuite vient la révolution de 1789 qui supprime à l’atelier tous les jours fériés, y compris le dimanche pour inventer la décade (pour faire en sorte au final qu’il y ait le moins de jours de repos possible). C’est enfin le triomphe d’un temps industriel où l’on ne fait que travailler. D’où plus d’un siècle de luttes pour remettre du temps de non – travail dans le temps industriel, de 1841 avec l’interdiction du travail des enfants à 36 avec les congés payés, les conventions collectives et la semaine de cinq jours. “ 1936, c’est donc fondamentalement la réinvention d’un temps social, industriel, qui n’avait pas été pensé avant ”.
Pour le sociologue, cette reconstruction, cette réinvention du temps industriel fut lente en France parce que le cœur en était la grande revendication des 40H, celle de la journée de 8H, “ les gens luttaient à cette époque pour changer le temps qu’ils connaissaient : la semaine, la journée ”. Imaginez : 3500 H de travail à la fin du XIXème siècle en France, par an et par salarié, 1600 H aujourd’hui ! “ Il faut avoir ces représentations à l’esprit pour comprendre le poids de 1936 dans notre imaginaire collectif, ce ne sont pas des revendications d’opportunité, elles résultent d’un siècle et demi de luttes : en 36, à mes yeux, avec la semaine de 40 H on vote l’espace temps de la société industrielle qui, paradoxalement, se ferme avec la loi sur les 35 H : celui-là ouvre l’espace temps d’une société post-industrielle. C’est-à-dire où le temps est à soi, où se pose la question du pouvoir sur son emploi du temps ”. Selon le chercheur donc, désormais on est entré dans une autre époque… Le grand projet des humanistes de gauche d’alors, Léon Blum – Jean Zay –Léo Lagrange, “ changer radicalement et en profondeur la vie au détriment peut-être des changements révolutionnaires ”, est en train de prendre forme sous nos yeux : vacances et temps libre sont devenus les grands restructurateurs de nos sociétés, ils ne sont plus seulement que de simples fenêtres dans le monde du travail. “ Aujourd’hui, le temps de travail ne représente plus que 10% du temps de vie d’un homme : c’est l’explosion la plus phénoménale de ce siècle, enfin l’homme a pu s’approprier le temps ! ”.
D’où la question essentielle qui en découle, selon Jean Viard : lorsque l’appropriation privée du temps, et non plus le travail dans son idéologie marxiste ou libérale, structure désormais le social, comment retrouve-t-il une légitimité dans cet espace-là ? Entre une culture de droite dominée par l’image de la hiérarchie et du chef et celle de gauche structurée sur la division en classes sociales, désormais s’immiscent, se distinguent et se multiplient les différents espaces identitaires qui surdéterminent les individus. “ Contrairement à cette époque où le travail était la seule référence et reconnaissance qui effaçaient les autres, les appartenances identitaires sont devenues multiples : par exemple postier certes, mais peut-être aussi breton ou malien, homosexuel et joueur de foot. Le Front populaire est la quintessence de ce modèle moniste, le travail comme référent unique, alors qu’il nous faut comprendre aujourd’hui que les gens sont multi-appartenants et peuvent en jouer ”. En passant surtout d’un modèle du temps libre qui était le repos à celui d’un temps d’hyper activité où s’impose l’idée du travail pour soi… “ Nous sommes rentrés dans un nouvel espace temps, aléatoire – imprévisible et discontinu. Il faut comprendre ce changement d’espace temps, qui est celui de la modernité, en se disant tout à la fois que nous n’avons pas fini la démocratisation du modèle précédent : par exemple, il y en a encore qui ne partent toujours pas en vacance ”.
Dans ce contexte où interfèrent divers repères d’appartenance, où la privatisation des liens sociaux a supplanté les liens du collectif, où les catégories espace et temps ont explosé sous les coups de la modernité, Jean Viard estime que le concept de mobilité doit devenir le socle du fameux “ ascenseur républicain ” d’antan qui permettait à chacun de s’épanouir et d’espérer socialement et professionnellement. Avec la question clef, un enjeu essentiel : comment ces individus devenus autonomes et indépendants font désormais société ensemble et comment on réinvente de la protection pour que le salarié qui se déplace se retrouve protégé ? “ Pas sur le mode des discours ultra libéraux, il suffit d’enlever les protections et le salarié devient mobile : certes, il n’y a pas de limite à la vulgarité des relations sociales ! Les gens ont besoin de totems pour faire société ensemble, des valeurs telles que l’égalité, des événements comme une coupe du monde de football, des fêtes politiques comme une élection présidentielle. Une société a besoin de marqueurs de l’égalité, produire des temps libres plus égalitaires devient un enjeu d’intégration. Ma conviction ? Aujourd’hui le politique se doit de penser cette mobilité, la raconter, permettre aux gens de se représenter dans cette histoire et débattre ensuite où mettre les règles de protection. Il ne faut pas croire qu’il peut y avoir une société de l’abondance du non – travail, c’est faux, quel que soit le temps du travail il demeure central en tant que production de richesses et construction d’identités ”.
Pour le chercheur, les perspectives sont claires : nous sommes entrés dans une société de l’aventure, de la discontinuité. Le problème : “ Comment assumer cet état de fait, en tentant de le subir le moins possible ? C’est l’élément de fond pour la compréhension et la lecture de cette société ”. D’où la conclusion de Jean Viard sous forme d’interpellation, “ les cultures de gauche ont encore un fondement issu du modèle de 36, en conséquence elles ont du mal à entrer dans ce type de réflexion : comment on passe d’un monde à un autre et comment on aide les plus faibles à y entrer, sur quels objectifs on crée des rapports de force et quels objectifs on se donne en terme de modes de société ? Hier comme aujourd’hui, au temps du Front populaire comme en ce troisième millénaire, nous avons besoin d’horizons, nous ne pouvons vivre sans espérance ”. Yonnel Liégeois
Éloge de la mobilité
Un titre provocateur, peut-être, mais un livre “ Éloge de la mobilité, essai sur le  capital temps libre et la valeur travail ” qui masque une réflexion sérieuse fondée sur un état de fait incontournable : soixante-dix ans après 1936, nos sociétés ont profondément changé. Pour Jean Viard, “ l’initiation populaire (et inégalitaire) aux temps libres et son corollaire, la mobilité de masse, ont modifié nos façons de vivre : la place du temps éveillé non travaillé a pris le pas sur tous les autres temps, l’ordre mobile que nous a légué le XXème siècle n’est ainsi naturellement ni démocratique ni égalitaire. C’est pourtant dans son cadre que nous devons réorganiser nos luttes pour la liberté, la justice et la fraternité ”. Éditions de l’Aube, 205 p., 18€.
capital temps libre et la valeur travail ” qui masque une réflexion sérieuse fondée sur un état de fait incontournable : soixante-dix ans après 1936, nos sociétés ont profondément changé. Pour Jean Viard, “ l’initiation populaire (et inégalitaire) aux temps libres et son corollaire, la mobilité de masse, ont modifié nos façons de vivre : la place du temps éveillé non travaillé a pris le pas sur tous les autres temps, l’ordre mobile que nous a légué le XXème siècle n’est ainsi naturellement ni démocratique ni égalitaire. C’est pourtant dans son cadre que nous devons réorganiser nos luttes pour la liberté, la justice et la fraternité ”. Éditions de l’Aube, 205 p., 18€.
L’explosion culturelle
École, loisirs, chanson, cinéma : dans l’embellie de 1936, le Front populaire met sur pied une véritable “ politique culturelle ” avant la lettre. Sous l’impulsion de deux figures marquantes : Jean Zay et Léo Lagrange. Le premier s’attaque à la démocratisation de l’école, le second promeut la santé physique et morale du pays en intensifiant la pratique sportive et en développant le réseau des auberges de jeunesse.
Des décisions qui, sur le fond, rejoignent la révolution culturelle initiée par les intellectuels de l’époque : le mouvement surréaliste avec André Breton qui apporte au début son soutien à la cause, la bande à Prévert qui s’en va jouer la révolution à la porte des usines occupées, Piaf et Trénet qui imposent leurs chansons réalistes et poétiques sur les boulevards et dans les cabarets, Gabin et Simon qui révèlent “ leur “ gueule ” au cinéma. C’est le temps des réalisateurs de renom (Renoir, Duvivier, Clair…) et du cinéma militant avec diverses fédérations de la CGT ( métallurgie, chemins de fer, bâtiment…) qui passent commande à Jean Epsein, Boris Peskine ou jacques Lemare… Sur la scène littéraire, Céline s’est imposé dès 1932 avec le “ Voyage au bout de la nuit ”, Giono et Malraux prennent fait et cause pour le peuple. Futur prix Nobel de littérature, Romain Rolland plaide en faveur d’un véritable théâtre populaire et dans son essai, “ Le théâtre du peuple ”, il affirme qu’ “ il s’agit de fonder un art nouveau pour un monde nouveau ”.
Autant de mouvements novateurs, en tout domaine des arts et lettres, qui s’imposent en 1936 et perdureront bien au-delà : au lendemain de la seconde guerre mondiale et dans les décennies qui suivront la Libération, ils irrigueront le mouvement de décentralisation culturelle soutenu par André Malraux, créateur du ministère de la Culture.
 De retour au pays après de brillantes études en métropole, l’enfant de la Martinique lance avec son épouse Suzanne une revue culturelle qui accueille ses premiers textes, « Tropiques ». Une revue que découvre Breton fuyant le temps de l’occupation, de passage aux Antilles en 1941, et qui encense d’emblée les mots et vers du jeune professeur… « Je n’en crus pas mes yeux. Aimé Césaire, c’était le nom de celui qui parlait… Défiant à lui seul une époque où l’on croit assister à l’abdication générale de l’esprit,… où l’art même menace de se figer dans d’anciennes données, le premier souffle nouveau, revivifiant, apte à redonner toute confiance est l’apport d’un noir ». Un adoubement dans la sphère intellectuelle que Césaire appréciera sans pour autant s’y laisser enfermer… L’homme est trop épris de liberté pour courber le verbe sous le joug des élites, qu’elles soient littéraires ou politiques : rupture avec le PCF dont il fut le représentant à l’Assemblée nationale, rupture avec les auteurs créoles qui font allégeance à Aragon, découverte de l’écriture théâtrale, engagement de l’élu au plus près de ses concitoyens pour obtenir la départementalisation de son île.
De retour au pays après de brillantes études en métropole, l’enfant de la Martinique lance avec son épouse Suzanne une revue culturelle qui accueille ses premiers textes, « Tropiques ». Une revue que découvre Breton fuyant le temps de l’occupation, de passage aux Antilles en 1941, et qui encense d’emblée les mots et vers du jeune professeur… « Je n’en crus pas mes yeux. Aimé Césaire, c’était le nom de celui qui parlait… Défiant à lui seul une époque où l’on croit assister à l’abdication générale de l’esprit,… où l’art même menace de se figer dans d’anciennes données, le premier souffle nouveau, revivifiant, apte à redonner toute confiance est l’apport d’un noir ». Un adoubement dans la sphère intellectuelle que Césaire appréciera sans pour autant s’y laisser enfermer… L’homme est trop épris de liberté pour courber le verbe sous le joug des élites, qu’elles soient littéraires ou politiques : rupture avec le PCF dont il fut le représentant à l’Assemblée nationale, rupture avec les auteurs créoles qui font allégeance à Aragon, découverte de l’écriture théâtrale, engagement de l’élu au plus près de ses concitoyens pour obtenir la départementalisation de son île. Les 11 et 12/07 à 12H10 en Avignon, le Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, le TOMA (Théâtres d’Outre-mer en Avignon), célèbrera à sa façon le centième anniversaire de la naissance du poète. Avec « Ave Césaire », une adaptation du recueil de textes « Afriques Diaspora Négritude » de Marc Alexandre Oho Bambe, où se retrouvent le slam, la poésie, le théâtre et la musique. Un cri nègre et un manifeste contre l’oubli qui invite à la rencontre des mondes et à une réflexion sur la transversalité des mémoires et de l’héritage, un hommage aussi à la parole incandescente d’Aimé Césaire.
Les 11 et 12/07 à 12H10 en Avignon, le Théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné, le TOMA (Théâtres d’Outre-mer en Avignon), célèbrera à sa façon le centième anniversaire de la naissance du poète. Avec « Ave Césaire », une adaptation du recueil de textes « Afriques Diaspora Négritude » de Marc Alexandre Oho Bambe, où se retrouvent le slam, la poésie, le théâtre et la musique. Un cri nègre et un manifeste contre l’oubli qui invite à la rencontre des mondes et à une réflexion sur la transversalité des mémoires et de l’héritage, un hommage aussi à la parole incandescente d’Aimé Césaire.