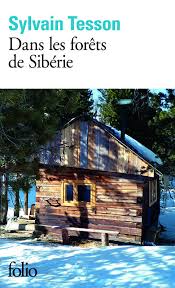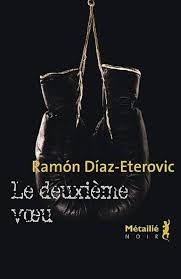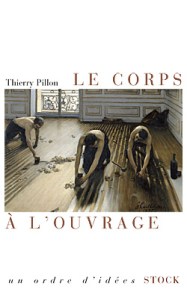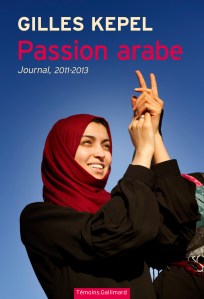Prix Goncourt 1992 pour « Texaco », l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau poursuit sa réflexion sur les traces du regretté Édouard Glissant, son compagnon d’écriture : quête des origines, créolisation et métissage, individuation et rapport aux autres. En revisitant aujourd’hui la figure emblématique de Robinson, chère à Daniel Defoe et Michel Tournier, dans « L’empreinte à Crusoé » nouvellement réédité en poche. Un roman foisonnant qui narre, à travers moult péripéties, le cheminement de la conscience humaine des origines à nos jours.
Yonnel Liégeois – Entre votre Robinson et vous, il y a plus qu’une empreinte ! Aurait-il pu surgir de l’imaginaire d’un écrivain, autre qu’antillais ou caribéen ?
 Patrick Chamoiseau – Je ne pense pas que l’on puisse séparer l’exercice littéraire d’une perception globale à la fois de la société, du monde, de l’évolution des cultures et des individus. Je suis martiniquais, je suis ce qu’on appelle un créole américain. Et tout cet espace américain, ces Amériques, ont été fondés un peu de la même manière sur la base du génocide amérindien, la traite des nègres, l’esclavage, tout le déploiement de la colonisation et de ce qu’on peut appeler le post-colonialisme. Cela s’est traduit par des conquêtes, dominations, exterminations, génocides, cela c’est aussi traduit par des émergences inattendues : des imaginaires, des visions du monde, des dieux, des langues se sont rencontrés et ont été forcés de vivre ensemble. Pour donner quelque chose de nouveau qu’Édouard Glissant a nommé processus de créolisation.
Patrick Chamoiseau – Je ne pense pas que l’on puisse séparer l’exercice littéraire d’une perception globale à la fois de la société, du monde, de l’évolution des cultures et des individus. Je suis martiniquais, je suis ce qu’on appelle un créole américain. Et tout cet espace américain, ces Amériques, ont été fondés un peu de la même manière sur la base du génocide amérindien, la traite des nègres, l’esclavage, tout le déploiement de la colonisation et de ce qu’on peut appeler le post-colonialisme. Cela s’est traduit par des conquêtes, dominations, exterminations, génocides, cela c’est aussi traduit par des émergences inattendues : des imaginaires, des visions du monde, des dieux, des langues se sont rencontrés et ont été forcés de vivre ensemble. Pour donner quelque chose de nouveau qu’Édouard Glissant a nommé processus de créolisation.
Y.L.– Créolité, créolisation… Qu’entendez-vous précisément par ces mots ?
P.C.– Le processus de créolisation signifie que de manière accélérée, massive et brutale, des peuples, des perceptions du monde, des cosmogonies, des dieux, des langues, des cultures, des civilisations se sont rencontrés, ont été forcés d’élaborer de nouveaux savoir-faire et de nouveaux savoir-être pour donner les peuples composites que nous sommes. La créolité martiniquaise n’est pas la créolité cubaine, qui elle-même n’est pas la créolité du Brésil… La conquête des Amériques réalisée par Christophe Colomb marquera le premier temps de la mondialisation : la mise en convergence de peuples et de cultures qui vivaient jusqu’alors sous des espaces temporels assez importants. Toutes ces rencontres ont pratiquement anéanti les absolus véhiculés par les cultures anciennes. Je fais donc partie d’un peuple composite dont tous les marqueurs identitaires, toutes les structurations habituelles ont été effacés. Par exemple, dans un peuple archaïque, archaïque dans le sens « peuple premier », le groupe d’Homo Sapiens essayait de légitimer sa présence sur un territoire particulier en se racontant des histoires. Et la première qu’il se raconte, c’est une création du monde, une genèse : d’où vient le monde, comment il a été constitué… A partir de cette genèse, le peuple en question se raconte un mythe fondateur, dont va découler l’histoire de la communauté, ce qui va devenir en gros l’histoire nationale : nos ancêtres, nos grands faits d’armes, toute la littérature épique qui narre comment la communauté s’est constituée.
Y.L.– Or, en tant que Caribéen, vous semblez vous déclarer orphelin de marqueurs identitaires ?
 P.C.– Pour un peuple composite des Amériques, il n’y a pas de genèse, ou alors il faudrait prendre les genèses des amérindiens, les genèses de toutes les ethnies africaines, les genèses transportées par les différents colons qui se sont entretués et ont massacré un peu partout : trop de genèses tue la genèse ! Pour raconter l’histoire de la Martinique, par exemple, il faudrait bien sûr raconter l’histoire des amérindiens avec une infinité de peuples amérindiens, il faudrait raconter l’histoire de la colonisation, c’est d’ailleurs ce qu’on nous servait à l’école : à part nos ancêtres les Gaulois, on nous expliquait l’histoire de la Martinique à partir de 1635 avec le débarquement du flibustier normand Pierre Belain d’Esnambuc. Cette histoire de la colonisation ne saurait expliquer la composition du peuple composite, elle ne raconte que le discours du vainqueur, le discours du colonisateur. Nous vivons désormais dans des sociétés multi-transculturelles, un peu semblables à ce que nous vivions dans les plantations esclavagistes, en tout cas à ce que nous avons vécu dans les Amériques. Une bonne part de la réflexion d’Édouard Glissant fut justement de bien comprendre ce que voulait dire la créolisation. On peut avoir, par exemple, une communauté très importante qui provient de Guinée, sans aucune survivance provenant de la Guinée, mais avec des survivances qui viennent d’ailleurs. Il nous manque une anthropologie de la créolisation. D’autant plus nécessaire qu’elle nous permettrait de comprendre la société actuelle. Penser aujourd’hui que nous sommes dans une société pure, bien stable, avec des identités qui ne bougent pas, c’est une vue de l’esprit. Tous les enfants du monde ont les mêmes pantalons qui leur tombent sur les fesses, les mêmes tatouages, ils écoutent la même musique, 80% de ce qui constitue l’imaginaire de nos enfants n’est pas constitué de ce qui provient de France par exemple, ou qui viendrait de la Martinique, mais par ce qui est transporté par tous les écrans, tous les flux et les fluides qui viennent d’un monde qui est désormais ouvert !
P.C.– Pour un peuple composite des Amériques, il n’y a pas de genèse, ou alors il faudrait prendre les genèses des amérindiens, les genèses de toutes les ethnies africaines, les genèses transportées par les différents colons qui se sont entretués et ont massacré un peu partout : trop de genèses tue la genèse ! Pour raconter l’histoire de la Martinique, par exemple, il faudrait bien sûr raconter l’histoire des amérindiens avec une infinité de peuples amérindiens, il faudrait raconter l’histoire de la colonisation, c’est d’ailleurs ce qu’on nous servait à l’école : à part nos ancêtres les Gaulois, on nous expliquait l’histoire de la Martinique à partir de 1635 avec le débarquement du flibustier normand Pierre Belain d’Esnambuc. Cette histoire de la colonisation ne saurait expliquer la composition du peuple composite, elle ne raconte que le discours du vainqueur, le discours du colonisateur. Nous vivons désormais dans des sociétés multi-transculturelles, un peu semblables à ce que nous vivions dans les plantations esclavagistes, en tout cas à ce que nous avons vécu dans les Amériques. Une bonne part de la réflexion d’Édouard Glissant fut justement de bien comprendre ce que voulait dire la créolisation. On peut avoir, par exemple, une communauté très importante qui provient de Guinée, sans aucune survivance provenant de la Guinée, mais avec des survivances qui viennent d’ailleurs. Il nous manque une anthropologie de la créolisation. D’autant plus nécessaire qu’elle nous permettrait de comprendre la société actuelle. Penser aujourd’hui que nous sommes dans une société pure, bien stable, avec des identités qui ne bougent pas, c’est une vue de l’esprit. Tous les enfants du monde ont les mêmes pantalons qui leur tombent sur les fesses, les mêmes tatouages, ils écoutent la même musique, 80% de ce qui constitue l’imaginaire de nos enfants n’est pas constitué de ce qui provient de France par exemple, ou qui viendrait de la Martinique, mais par ce qui est transporté par tous les écrans, tous les flux et les fluides qui viennent d’un monde qui est désormais ouvert !
Y.L.– D’où ce chamboulement des valeurs, cette impression de perte d’identité pour nos sociétés occidentales ?
P.C.– Tous les marqueurs identitaires traditionnels sont complètement bouleversés. Par exemple, je suis de peau noire, mais je suis plus proche de n’importe quel blanc de la Caraïbe que d’un Africain. Même si j’ai des affinités, des solidarités vivantes avec l’Afrique… J’écris en français, mais je suis plus proche de n’importe quel anglophone, hispanophone ou créolophone de la Caraïbe que de Patrick Modiano ou d’Alexandre Jardin… La couleur de la peau, la langue que l’on parle, ne donnent pas une fraternité déterminante aujourd’hui. Aujourd’hui, celui qui a la peau noire ressemble plus à G. Busch qu’à Mandela, pourtant il a la peau noire ! Si on se base sur ces anciens marqueurs identitaires, on risque très largement de passer à côté de la notion de diversité. Penser que la diversité est constituée par des phénotypes est une absurdité : lorsque vous regardez tous ces gens, peau noire ou yeux bridés, qui présentent les journaux télévisés, ils ont les mêmes gestes, la même manière de concevoir l’information, ils sont du même monde. On a une pensée unique ! Il nous faut donc réfléchir sur cette question de la créolisation : que se passe-t-il quand autant de cultures, de visions du monde, de langues, de dieux sont obligés de recomposer du nouveau dans les modalités qui sont celles du monde contemporain, des modalités qui sont celles de la Totalité Monde ? Nous ne vivons plus à l’échelle d’un clocher, d’un territoire, d’une langue, d’un dieu, mais dans un espace ouvert où nous recevons des stimulations qui viennent de partout.
Y.L.– Une ouverture au monde qui, paradoxalement, peut conduire au renfermement ou à l’isolement…

Co Bapoushoo
P.C.– Effectivement, avec cette problématique de l’individuation que tous les groupes, les syndicats en particulier, connaissent bien. Vous savez combien c’est difficile de trouver des militants, des gens qui s’investissent. « Ce n’est plus comme avant », entendons-nous souvent. Aujourd’hui, il est très facile de briser une grève en accordant des primes à ceux-là, des avantages à ceux-ci, vous connaissez ça mieux que moi ! Il est très difficile de retrouver le collectif qu’on pouvait avoir il y a quelque temps, il y a eu un processus d’individuation qui fait qu’aujourd’hui nous sommes une société d’individus. Très souvent, on a tendance à dire que c’est l’idéologie capitaliste qui a exacerbé, développé ou provoqué le processus d’individuation avec le renferment de chacun sur ces petits problèmes et le manque de solidarité. Je ne le crois pas. L’individu a toujours existé dans les communautés archaïques, mais brimé par des corsets symboliques qui progressivement se sont épuisés sous le développement de la conscience et de la connaissance. Paradoxalement, la seule idéologie qui a réussi à chevaucher cette individuation, c’est l’idéologie capitaliste qui accompagne les pulsions individuelles, qui favorise l’égoïsme et le repli sur soi, qui remplace le grand désir de réalisation de soi par des pulsions consommatrices … On peut donc dire que l’égocentrisme, le manque de solidarité, tout ce dont nous souffrons aujourd’hui, le peu d’investissement dans les grands idéaux, c’est plus une maladie de l’individuation qu’une caractéristique de l’individuation elle-même. Ce qu’il nous faut comprendre, c’est que la solidarité, les grands mouvements d’ensemble pour lutter contre les forces de domination passent par le développement des capacités de connaissance et de conscience des individus. C’est paradoxalement la plénitude de chaque individu, donc l’élévation de son niveau de conscience, de connaissance, de sensibilité artistique et esthétique, qui ouvrira la voie aux nouvelles solidarités.
Y.L.– A vous entendre, on croirait lire du Chamoiseau dans « L’empreinte à Crusoé » !
 P.C.– C’est un peu ce qui se passe, en effet, avec notre bon Robinson sur son île. Sa solitude, le fait qu’il soit coupé de tous les êtres humains l’obligent à se construire lui-même de manière autonome. Une fois qu’il se réalise, que son niveau de conscience va augmenter, le désir de l’autre, la solidarité avec les autres êtres humains viennent naturellement dans ces modalités d’existence. C’est la grande puissance et la grande misère de l’Homo Sapiens que de disposer de la conscience réflexive. Quand elle apparaît, Sapiens se retrouve fasciné et terrifié à la fois par ce qu’il y a autour de lui et qu’il ne comprend pas : le ciel étoilé, la lune, la foudre, les paysages, les animaux, sa propre vie, sa mort, la putréfaction. Ce sont des épouvantes incroyables, c’est une terreur totale. Que fait Sapiens pour s’en tirer ? Il va se raconter une infinité d’histoires, il va déployer entre lui et ce qu’il ne comprend pas, un paravent. C’est l’esprit magique, c’est la création des dieux et des démons, tout sera expliqué par un déploiement d’imaginaire : les grandes religions, toutes les croyances, la philosophie, les sciences et les techniques. Notre champ de conscience provient de ce point originel où la conscience de Sapiens a été terrifiée. Il y a fondamentalement un impensable, un abîme que l’on masque avec ce paravent que sont les cultures, les croyances, les dieux, les diables, les démons, les systèmes de pensée, les idéologies. Mais à mesure que notre degré de sensibilité, d’humanisation augmente, nous nous apercevons que ce sont des béquilles, des artéfacts, telle cette prétention des grands systèmes idéologiques à nous donner l’explication du monde avec la perspective d’un grand soir où l’on accèderait enfin au bonheur…
P.C.– C’est un peu ce qui se passe, en effet, avec notre bon Robinson sur son île. Sa solitude, le fait qu’il soit coupé de tous les êtres humains l’obligent à se construire lui-même de manière autonome. Une fois qu’il se réalise, que son niveau de conscience va augmenter, le désir de l’autre, la solidarité avec les autres êtres humains viennent naturellement dans ces modalités d’existence. C’est la grande puissance et la grande misère de l’Homo Sapiens que de disposer de la conscience réflexive. Quand elle apparaît, Sapiens se retrouve fasciné et terrifié à la fois par ce qu’il y a autour de lui et qu’il ne comprend pas : le ciel étoilé, la lune, la foudre, les paysages, les animaux, sa propre vie, sa mort, la putréfaction. Ce sont des épouvantes incroyables, c’est une terreur totale. Que fait Sapiens pour s’en tirer ? Il va se raconter une infinité d’histoires, il va déployer entre lui et ce qu’il ne comprend pas, un paravent. C’est l’esprit magique, c’est la création des dieux et des démons, tout sera expliqué par un déploiement d’imaginaire : les grandes religions, toutes les croyances, la philosophie, les sciences et les techniques. Notre champ de conscience provient de ce point originel où la conscience de Sapiens a été terrifiée. Il y a fondamentalement un impensable, un abîme que l’on masque avec ce paravent que sont les cultures, les croyances, les dieux, les diables, les démons, les systèmes de pensée, les idéologies. Mais à mesure que notre degré de sensibilité, d’humanisation augmente, nous nous apercevons que ce sont des béquilles, des artéfacts, telle cette prétention des grands systèmes idéologiques à nous donner l’explication du monde avec la perspective d’un grand soir où l’on accèderait enfin au bonheur…
Y.L.– Votre « Robinson » est totalement dans cette perspective-là ?

Co Bapoushoo
P.C.– Pour moi, deux Robinson furent déterminants. Le Robinson de mon enfance d’abord, celui de Daniel Defoe qui m’a fait rêver, il n’y a pas une seule plage que je visite en Martinique sans penser tout de suite à mon Robinson. A l’époque, il y avait tellement d’interdits que je n’avais qu’une envie : grandir et faire ce que je veux ! Et ce personnage qui n’avait personne pour l’embêter sur son île, qui pouvait faire ce qu’il voulait, construire ce qu’il voulait, manger ce qu’il voulait … Il refaisait le monde tout seul, pour moi c’était fascinant et je l’ai conservé dans mon esprit pendant très longtemps. Aussi, dès l’âge de 14 ans, je savais que j’écrirai ou ferai quelque chose avec cet archétype du Robinson ! Progressivement je vais m’apercevoir, surtout à l’émergence de ma conscience anticolonialiste, que le Robinson de Defoe essaye avant tout de reconstituer la civilisation occidentale dans une nature sauvage : il passe son temps à récupérer dans le bateau échoué tous les vestiges de cette civilisation et à construire dans l’île quelque chose qui lui donnera l’illusion de dominer la nature, de la régenter exactement comme l’Occident a organisé, civilisé, régenté le monde. … Le Robinson de Defoe ? Un petit concentré de colonisation et de civilisation de la sauvagerie, notamment la sauvagerie que représente Vendredi. Celui de Michel Tournier ensuite, « Vendredi ou les Limbes du pacifique », un roman absolument magnifique mais peut-être plus subtil que celui de Defoe. Tournier a un rapport à la nature qui n’est déjà plus un rapport de domination totale mais un rapport de compréhension et de connivence qui annonce la conscience écologique d’aujourd’hui. Mais il développe, surtout, une autre problématique fondamentale qui m’a beaucoup frappé : militant anticolonialiste, il se pose la question de l’autre, son Robinson qui se retrouve seul va voir toute son humanité se décomposer parce qu’il n’a pas le regard de l’autre ! Il nous explique en fait que pour nous construire, comme peuple ou comme individu, il faut l’autre, il faut autrui, il faut même l’étranger, les autres cultures, les autres civilisations. S’il n’y a pas l’altérité, nous ne pouvons atteindre la plénitude de notre humanité. Les grandes civilisations, les grandes cultures ont toujours été un processus d’interaction entre différentes productions de Sapiens. Il n’y a aucune civilisation, aucune culture qui ne se soient pas nourries des autres. Et le plus extraordinaire, c’est que chaque culture, chaque civilisation, ont produit des atrocités et des choses magnifiques, des ombres et des lumières, et que très souvent les lumières de certaines civilisations ont permis de lutter contre les ombres d’autres civilisations. C’est ce que Tournier explore de manière absolument magnifique avec son Vendredi, Robinson a plus d’humanité, grâce à la présence de Vendredi.
Y.L.– La boucle n’était-elle donc pas bouclée avec ces deux figures emblématiques de Robinson ? Pourquoi cette urgente nécessité d’en composer une autre ?
 P.C.– L’étranger aujourd’hui, on le voit tous les jours. En revanche, il y a un autre « autre » qui existe. Et c’est celui là qui intéresse mon Robinson. Il y a l’autre qui constitue la nature, c’est la conscience écologique. Pourquoi ? Parce que toutes les conceptions de l’humanisme qui se sont succédé ont toujours considéré que l’homme était au dessus du vivant, que l’homme était l’aboutissement du vivant. On s’aperçoit que si nous continuons d’exploiter le vivant de la manière la plus éhontée et en fonction de nos seuls intérêts, nous nous condamnons nous-mêmes. Mais pour moi, l’interrogation fondamentale réside en ce moment de l’origine où la conscience de Sapiens découvre l’impensable. Il me semble que, fondamentalement, l’autre aujourd’hui, ce n’est pas simplement l’étranger, ce n’est pas seulement la nature qu’il nous faut intégrer dans notre conception de l’humanisme, c’est l’impensable. Mon Robinson, dans toute sa trajectoire, croise celles du Robinson de Defoe et du Robinson de Tournier, mais il va se retrouver d’abord en face de lui-même le jour où il découvre une empreinte sur la plage de cette île qu’il domine depuis de nombreuses années déjà. Au départ, il a peur parce que l’autre, cet étranger, c’est peut être un ennemi potentiel. Donc il sort ses armes, il se prépare à la guerre, à se battre… Il part à sa recherche mais ne le trouve pas, c’est le premier stade. Le deuxième stade ? C’est quand il se dit que cet autre est peut-être un être humain, quelqu’un à qui il pourrait parler. Alors, il se regarde pour voir si il est bien rasé, et c’est là qu’il s’aperçoit qu’il ressemble à un animal, sale et hirsute. Donc, il commence à retrouver une dignité humaine, simplement parce qu’il imagine qu’il y a quelqu’un d’autre qu’il va rencontrer et voir, quelqu’un à qui il va sourire et qui va pouvoir répondre à son regard et à son sourire. Aussi, va-t-il chercher l’autre avec ce désir de revivre en humanité. Une quête vaine qui le ramène à l’empreinte et après bien des péripéties, il s’aperçoit que c’est sa propre empreinte, il n’y a personne : elle était là depuis les premiers temps de son arrivée sur l’île, fossilisée dans le sable ! A ce moment là, se développe tout un processus de découverte intérieure, découverte de son individuation comme de sa multiplicité interne. Progressivement, son regard va changer sur l’île, sur la manière d’aborder le vivant. Pour se retrouver en face de l’inconnaissable, l’impensable, avec lequel il va construire son existence. Voilà la trajectoire philosophique de mon Robinson, qui complète celui de Defoe et celui de Tournier, et qui en fait rappelle le cheminement de la conscience humaine des origines à nos jours. Pour autant, c’est un roman, pas un casse-tête intellectuel : il y a de quoi lire, il y a de quoi rire, il y a même du suspens et des surprises ! Propos recueillis par Yonnel Liégeois
P.C.– L’étranger aujourd’hui, on le voit tous les jours. En revanche, il y a un autre « autre » qui existe. Et c’est celui là qui intéresse mon Robinson. Il y a l’autre qui constitue la nature, c’est la conscience écologique. Pourquoi ? Parce que toutes les conceptions de l’humanisme qui se sont succédé ont toujours considéré que l’homme était au dessus du vivant, que l’homme était l’aboutissement du vivant. On s’aperçoit que si nous continuons d’exploiter le vivant de la manière la plus éhontée et en fonction de nos seuls intérêts, nous nous condamnons nous-mêmes. Mais pour moi, l’interrogation fondamentale réside en ce moment de l’origine où la conscience de Sapiens découvre l’impensable. Il me semble que, fondamentalement, l’autre aujourd’hui, ce n’est pas simplement l’étranger, ce n’est pas seulement la nature qu’il nous faut intégrer dans notre conception de l’humanisme, c’est l’impensable. Mon Robinson, dans toute sa trajectoire, croise celles du Robinson de Defoe et du Robinson de Tournier, mais il va se retrouver d’abord en face de lui-même le jour où il découvre une empreinte sur la plage de cette île qu’il domine depuis de nombreuses années déjà. Au départ, il a peur parce que l’autre, cet étranger, c’est peut être un ennemi potentiel. Donc il sort ses armes, il se prépare à la guerre, à se battre… Il part à sa recherche mais ne le trouve pas, c’est le premier stade. Le deuxième stade ? C’est quand il se dit que cet autre est peut-être un être humain, quelqu’un à qui il pourrait parler. Alors, il se regarde pour voir si il est bien rasé, et c’est là qu’il s’aperçoit qu’il ressemble à un animal, sale et hirsute. Donc, il commence à retrouver une dignité humaine, simplement parce qu’il imagine qu’il y a quelqu’un d’autre qu’il va rencontrer et voir, quelqu’un à qui il va sourire et qui va pouvoir répondre à son regard et à son sourire. Aussi, va-t-il chercher l’autre avec ce désir de revivre en humanité. Une quête vaine qui le ramène à l’empreinte et après bien des péripéties, il s’aperçoit que c’est sa propre empreinte, il n’y a personne : elle était là depuis les premiers temps de son arrivée sur l’île, fossilisée dans le sable ! A ce moment là, se développe tout un processus de découverte intérieure, découverte de son individuation comme de sa multiplicité interne. Progressivement, son regard va changer sur l’île, sur la manière d’aborder le vivant. Pour se retrouver en face de l’inconnaissable, l’impensable, avec lequel il va construire son existence. Voilà la trajectoire philosophique de mon Robinson, qui complète celui de Defoe et celui de Tournier, et qui en fait rappelle le cheminement de la conscience humaine des origines à nos jours. Pour autant, c’est un roman, pas un casse-tête intellectuel : il y a de quoi lire, il y a de quoi rire, il y a même du suspens et des surprises ! Propos recueillis par Yonnel Liégeois
Le penseur de l’imaginaire
 De sa « Chronique des sept misères » à « Solibo le magnifique », de « L’esclave vieil homme et le Molosse » aux « Neuf consciences du Malfini », Patrick Chamoiseau creuse son sillon de livre en livre. Une conscience façonnée par l’insularité, le souvenir hérité de l’esclavage et la lutte contre le colonisateur pour s’ouvrir à la complexité des relations humaines, décrypter la créolisation des peuples et des cultures, s’inscrire dans le rapport au « Tout Monde » cher à son aîné en écriture, Édouard Glissant. Avec « L’empreinte à Crusoé », l’écrivain antillais franchit un pas supplémentaire, délaissant le chatoyant parler créole pour inscrire son nouveau Robinson au cœur de la modernité et des grandes questions métaphysiques qui agitent la planète : celles des mythes créateurs et des origines, du métissage de nos racines et de nos cultures, du rapport à la nature, du choc de l’étrange et de l’étranger pour devenir pleinement humain. « L’empreinte à Crusoé » ? A travers moult épreuves et rebondissements, l’authentique saga d’un être en quête de devenir, se redécouvrant Homo Sapiens sur son île déserte. Une plume et une pensée qui caracolent entre perte d’identité et conscience de soi. Avec force imaginaire et poésie.
De sa « Chronique des sept misères » à « Solibo le magnifique », de « L’esclave vieil homme et le Molosse » aux « Neuf consciences du Malfini », Patrick Chamoiseau creuse son sillon de livre en livre. Une conscience façonnée par l’insularité, le souvenir hérité de l’esclavage et la lutte contre le colonisateur pour s’ouvrir à la complexité des relations humaines, décrypter la créolisation des peuples et des cultures, s’inscrire dans le rapport au « Tout Monde » cher à son aîné en écriture, Édouard Glissant. Avec « L’empreinte à Crusoé », l’écrivain antillais franchit un pas supplémentaire, délaissant le chatoyant parler créole pour inscrire son nouveau Robinson au cœur de la modernité et des grandes questions métaphysiques qui agitent la planète : celles des mythes créateurs et des origines, du métissage de nos racines et de nos cultures, du rapport à la nature, du choc de l’étrange et de l’étranger pour devenir pleinement humain. « L’empreinte à Crusoé » ? A travers moult épreuves et rebondissements, l’authentique saga d’un être en quête de devenir, se redécouvrant Homo Sapiens sur son île déserte. Une plume et une pensée qui caracolent entre perte d’identité et conscience de soi. Avec force imaginaire et poésie.
« L’empreinte à Crusoé », de Patrick Chamoiseau. Ed. Folio Gallimard, 336 p., 7€2.
En savoir plus
 – « Patrick Chamoiseau », par Samia Kassab-Charfi (Coéd. Gallimard / Institut Français, 174 p., 19€). Enrichi d’un CD d’entretiens, ce livre analyse avec pertinence l’œuvre et le parcours de l’auteur antillais.
– « Patrick Chamoiseau », par Samia Kassab-Charfi (Coéd. Gallimard / Institut Français, 174 p., 19€). Enrichi d’un CD d’entretiens, ce livre analyse avec pertinence l’œuvre et le parcours de l’auteur antillais.
– « Le papillon et la lumière », de Patrick Chamoiseau (Ed. Folio Gallimard, 112 p., 4€9). Un joli conte illustré par Lanna Andreadis, où l’écrivain nous livre quelques réflexions pour éviter de se brûler les ailes.
 Jean-Pierre Siméon – Le théâtre public, le théâtre d’art, celui qui m’importe et vis-à-vis duquel je suis donc le plus exigeant, s’est laissé entraîner ces dernières décennies vers un esthétisme froid par peur du sentiment, de l’émotion, en un mot du « pathos ». Je n’ai rien contre l’esprit de sérieux et le didactisme mais on est tombé dans un excès de formalisme savant, de démonstration conceptuelle brillante et virtuose. Cette obsession de la mise à distance interdit peu ou prou le plaisir naïf et spontané. Or, je crois que le théâtre doit être d’abord le lieu d’une émotion partagée, que l’émotion n’interdit pas la pensée, que le théâtre est précisément l’occasion d’une émotion qui ouvre à la réflexion.
Jean-Pierre Siméon – Le théâtre public, le théâtre d’art, celui qui m’importe et vis-à-vis duquel je suis donc le plus exigeant, s’est laissé entraîner ces dernières décennies vers un esthétisme froid par peur du sentiment, de l’émotion, en un mot du « pathos ». Je n’ai rien contre l’esprit de sérieux et le didactisme mais on est tombé dans un excès de formalisme savant, de démonstration conceptuelle brillante et virtuose. Cette obsession de la mise à distance interdit peu ou prou le plaisir naïf et spontané. Or, je crois que le théâtre doit être d’abord le lieu d’une émotion partagée, que l’émotion n’interdit pas la pensée, que le théâtre est précisément l’occasion d’une émotion qui ouvre à la réflexion. J-P.S. – La fonction politique est inhérente au théâtre, depuis l’Antiquité. Songez que le théâtre est dans la cité ce lieu incroyable où l’on ne se rassemble que pour assister à la manifestation de la pensée, de la langue, du poème. Où l’on s’assemble pour penser l’humain et interroger la complexité du destin individuel et collectif. Cela ne sert à rien, sinon à alerter les consciences, à les rendre plus alertes, à les exercer au doute, au désir, à l’inconnu. Si l’on croit, comme c’est mon cas, qu’une société n’est vivable et amendable que si existent en elle des consciences éveillées, critiques et « pensantes », le théâtre, l’art partagé sont les moyens de cette émancipation. Le théâtre est donc, à mes yeux, une université populaire permanente…
J-P.S. – La fonction politique est inhérente au théâtre, depuis l’Antiquité. Songez que le théâtre est dans la cité ce lieu incroyable où l’on ne se rassemble que pour assister à la manifestation de la pensée, de la langue, du poème. Où l’on s’assemble pour penser l’humain et interroger la complexité du destin individuel et collectif. Cela ne sert à rien, sinon à alerter les consciences, à les rendre plus alertes, à les exercer au doute, au désir, à l’inconnu. Si l’on croit, comme c’est mon cas, qu’une société n’est vivable et amendable que si existent en elle des consciences éveillées, critiques et « pensantes », le théâtre, l’art partagé sont les moyens de cette émancipation. Le théâtre est donc, à mes yeux, une université populaire permanente…